|
|
|
|
 |
|
L'émergence d'outils et de disciplines |
|
|
| |
|
| |

L'émergence d'outils et de disciplines
La connaissance de l'ADN et de son fonctionnement a fortement progressé ces dernières années grâce aux progrès technologique
Publié le 25 janvier 2018
L'évolution des technologies a été fulgurante. Dans les années 1990, il a fallu 13 ans pour séquencer les 3,3 milliards de bases du génome humain alors qu'aujourd'hui, une vingtaine de séquenceurs utilisés en simultané permettent de le faire en 15 minutes. Rapidité, faible coût et surtout faible quantité d'ADN requise ouvrent le champ à de nouvelles applications, notamment dans l'épigénétique et le diagnostic médical.
LE SÉQUENÇAGE
Des révolutions technologiques
En 40 ans, le séquençage a connu de vraies révolutions technologiques grâce aux avancées en physique, chimie et aux nanotechnologies. L'activité, coûteuse à ses débuts, a développé une organisation de type industriel et optimise les rendements grâce à des séquenceurs automatiques. Les dépôts d'échantillons se faisaient à la main sur les premiers séquenceurs à gel. Aujourd'hui, un séquenceur (destiné à analyser des génomes autres qu'humains) est intégré dans une clef USB et s'acquiert pour moins de 1 000 euros. La première technique largement utilisée dès 1977 a été la méthode Sanger, du nom du double prix Nobel de chimie qui l'a mise au point. À partir de 2005, apparaissent de nouvelles technologies de séquençage dites de 2e génération, tel que le pyroséquençage. Des millions de molécules, toutes issues du même échantillon, sont traitées en même temps ; c'est l'heure du séquençage haut débit ! Bien qu'elles aient toutes des spécificités très différentes, trois phases les caractérisent. La première, la préparation d'une collection d'ADN d'intérêt. La deuxième : l'amplification de l'ensemble des fragments afin de générer un signal suffisant pour que le séquenceur le détecte. Et enfin la phase de séquençage elle-même : pendant la synthèse du brin complémentaire, un signal est généré à chaque fois qu'un nouveau nucléotide est incorporé. Inconvénient : les séquences sont plus courtes et le taux d'erreur plus élevé que précédemment ; ce problème est aujourd'hui résolu sur les séquenceurs de dernière génération.
Les années 2010 voient se développer de nouvelles plateformes, dites de 3e génération. Ces appareils sont si sensibles qu’ils sont capables de séquencer une seule molécule d’ADN en quelques dizaines de minutes ! La dernière innovation présente un avantage majeur : pas besoin de répliquer l'ADN ni d'utiliser de fluorochromes, substance chimique capable d'émettre de la lumière par fluorescence. Sous la forme d’une puce dotée de nanopores (des canaux qui traversent une membrane), la machine capte directement les signaux électriques de chaque base d'ADN qui traverse le canal et permet de séquencer en un temps record. Cette méthode est pour l’instant réservée à de petits génomes, pas au génome humain.
La course aux génomes
La quête des gènes débute dans les années 1970. Lire la séquence de l’ADN devient indispensable pour les étudier, comprendre leur fonction et déceler les mutations responsables de maladies. Objectif ultime : déchiffrer les quelques 3,3 milliards de bases (3 300 Mb) du génome humain. Le projet est aussi ambitieux et presque aussi fou que celui d’envoyer un homme sur la Lune ! Les chercheurs commencent par de petits génomes. En 1995, le premier séquencé et publié est celui d’Haemophilus influenzae (1,8 Mb), une bactérie responsable de la méningite chez l’enfant. Suivra en 1996 celui d’un génome eucaryote unicellulaire, la levure Saccharomyces cerevisiae (12,5 Mb). Puis ce sera le tour du ver Caenorhabditis elegans (97 Mb) en 1998.
En 30 ans, les séquenceurs ont vu leur capacité augmenter d'un facteur 100 millions !
Quant au projet "Human genome", il démarre officiellement en 1989, pour une durée prévue de 15 ans et un budget global estimé à 3 milliards de dollars. Plus de 20 laboratoires de 7 pays différents sont impliqués. Les deux plus importants sont le Sanger Center (Grande-Bretagne) et le Whitehead Institute (États-Unis). En 1997, la France s'équipe d'une plateforme nationale, le Genoscope, et prend en charge le chromosome 14. La version complète de la séquence du génome humain sera publiée en avril 2003, avec plusieurs années d'avance (les chercheurs la complètent encore aujourd'hui). La course aux génomes continue : en août 2016, la base de données génomique internationale, en libre accès sur le site Gold (Genome On Line Database), faisait état de 13 647 organismes séquencés et publiés.
LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE
La quête des gènes ressemble souvent à une pêche miraculeuse ! Une fois détectés et annotés, leur fonction reste à vérifier et les conditions de leur expression à découvrir. C'est là que la génomique structurelle atteint ses limites et que la génomique fonctionnelle prend le relais.
Cette dernière dresse un inventaire qualitatif et quantitatif sur deux niveaux : le transcriptome et le protéome. Le premier désigne l’ensemble des transcrits (ARNm) et le deuxième l’ensemble des protéines fabriquées. Alors que le génome est unique pour un organisme donné, il existe autant de transcriptomes et de protéomes que de stades de développement cellulaire ! Grâce aux nouvelles technologies de séquençage, l’étude de l’ensemble des transcrits permet non seulement de réaliser un catalogue des gènes exprimés mais aussi de quantifier l’expression des gènes et de déterminer la structure de chaque transcrit à un moment donné. Une deuxième technologie, les puces à ADN, permet aussi d’étudier le transcriptome par l’observation simultanée de l’expression de plusieurs milliers de gènes dans une cellule ou un tissu donné. L’analyse d’un transcriptome peut, par exemple, indiquer le stade de développement d’un cancer et permettre ainsi d’adapter au mieux le traitement du patient.
LE GÉNOTYPAGE : Le génotypage cherche les différences dans la séquence des génomes d'individus d'une même espèce. Ces différences constituent des " marqueurs génétiques ". Pour les trouver, le génotypage fait appel à trois technologies différentes ; le séquençage, les puces à ADN et la spectrométrie de masse. Les marqueurs potentiellement intéressants sont ceux qui se transmettent au sein d'une famille de la même manière et en même temps que le gène impliqué dans une maladie. Les études génétiques à haut débit consistent à analyser des centaines de milliers de ces marqueurs sur des milliers d'individus afin d'identifier et localiser les gènes prédisposant à des pathologies
LA MÉTAGÉNOMIQUE
Les technologies de séquençage permettent aujourd’hui d’appréhender le génome de tous les organismes d’un même écosystème en même temps ; la génomique fait place à la métagénomique.
Le projet international "MetaHIT ”, auquel participe le CEA, a pour objectif d’étudier le génome de l'ensemble des bactéries constituant la flore intestinale humaine. Lourde tâche : le métagénome contient 100 fois plus de gènes que le génome humain et 85 % des bactéries sont encore inconnues. Premier résultat obtenu en mars 2010 : le séquençage de l’ensemble des gènes révèle que chaque individu abrite au moins 170 espèces différentes de bactéries intestinales.
En avril 2011, les chercheurs font une découverte assez inattendue. Ce ne sont pas les 3 signatures bactériennes intestinales identifiées qui sont corrélées à l'origine géographique, à l’âge ou à la masse corporelle des individus mais bien quelques poignées… de gènes bactériens ! La preuve de concept est faite : ces derniers pourront être utilisés comme biomarqueurs pour aider au diagnostic des patients touchés par des maladies comme l’obésité ou la maladie de Crohn. En 2014, une nouvelle approche permet de reconstituer le génome de 238 espèces complètement inconnues. Les chercheurs ont également trouvé plus de 800 relations de dépendance qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement global de cet écosystème intestinal.
L'ÉPIGÉNÉTIQUE
Peut-on tout expliquer par la génétique ? Dès 1942, Conrad Waddington souligne l'incapacité de cette discipline à expliquer le développement embryonnaire. Comment, en effet, expliquer la différence entre une cellule du foie et un neurone alors que toutes renferment le même programme ? Ce généticien désigne l'épigénétique comme le lien entre les caractères observables (phénotypes) et l'ensemble des gènes (génotypes).
Comparons l'organisme à une voiture ; la génétique serait l'établi sur lequel sont exposées toutes les pièces mécaniques et l'épigénétique la chaîne d'assemblage des différents éléments. Ainsi, l'épigénétique jouerait les chefs d'orchestre en indiquant pour chaque gène à quel moment et dans quel tissu il doit s'exprimer. Suite à la découverte des premiers mécanismes épigénétiques qui régulent l'expression des gènes, les chercheurs ont appris à « museler » un gène à des fins thérapeutiques.
Première méthode : par modification des protéines sur lesquelles s'enroule l'ADN. Le gène se compacte et devient alors inaccessible à la transcription ; il ne s'exprime plus. Seconde méthode : inactiver directement son ARNm avec des ARN interférence qui bloquent sa traduction. Depuis les années 1990, de nouvelles molécules associées à la régulation épigénétique sont découvertes. L'ensemble de ces molécules, le plus souvent trouvées dans l'ADN non-codant, forme l'épigénome. Complémentaire de la génétique, l'épigénétique donne une vue plus complète de la machinerie cellulaire et révèle une surprenante complexité dans les régulations de l'expression génique. Elle ouvre des perspectives dans la compréhension et le traitement de nombreuses maladies.
CNRGH et GENOSCOPE - Au sein de l'Institut de biologie François Jacob, ces deux services développent des stratégies et thématiques scientifiques distinctes, sur un socle de ressources technologiques communes. Le Centre national de recherche en génomique humaine (CNRGH) est axé sur la génomique humaine et la recherche translationnelle. Les recherches du Genoscope (aussi appelé Centre national de séquençage) portent sur l'exploration et l'exploitation de la biodiversité génomique et biochimique.
LE PROJET TARA
L'expédition « Tara Oceans » a débuté en septembre 2009. Pour explorer la diversité et évaluer la concentration du plancton, 40 000 prélèvements ont été réalisés. Leur analyse permet d'étudier l'effet du réchauffement climatique sur les systèmes planctoniques et coralliens, ses conséquences sur la vie marine et donc la chaîne alimentaire. Elle aidera à mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Enfin, le plancton représente une ressource de biomolécules potentiellement intéressante pour la chimie verte, l'énergie ou encore la pharmacie. Le Genoscope est chargé de l'analyse génétique des 2 000 échantillons « protistes » et « virus » ! En mai 2016, la goélette est repartie pour l'expédition « Tara Pacific ».
Objectif : Mieux comprendre la biodiversité des récifs coralliens, leur capacité de résistance, d'adaptation et de résilience face aux changements climatiques et à la pollution et dégradations dues à l'Homme. À bord et à terre, les chercheurs continuent leur travail de séquençage pour établir une base de données de tous les échantillons prélevés.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Mutations et réparation de l'ADN |
|
|
| |
|
| |
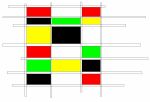
Mutations et réparation de l'ADN
La molécule d'ADN subit en permanence des attaques physiques, chimiques ou biologiques. Plusieurs systèmes de réparation veillent sur l'intégrité du patrimoine génétique.
Publié le 25 janvier 2018
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MUTATIONS,
LES AGENTS MUTAGÈNES
Les mutations génétiques
Au moment de la division, la cellule déclenche le processus de réplication de l’ADN pour en obtenir une copie. De temps en temps, le système produit quelques erreurs : ce sont les mutations. Le plus souvent, elles sont sans conséquence, puisqu’il y a 98 % de chances qu’elles tombent dans une partie du génome qui ne code pas pour la synthèse d’une protéine (ADN non-codant).
D’autres mutations, en revanche, peuvent modifier la composition ou la quantité d’une protéine et être à l’origine d’une maladie génétique. Parmi les différents types de mutations, certaines sont ponctuelles avec perte, addition, ou substitution d’une seule base. Mais elles peuvent aussi concerner des zones plus larges et occasionner de plus grandes perturbations.
Les agents mutagènes
D’autres sources, environnementales ou liées aux activités de l’Homme, peuvent également modifier l’ADN. Les facteurs mutagènes sont biologiques, physiques ou chimiques. La Nature s’est dotée d’agents particulièrement efficaces, les virus, dont certains peuvent tuer. Les rayons UV, X et la radioactivité sont des agents physiques à la méthode radicale : ils cassent la molécule d’ADN. Quant aux agents mutagènes chimiques, ils sont légions ; par exemple : le benzopyrène, présent dans la fumée de cigarette, le trichloréthylène, utilisé comme solvant dans les pressings...
Stress cellulaire et réponse aux agressions
Autonome, la cellule n'en dépend pas moins de son environnement, des cellules qui l'entourent et du milieu dans lequel elle vit. À chaque minute, elle défend son équilibre et son intégrité. Elle fait face aux situations de stress grâce à des voies de signalisation qui lui permettent d'identifier son agresseur et de vérifier l'intégrité de son système. Selon l'importance des dommages, elle décide alors de se réparer ou de se donner la mort.
Les signaux d'alerte
Par quoi une cellule peut-elle être stressée ? Une infection virale ou bactérienne, des produits toxiques, des rayonnements (UV, ionisants, rayons X…), des mutations génétiques, le manque d'eau ou de nutriments… La cellule contrôle un très grand nombre d'informations qu'elle reçoit de son environnement et de son propre système. Sa survie dépend de sa capacité à s'informer de façon continue. Quand les signaux témoignent d'un problème, par exemple des cassures double-brin dues à des rayonnements ionisants, un système d'alerte se déclenche. Les voies de signalisation sont nombreuses, complexes et encore peu connues.
La réparation de l'ADN
Lorsque la cellule a évalué les dégâts comme modérés, une voie de réparation, spécifique pour chaque type de dommage, est activée. Dans le cas de cassures double-brin par exemple, des protéines se chargent de la réparation. Mais cela peut parfois générer des mutations et mener jusqu'à une instabilité génétique et au développement d'un cancer. Pour étudier ces mécanismes de réparation, il existe un modèle tout à fait intéressant : la bactérie Deinococcus deserti.
Elle tolère des doses très élevées de radiations gamma et UV et de longues périodes de déshydratation extrême. Cette extrême tolérance est liée à la réparation très efficace de dommages massifs de l'ADN, notamment des cassures double-brin qui sont létales chez la plupart des organismes. Un ensemble de processus, à la fois actifs (réparation efficace de l'ADN) et passifs (super-compaction de l'ADN, protection des protéines contre l'oxydation) contribuent à sa radio-tolérance.
La mort programmée
Une cellule se sacrifie pour l'organe et l'organisme. En cas de réparation difficile ou impossible, elle déclenche son apoptose. Cette mort cellulaire, contrairement à la nécrose, est programmée. Elle se déroule suivant un enchaînement de phénomènes complexes : la chromatine se condense et la cellule se fragmente en corps dits apoptotiques qui sont ensuite détruits. Les étapes de déclenchement sont contrôlées par 3 gènes et les différentes phases de la destruction cellulaire seraient contrôlées par une dizaine d'autres. Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement de ce processus ? L'équilibre entre croissance et mort cellulaire est rompu, l'intégrité de l'organisme n'est plus assurée. Dans le cas d'une prolifération des cellules néfastes, l'organisme peut développer un cancer. La stimulation de l'apoptose, quant à elle, peut conduire l'organisme à se retourner contre lui-même. C'est le cas pour le Sida qui affaiblit par pyroptose accrue des lymphocytes TCD4, diminue les défenses immunitaires de l'organisme et prépare un terrain favorable à des maladies opportunistes.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
photosynthèse |
|
|
| |
|
| |
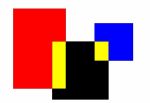
photosynthèse
Consulter aussi dans le dictionnaire : photosynthèse
Cet article fait partie du dossier consacré à la
nutrition
Chez les végétaux et certaines bactéries, processus de fabrication de matière organique à partir du gaz carbonique de l’atmosphère et (cas principal) d’eau, utilisant la lumière solaire comme source d’énergie et produisant un dégagement d’oxygène. [Synonyme vieilli : assimilation chlorophyllienne.]
1. Principe
La photosynthèse, qui signifie littéralement « synthèse [de matière organique] par la lumière », correspond au piégeage de l’énergie lumineuse provenant du Soleil, et de son stockage sous la forme de matière organique (des glucides notamment). Ce faisant, les végétaux et les bactéries photosynthétiques produisent leurs propres composants à partir de l’énergie solaire (on dits qu’ils sont autotrophes).
La photosynthèse des végétaux et des cyanobactéries consomme de l’eau (H2O), du dioxyde de carbone (CO2) et produit de l’oxygène (O2) – des expériences de marquage radioactif ont montré que cet oxygène provient de l’eau, et non du CO2 absorbé. Ce faisant, elle enrichit l'atmosphère en oxygène. Consommé par les êtres vivants (respiration), cet oxygène atmosphérique est renouvelé en permanence par l’activité de l’ensemble des organismes photosynthétiques – s’il n’y avait plus de photosynthèse sur Terre, son stock finirait par s’épuiser. Cas particulier, la photosynthèse des bactéries pourpres et des bactéries vertes ne rejette pas d’oxygène, mais d’autres sous-produits (essentiellement du soufre [S]).
L’énergie nécessaire à la photosynthèse est fournie par le rayonnement du Soleil. La lumière est donc un facteur décisif dans le processus (c’est pourquoi, par exemple, une plante d’appartement placée dans une pièce sombre dépérit rapidement). L'intensité lumineuse optimale est différente d'une espèce végétale ou bactérienne à une autre. Les diverses radiations qui composent la lumière blanche ont une action spécifique : les radiations rouges (600 nm) et indigo (400-450 nm), absorbées par la chlorophylle, sont les plus efficaces ; les vertes ne sont d'aucun effet.
2. Localisation
Chez les plantes et les algues, la photosynthèse s'effectue au niveau des parties vertes, et tout particulièrement des feuilles : leurs cellules renferment en effet de petites usines à photosynthèse, les chloroplastes, contenant eux-mêmes de la chlorophylle, un pigment de couleur verte qui permet la captation de l’énergie lumineuse. Chez les végétaux qui ne sont pas de couleur verte – par exemple les plantes à feuilles pourpres –, le processus et la localisation sont les mêmes : simplement, la chlorophylle est masquée par des pigments d’autres couleurs.
Chez les bactéries (notamment les abondantes cyanobactéries, mais aussi les bactéries vertes et les bactéries pourpres), qui sont dépourvues d’organites, la photosynthèse se fait dans le cytoplasme, sur des invaginations de la membrane cellulaire ou des corpuscules (appelés chlorosomes), qui renferment des bactériochlorophylles.
Chez les végétaux et les cyanobactéries, les pigments photosynthétiques sont groupés en photosystèmes : ceux-ci sont composés d’une antenne collectrice des photons (composée de chlorophylle b, de caroténoïdes et de protéines), et d’un centre réactionnel (composé de deux molécules de chlorophylle a), qui a pour fonction de transférer des électrons à une chaîne d’accepteurs d’électrons. Deux photosystèmes distincts ont été identifiés : le photosystème I et le photosystème II (numérotés dans l’ordre de leur découverte).
3. Les phases de la photosynthèse
La photosynthèse se déroule en deux phases distinctes : une phase dépendante de la lumière (phase photochimique ou phase claire), au cours de laquelle l'énergie solaire est captée par la chlorophylle, suivie d'une phase indépendante de la lumière (phase non photochimique ou phase sombre, beaucoup plus longue, où cette énergie est utilisée pour réaliser les synthèses chimiques.
3.1. La phase photochimique
Chloroplaste
Chez les végétaux, la phase photochimique, connue aussi sous les noms de phase claire ou phase lumineuse (bien que ces expressions soient aujourd’hui abandonnées par les scientifiques) se produit dans des replis de la membrane du chloroplaste, appelés thylakoïdes.
Au cours de cette phase, le photosystème I (PS I), frappé par les photons de la lumière solaire, éjecte des électrons. Ceux-ci sont transférés à une chaîne de transporteurs d’électrons, à l’issue de laquelle ils servent à réduire le NADP+ en NADPH + H+ (→ nicotinamide).
Des photons frappent aussi le photosystème II (PS II), qui libère également des électrons. Ceux-ci sont transférés à une chaîne de transfert d’électrons, puis à un complexe appelé cytochrome. Ce dernier transfert déclenche le passage d’ions H+ dans le stroma du chloroplaste (le milieu aqueux à l’intérieur du chloroplaste) ; ce passage permet à une enzyme, l’ATP-synthétase, de produire des molécules d’ATP (adénosine triphosphate) – l’ATP est la molécule universelle de stockage de l’énergie chez les êtres vivants. Du cytochrome, les électrons passent sur le PS I, pour compenser la perte d’électrons subie à la suite de l’action des photons. Les photons provoquent également la destruction des molécules d’eau (c’est la photolyse de l’eau). Cette réaction (H2O →2H+ + ½ O2 + 2e-) produit des protons qui vont rejoindre le stroma du chloroplaste et des électrons qui vont combler le trou électronique du PS II ; c’est aussi cette réaction qui dégage de l’oxygène (on voit ainsi que l’oxygène est un sous-produit, un déchet du mécanisme de la photosynthèse).
3.2. La phase non photochimique
La phase non photochimique, autrefois appelée phase sombre ou phase obscure, se déroule dans le stroma du chloroplaste et ne nécessite pas de lumière. Elle correspond à la synthèse de la matière organique ; elle consomme du CO2 et libère de l'eau. L’ATP et le NADPH + H+ produits par la phase photochimique servent à transformer le CO2 en glucides, au cours d’une série de réactions biochimiques appelées cycle de Calvin. Celui-ci débute par la fixation du dioxyde de carbone sur un composé appelé RuDP (ribulose-1,5-diphosphate), grâce à une enzyme, la Rubisco (ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygénase) – acteur majeur de la transformation du CO2 en composés organiques, la Rubisco est la protéine la plus abondante sur Terre.

Cycle de Calvin
Le cycle de Calvin produit un triose (un sucre en C3), le glycéraldéhyde-3-phosphate (pour une consommation de 3 CO2, 9 ATP et 6 NAPH + H+). Les trioses se combinent ensuite pour former d’autres sucres, comme le glucose (sucre en C6 ou hexose).
Une quinzaine de secondes après l'absorption du CO2 apparaissent les premiers sucres. À partir de certains hexoses se constituent le saccharose et l'amidon. Outre des glucides, la photosynthèse peut également élaborer des lipides et des protéines par liaison avec une molécule azotée.
Ce cycle existe chez les algues, les plantes des régions tempérées et tous les arbres ; ces végétaux sont dits « plantes en C3 », car le cycle produit un triose.
4. Adaptations particulières
4.1. Plantes en C4
Chez les graminées tropicales (maïs, mil, sorgho, canne à sucre, plusieurs plantes de la famille des amarantacées), on a découvert en 1966 un autre mécanisme, dit « photosynthèse en C4 ». Il s’agit d’une photosynthèse en deux temps qui se réalise dans deux endroits distincts des feuilles : le premier temps dans les chloroplastes des cellules du mésophylle (la « couche centrale » de la feuille), le second dans ceux de la gaine de cellules qui entoure les vaisseaux conducteurs de sève (gaine périvasculaire). Dans le mésophylle, la fixation du carbone conduit à un composé en C4 (malate ou aspartate). Celui-ci est ensuite transporté jusqu’à la gaine périvasculaire où il est à nouveau décomposé en CO2. Ce CO2 est alors incorporé dans le cycle classique de Calvin, qui aboutit à la production de glucose et d’amidon. Ce mécanisme fonctionne d'autant mieux que la lumière est plus vive et la température voisine de 40-50 °C.
Les plantes en C4 ont un rendement photosynthétique très supérieur à celui des plantes en C3.
La synthèse des glucides se faisant autour des vaisseaux conducteurs, la migration des produits synthétisés est également plus rapide. La photorespiration (fixation d’O2 au lieu de CO2 sur la Rubisco du cycle de Calvin, mécanisme qui diminue le rendement de la photosynthèse) y est très faible. Alors que les végétaux en C3 ont besoin de 150 à 250 g d'eau pour assimiler 1 g de carbone, les végétaux en C4 peuvent se contenter de 50 à 100 g.
4.2. CAM (Crassulacean Acid Metabolism)
Certaines plantes, généralement des plantes grasses et quelques fougères, fixent le CO2 pendant la nuit pour former de l'acide malique. Cet acide est décomposé pendant le jour et libère du CO2 qui, comme précédemment, est introduit dans le cycle des synthèses (cycle de Calvin) en utilisant l'énergie captée par les chloroplastes à la lumière. Les plantes CAM peuvent ainsi supporter la vie dans les milieux arides-chauds : leurs stomates se ferment le jour pour limiter la transpiration et s'ouvrent la nuit pour laisser pénétrer le CO2, les synthèses se faisant le jour suivant.
5. Bilan de la photosynthèse
L'équation bilan de la photosynthèse des végétaux et des cyanobactéries (dans laquelle l'eau est le donneur d'électrons), est la suivante :
6 CO2 + 12 H2O + lumière → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
6. Importance de la photosynthèse
De la lumière reçue par une feuille, 20 % sont réfléchis, 10 % transmis et 70 % effectivement absorbés, sur lesquels 20 % sont dissipés en chaleur, 48 % perdus en fluorescence. Il reste environ 2 % servant à la photosynthèse.
Grâce à la photosynthèse, les végétaux jouent un rôle irremplaçable à la surface de la Terre ; en effet, les plantes vertes sont, avec quelques groupes de bactéries, les seuls êtres vivants capables d'élaborer des substances organiques à partir d'éléments minéraux. On estime que chaque année 20 milliards de tonnes de carbone sont fixés par les végétaux terrestres à partir du gaz carbonique de l'atmosphère et 15 milliards par les algues.
Les végétaux verts sont les producteurs primaires indispensables, premier maillon de la chaîne trophique (→ chaîne alimentaire) ; les végétaux non chlorophylliens et les animaux herbivores et carnivores (y compris l'homme) sont entièrement dépendants de la photosynthèse.
Pour en savoir plus, voir les articles métabolisme, écologie.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le cervelet, une région du cerveau clé pour la socialisation |
|
|
| |
|
| |

Le cervelet, une région du cerveau clé pour la socialisation
16 JUIN 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Cette image du cervelet d’une souris exprimant une protéine fluorescente dans les cellules de Purkinje exprimant les récepteurs à la dopamine D2. © Emmanuel Valjent, Institut de Génomique Fonctionnelle (Montpellier).
Situé à l’arrière du crâne, le cervelet est une région du cerveau essentielle au contrôle de la fonction motrice, mais il contribue également aux fonctions cognitives supérieures, notamment aux comportements sociaux. Dans une étude récente, un consortium de recherche international comprenant des scientifiques de l’Inserm, de l’Université de Montpellier, du CNRS, de l’Institut de Neurociències Universitat Autònoma de Barcelone (INc-UAB) (Espagne) et de l’Université de Lausanne (Suisse) a découvert comment l’action d’un neurotransmetteur dans le cervelet, la dopamine, module les comportements sociaux via une action sur des récepteurs à dopamine spécifiques appelés D2R. En utilisant différents modèles de souris et des outils génétiques, les chercheurs et chercheuses montrent que des changements dans les niveaux de D2R, dans un type spécifique de cellules du cervelet, modifient la sociabilité et la préférence pour la nouveauté sociale, sans pour autant affecter les fonctions motrices. Ces résultats, publiés dans le journal Nature Neurosciences, ouvrent la voie à une meilleure compréhension de certains troubles psychiatriques liés à la sociabilité, comme les troubles du spectre autistique (TSA), les troubles bipolaires ou la schizophrénie.
La dopamine (DA) est le neurotransmetteur clef dans le système de récompense du cerveau, impliquée dans le contrôle de la motivation, des états émotionnels et des interactions sociales. La régulation de ces processus repose en grande partie sur l’activation de circuits neuronaux intégrés dans les régions limbiques. Cependant, des preuves récentes indiquent que le cervelet, une région classiquement associée au contrôle moteur, peut également contribuer aux fonctions cognitives supérieures, y compris les comportements sociaux.
Pour aller plus loin et mieux comprendre le rôle du cervelet, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de l’Université de Montpellier, du CNRS, de l’Institut de Neurociències UAB (Espagne) et de l’Université de Lausanne (Suisse) ont mis en évidence un nouveau rôle de la dopamine au niveau du cervelet, montrant qu’elle module les comportements sociaux chez la souris.
En combinant une analyse transcriptomique[1] spécifique au type de cellule, des analyses par immunofluorescence et de l’imagerie 3D, les chercheurs ont d’abord démontré la présence d’un type particulier de récepteurs de la dopamine (nommé D2R) dans les principaux neurones de sortie du cervelet, les cellules de Purkinje. Grâce à des enregistrements de l’activité neuronale, ils ont pu montrer que les D2R modulaient l’excitation des cellules de Purkinje.
« Cette première série de résultats était déjà déterminante pour nous, car elle dévoilait que les D2R étaient bien présents dans le cervelet, ce qui n’était pas clair jusqu’à ce jour, et que, malgré leur faible niveau d’expression, ils étaient fonctionnels », souligne Emmanuel Valjent, directeur de recherche à l’Inserm et coordinateur de l’étude.
Comprendre le rôle de la dopamine dans le cervelet
Les chercheurs se sont ensuite intéressés à la fonction de ces récepteurs D2R au sein de ces neurones du le cervelet. En utilisant des approches génétiques permettant de réduire ou d’augmenter la quantité des récepteurs D2R sélectivement dans les cellules de Purkinje, ils ont analysé l’impact de ces altérations sur les fonctions motrices et non motrices du cervelet.
Les scientifiques ont ainsi montré qu’il existe une association entre la quantité de D2R qui sont exprimés dans les cellules de Purkinje et la modulation des comportements sociaux.
« Réduire l’expression de ce récepteur spécifique de la dopamine a altéré la sociabilité des souris ainsi que leur préférence pour la nouveauté sociale, alors que leur coordination et leurs fonctions motrices n’ont pas été affectées » explique le Dr Laura Cutando, post doctorante à l’Inserm, aujourd’hui chercheuse à l’UAB, et première auteure de l’article.
Cette étude constitue un premier pas vers une meilleure compréhension du rôle de la dopamine dans le cervelet et des mécanismes sous-jacents aux troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, le TDAH et les troubles anxieux, qui ont tous en commun une altération des niveaux de dopamine et des comportements sociaux altérés.
[1] La transcriptomique est l’analyse des ARN messagers transcrits dans une cellule, tissu ou organisme, permettant de quantifier l’expression des gènes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
