|
|
|
|
 |
|
CONSCIENCE |
|
|
| |
|
| |
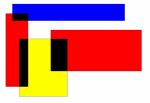
conscience
Du latin consciencio. En allemand, Bewusstsein, « conscience psychologique », et Gewissen, « conscience morale ».
Traditionnellement visée comme une instance morale faisant contrepoids à la scientia en la redoublant et en l'enroulant dans un mouvement réflexif et spéculatif, la conscience prend une valeur autonome dans l'histoire de la philosophie lorsque, pour désigner l'identité de l'ontogenèse et de la phylogénèse, Hegel choisit de donner à la conscience une place inédite. Désignant alors le sujet pris dans le mouvement dialectique où se produit son effectivité, la conscience, qui avait encore un sens pratique chez Kant, devient pour la philosophie contemporaine une catégorie aussi distincte du sujet pensant qu'elle l'est du simple moi. Bien loin, alors, de renvoyer à l'intimité des sentiments, elle prend la valeur d'une unité fondatrice qui sait se porter vers la chose pour la viser et la réduire.
Philosophie Contemporaine, Ontologie
Chez Heidegger, ce qui atteste de la possibilité existentielle d'un pouvoir-être authentique du Dasein.
Si le Dasein atteint dans le devancement de la mort à la transparence de son existence, cette transparence n'est qu'une possibilité ontologique exigeant une attestation ontique. La conscience donne cette attestation. Elle est un phénomène originaire du Dasein qui doit se comprendre hors de toute connotation théologique ou morale. Appel du souci, elle est caractérisée comme une voix qui ne dit rien, mais convoque le Dasein à son pouvoir-être authentique. L'appel le rappelle à sa facticité, le constituant comme projet nul et jeté. Cette voix apparaît comme extérieure, car elle est celle du Dasein dans son étrangeté, en tant qu'il n'est pas chez soi. Le Dasein déchu est donc appelé par le Dasein factice à être authentique en tant qu'il se projette dans l'avenir, devant assumer sa facticité selon une non-maîtrise constituant sa nullité. Perdu dans la déchéance, le Dasein n'entend plus que le On ; seul l'appel de la conscience peut briser l'écoute du On, s'opposant au bavardage et se manifestant comme silencieux. La conscience convoquant l'être soi-même du Dasein hors de la perte dans le On, son appel vient de moi tout en me dépassant. Comprendre la conscience comme appel du souci signifie vouloir-avoir-conscience. Cette compréhension existentiale de la conscience permet d'expliquer la conception vulgaire de la conscience morale comme juge ou guide. L'appel de la conscience parlant sur le mode du faire-silence, il ne saurait donner une prescription normative positive. Il s'agit donc d'exhiber une instance originaire, selon laquelle l'appel, en tant que rappel d'un pouvoir-être authentique factice, livre au Dasein sa possibilité la plus propre, en le renvoyant dans l'appel du souci à son être-jeté.
Jean-Marie Vaysse
Notes bibliographiques
* Heidegger, M., Sein und Zeit (Être et Temps), Tübingen, 1967, § 54-57.
→ authentique, Dasein, déchéance, être-jeté, existential, on, souci
Philosophie de l'Esprit, Psychologie
Au sens large, ensemble des phénomènes qui constituent notre vie mentale à l'état d'éveil. En divers sens techniques, formes particulières de manifestation de notre vie mentale ou d'accès à nos processus mentaux.
Variétés de la conscience
Le terme de « conscience », au sens psychologique, comporte plusieurs acceptions renvoyant à différents phénomènes de notre vie mentale.
En un premier sens, un animal ou un être humain sont dits conscients s'ils sont en état d'éveil et sont réceptifs aux stimulations sensorielles provenant de leur environnement. La conscience phénoménale désigne les aspects qualitatifs de notre expérience perceptive tant interne qu'externe ; la manière dont les choses nous apparaissent subjectivement, par exemple, ce que nous éprouvons lorsque nous ressentons une douleur ou avons une sensation. La conscience introspective ou réflexive renvoie à la capacité que nous avons d'inspecter mentalement le cours de nos pensées, et notamment la capacité que nous avons de former des pensées de second ordre sur le fait que nous sommes dans un certain état mental. La conscience de soi consiste en la possession par un sujet d'un concept de soi, et en la capacité à utiliser ce concept pour conférer une certaine unité à sa vie mentale en appréhendant ses pensées et expériences comme siennes. Enfin, on peut dire d'un état mental qu'il est accessible à la conscience si une représentation de son contenu peut être librement mobilisée dans le raisonnement ou le contrôle de l'action et peut être rapportée verbalement. N. Block(1) a récemment proposé de désigner cette acception du nom de conscience-accès.
Les états mentaux sont-ils par définition conscients ?
La thèse de Descartes et de Locke selon laquelle tout le domaine du mental est conscient est aujourd'hui largement contestée. Deux grandes catégories d'états mentaux doivent être distinguées : les états comme les croyances ou les désirs, qui ont un contenu intentionnel, et les états sensoriels ou qualia, comme les douleurs et les sensations de rouge. Un grand nombre de philosophes s'accordent pour penser que tous les états sensoriels, sont conscients au sens phénoménal, l'idée de sensation inconsciente paraissant incohérente dans la mesure où le fait d'avoir une certaine qualité subjective apparaît constitutif de ce qu'est une sensation. En revanche, beaucoup pensent aujourd'hui que les états intentionnels ne sont pas toujours conscients. C'est toutefois la notion de conscience-accès plutôt que de conscience phénoménale qui est alors en jeu, car il ne semble pas qu'une phénoménologie distinctive soit associées aux croyances et autres attitudes propositionnelles. Une pensée sera alors dite consciente ou inconsciente selon que son contenu sera ou non accessible à un moment donné aux systèmes de raisonnement et de verbalisation. Certains philosophes récusent toutefois aujourd'hui les deux notions de conscience phénoménale et de conscience-accès et proposent une théorie purement métareprésentationnelle de la conscience, selon laquelle un état n'est conscient que pour autant qu'il est accompagné d'une pensée d'ordre supérieur.
Inconscient cognitif et inconscient freudien
Si nombre de philosophes de l'esprit partagent avec la psychanalyse l'idée que conscience et intentionnalité sont dissociables et donc que la notion de pensée inconsciente n'a rien d'incohérent, inconscient freudien et inconscient cognitif présentent toutefois des caractéristiques assez différentes. L'inconscient freudien au sens strict consiste en des désirs et des pensées qui cherchent sans cesse à se manifester, mais sont rendus inaccessibles à la conscience par l'action constante de mécanismes de refoulement. L'inconscient freudien n'est pas en principe inaccessible à la conscience puisque les techniques psychanalytiques de levée du refoulement ont précisément pour objectif de permettre au sujet de prendre conscience de ces désirs et pensées. En revanche, dans les sciences cognitives et en philosophie de l'esprit, l'idée d'états mentaux en principe inaccessibles à la conscience est couramment admise. Cette inaccessibilité n'est pas considérée comme l'effet d'une dynamique des pulsions, mais comme une conséquence de la manière dont notre système perceptivo-cognitif est structuré. Il comporte des sous-systèmes modulaires et des niveaux de représentation subpersonnels. On a donc affaire à un inconscient structurel et non dynamique.
La notion de conscience la plus problématique aux yeux des philosophes de l'esprit contemporains est très certainement celle de conscience phénoménale. Il semble que nous nous trouvions devant un fossé explicatif : les approches fonctionnalistes ou physicalistes de l'esprit ne semblent pas pouvoir expliquer l'existence de notre expérience subjective. Pour l'essentiel, trois tendances se dessinent face au caractère mystérieux de l'expérience subjective. À un extrême, les éliminativistes, comme D. Dennett(2), nient la cohérence de la notion traditionnelle de la conscience phénoménale et l'existence même des phénomènes auxquels cette notion renvoie. À l'autre extrême, des philosophes tels D. Chalmers(3) ou F. Jackson(4) considèrent que la conscience phénoménale est irréductible et que cette irréductibilité manifeste l'incomplétude fondamentale des conceptions fonctionnalistes ou physicalistes de l'esprit. Enfin, certains philosophes poursuivent une voie moyenne et, tout en admettant l'existence de la conscience phénoménale, nient son irréductibilité, soit qu'ils tentent, comme D. Rosenthal(5), d'en rendre compte dans le cadre d'une théorie méta-représentationnelle de la conscience, soient qu'ils considèrent, comme F. Dretske(6), que les états phénoménaux correspondent à un type particulier de représentations dotées d'un format représentationnel non-conceptuel.
Élisabeth Pacherie
Notes bibliographiques
* Block, N., « On a Confusion about a Function of Consciousness », Behavioral and Brain Sciences, 18, 1995, pp. 227-287.
* Dennett, D., La conscience expliquée, trad. P. Engel, Odile Jacob, Paris, 1993.
* Chalmers, D., The Conscious Mind, Oxford University Press, Oxford, 1996.
* Jackson, F., « What Mary didn't Know », Journal of Philosophy, 1986, pp. 291-295.
* Rosenthal, D., « Two Concepts of Consciousness », Philosophical Studies, 49, pp. 329-59, 1986.
* Dretske, F., Naturalizing the Mind, MIT Press, Cambridge (MA), 1995.
* Voir aussi : Block, N., Flanagan, O., et Güzeldere, G. (éd.), The Nature of Consciousness –Philosophical Debates, MIT Press, Cambridge (MA), 1997.
* Searle, J., le Mystère de la conscience, trad. C. Tiercelin, Odile Jacob, Paris, 1999.
→ connaissance tacite, matérialisme, neurosciences, qualia
Psychologie
Propriété spécifiquement humaine de subjectivité puis de réflexivité (conscience d'être conscient) des expériences mentales.
Pour le psychologue, la notion de conscience a longtemps été de celle qui ne s'offre à une étude non-philosophique (ou positive) que par la pathologie, soit par ses absences ou ses troubles partiels, soit dans le cadre d'une théorie des instances qui composent la personnalité (en psychanalyse notamment). Une difficulté notoire en psychiatrie est ainsi qu'une vigilance réactive et structurée aux événements internes ou externes n'est nullement incompatible avec une maladie mentale aiguë(1), ni n'empêche, parfois, l'abolition du discernement au sens médico-légal (commandant la responsabilité). Le souci récent de naturaliser la conscience par la neurobiologie, en définissant les paramètres physiologiques de la vigilance cérébrale (Crick et Koch) a en revanche l'intérêt de fixer l'horizon de ce qui serait peut-être irréductiblement psychologique dans la conscience (le quale, « l'effet que ça fait » d'être conscient, dit Nagel(2)), parce qu'aucune explication matérielle n'épuise l'intuition de la subjectivité. Mais ce n'est pas plus qu'un horizon et il n'existe pas de programmes de recherche consistants sur la conscience en neuropsychologie. Une exception est le cas des sujets qui n'ont pas conscience de percevoir certains stimuli visuels, s'avèrent capables d'en décrire des propriétés (Young(3) et Revonsuovo) ; une autre, les « états de conscience modifiés » (hypnose, etc.) dans lesquels on tente de corréler des écarts de la vigilance cérébrale avec l'intentionnalité des états mentaux, voire les relations au monde qui découlent de tels « éveils »(4).
Plusieurs distinctions psychologiques réduisent cependant la généralité du terme. La « conscience en acte » de Piaget(5) s'oppose ainsi à la « prise de conscience » comme le savoir-faire au savoir réfléchi qu'on sait faire. Piaget, en intégrant ainsi la conscience à l'agir, récuse l'interdit béhavioriste jeté sur les entités introspectives. Sauf ce facteur de l'agir, la conscience en acte évoque le contraste, net en anglais, entre l'awareness pré-réflexive et la consciousness réfléchie dont la conscience de soi est la forme achevée. L'awareness est aussi stratifiée : il y a un état fonctionnel d'accès aux faits dont on a conscience, et qui saisit plutôt des occurrences singulières, état qui se différencie d'un autre, non-fonctionnel, qui traite plutôt des types, et qui émerge notamment dans les comportements où je me montre « au courant » de ce dont je parle. L'effort réductionniste porte plutôt sur la conscience d'accès ; l'awareness qualitative est la cible d'un matérialisme éliminativiste(6).
Ces distinctions isolent des niveaux opératoires de conscience. Elles font bon marché des usages du mot dans l'interlocution (dire « j'ai conscience de... » c'est exclure qu'autrui puisse avoir conscience comme moi ; cela n'a ni contenu informatif, ni n'en revendique). Ainsi la conscience sert à marquer l'insubstituabilité des places, ce qui complique la querelle sur l'irréductible vécu conscient d'un égard nécessaire pour le contexte des jeux de langage qu'on joue quand on en parle. Il se peut alors que des facteurs culturels contaminent l'objectivation psychologique de la conscience.
Pierre-Henri Castel
Notes bibliographiques
* Ey, H., La conscience, Desclée de Brouwer, Paris, 1963.
* Nagel, T., Mortal Questions, Cambridge, 1979.
* Young, A.W., et Revonsuo, A., Consciousness in Philosophy and Cognitive Neurosciences, New York, 1994.
* Etévenon, P., L'homme éveillé, Tchou, Paris, 1990.
* Piaget, J., La prise de conscience, PUF, Paris, 1974.
* Dennett, D., La conscience expliquée, Odile Jacob, Paris, 1993.
→ inconscient, psychanalyse
Psychanalyse
« La psychanalyse ne peut placer l'essence du psychique dans la conscience, mais il lui faut au contraire envisager la conscience comme une qualité du psychique, qui peut s'ajouter à d'autres qualités ou demeurer absente. [...] Ici est le premier schibboleth de la psychanalyse. »(1)
Partant de l'efficience de la suggestion posthypnotique et de l'analyse des symptômes, rêves, lapsus et traits d'esprit, Freud postule un inconscient dynamique, étranger au préconscient-conscient. Système, lieu et qualité, ce dernier perçoit, et a fonction d'interface et de pare-excitation vis-à-vis du monde extérieur. Il n'accède aux processus psychiques que par perception des représentations de mots et des sensations de plaisir-déplaisir. L'analogie de l'appareil psychique avec une ardoise magique place la conscience au lieu de la feuille transparente protectrice : mémoire et conscience s'excluent(2).
« Les deux éclaircissements, à savoir la vie pulsionnelle de la sexualité n'a pas à être complètement domptée en nous, et les processus psychiques sont en soi inconscients, et ils ne deviennent accessibles au moi et soumis à lui qu'à travers une perception incomplète et non fiable, sont équivalents à l'affirmation que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ils présentent ensemble la troisième blessure de l'amour-propre [après Copernic et Darwin] que je souhaiterais nommer la blessure psychologique. »(3) Freud a mis en cause les philosophies de la conscience. On attend encore une philosophie qui tiendrait compte de l'inconscient freudien.
Michèle Porte
Notes bibliographiques
* Freud, S., Das Ich und das Es (1923), « Le moi et le ça », in Œuvres complètes. Psychanalyse, XVI, PUF, Paris, 1991, p. 258.
* Freud, S., Notiz über den « Wunderblock » (1925), « Le bloc-notes magique », in Œuvres complètes. Psychanalyse, XVII, PUF, Paris, 1992, pp. 137-144.
* Freud, S., Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse (1917), G. W., XII, p. 11, « Une difficulté de la psychanalyse ».
→ inconscient, mémoire, représentation, topique
Morale
Sentiment intérieur par lequel l'homme juge ses propres actions selon leur valeur morale, connaissance intuitive du bien et du mal qui permet ce jugement.
En français, le sens moral du terme précède de loin de sens cognitif, qui n'apparaît qu'au xviie s. Il traduit le latin conscientia, qui traduit lui-même le grec suneidêsis, en particulier dans cette phrase de saint Paul : « Quand des païens, sans avoir de loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur ; leur conscience en témoigne également ainsi que leurs jugements intérieurs qui tour à tour les accusent et les défendent. »(1).
Pour saint Augustin, l'homme reçoit de Dieu une conscience morale, en tant qu'il est un être qui doit agir, comme il reçoit la lumière naturelle en tant qu'il est un être qui doit connaître. C'est une illumination morale par laquelle le Maître intérieur enseigne à tous ce qu'il faut faire (vivre avec justice, subordonner les choses moins bonnes aux meilleures, attribuer à chaque chose son dû, etc.)(2).
Thomas d'Aquin insiste en revanche, en ramenant la conscientia à l'étymologie cum alio scientia, sur le fait que la conscience n'est pas une puissance mais un acte de l'intellect qui connaît la loi morale et l'applique aux cas particuliers(3).
Dès lors, deux interprétations de la conscience morale sont possibles (qui ne sont pas nécessairement incompatibles), selon qu'on souligne en elle l'acte intellectuel ou l'illumination intérieure. De la première témoigne encore aux xviiie s., la définition donnée par l'Encyclopédie Diderot-d'Alembert : « Acte de l'entendement, qui indique ce qui est bon ou mauvais dans les actions morales, et qui prononce sur les choses qu'on a faites ou omises ; d'où il naît en nous-mêmes une douce tranquillité ou une inquiétude importune » (de Jaucourt). De la deuxième témoigne quelques années plus tard la définition du Dictionnaire de l'Académie de 1762 : « Lumière intérieure, sentiment intérieur par lequel l'homme se rend témoignage à lui-même du bien et du mal qu'il fait ». C'est à cette dernière tendance qu'il faut rattacher le célèbre passage de Rousseau qui, dans la Profession de foi du vicaire savoyard, fait de la conscience, qu'il définit comme un principe inné de justice et de vertu qui nous permet de juger nos propres actions et celle des autres comme bonnes ou mauvaises, un guide naturel pour l'homme en matière morale dont la présence est témoignage immédiat de l'existence de Dieu en nous : « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fait l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. »(4).
Colas Duflo
Notes bibliographiques
* Saint Paul, Épitre aux Romains, 2, 14-15, Traduction Œcuménique de la Bible, Livre de Poche, Paris, 1980.
* Cf. saint Augustin, le Libre arbitre, II, 28.
* Thomas d'Aquin, Somme théologique, Ia, Q. 79, art. 13, cité par E. Balibar dans sa préface à John Locke, Identité et différence, L'invention de la conscience, Seuil, Paris, 1998, p. 22.
* Rousseau, J.-J., Émile, L. IV, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, p. 378.
La conscience morale est-elle l'effet des bons sentiments ?
La conscience morale est-elle l'effet des bons sentiments ? Le problème vient de ce que l'expression « bons sentiments » est devenue péjorative – au jugement de la conscience morale, et aussi de l'immoraliste qui, de plus, les met dans le même sac. Le moraliste reproche aux bons sentiments d'ignorer la réalité du mal ; l'immoraliste, d'en ignorer la nécessité, et il va jusqu'à réduire toute conscience morale à ce que la conscience morale réprouve : si la conscience morale est l'effet des bons sentiments, elle vaut autant qu'eux, et il n'y a plus alors de sentiments que l'on puisse qualifier de bons. Mais les bons sentiments sont-ils finalement si mauvais ?
Ce que la conscience, morale ou immorale, reproche aux bons sentiments, n'est-ce pas d'étouffer la conscience sous la morale ? Si la conscience ne veut pas tomber dans ce qu'elle dénonce, elle doit distinguer entre ce que sont les « bons sentiments » et ce qu'il faut en penser.
Exigences des bons sentiments
On peut définir les bons sentiments en trois points : d'abord, ils se donnent pour appréhension immédiate et évidente du bien, inscrit dans la nature bonne de l'homme ; en conséquence, ils agissent directement pour le bien, en obéissant au premier mouvement, sans calcul, sans souci des conséquences, sans hésitation ni remords, sans principes et sans règles. Ainsi, sûrs de leur droit, certains de détenir l'universel dans leur singularité, épris de justification, ils revendiquent l'approbation et la reconnaissance.
Réponse de la conscience morale
Face à cette dernière exigence, la conscience morale est embarrassée. Elle est partagée entre ce qu'elle ne peut accepter et ce à quoi elle ne peut se soustraire. La reconnaissance est en effet un devoir, mais non un droit qu'on puisse exiger d'autrui. Exiger la reconnaissance, quoi de plus immoral ?
Sur tous les points mentionnés, la conscience morale est tentée d'accuser les bons sentiments d'immoralité. D'abord, les bons sentiments ne font de bien qu'à ceux qui les éprouvent. Manquant de force, de prudence et de justice, ils sont versatiles, aveugles, égocentriques. Elle montrera en outre que les trois traits qui les définissent forment une logique de l'impuissance : c'est parce que les bons sentiments font consister la morale dans la seule évidence de la sensibilité subjective qu'ils se heurtent à l'ordre du monde, et que leur déconvenue les réduit à en appeler à l'approbation pour se consoler et se consolider devant les malheurs du monde. En somme, ce que la conscience morale peut reprocher aux bons sentiments, c'est de n'être ni conscients ni moraux.
Le bien, enseigne-t-elle, n'est jamais donné. En matière morale, la conviction d'être du côté du bien est délirante et présomptueuse ; les bons sentiments traitent les symptômes plutôt que les causes, ils sont irréfléchis et potentiellement catastrophiques : sous couvert de bonté, s'arrogeant tous les droits « par humanité », ils font plus de dégâts que les princes de ce monde mus par leur seul intérêt. C'est ainsi, par exemple, que Freud et Bullitt(1) accusent impitoyablement l'idéalisme d'un président américain d'être à l'origine « d'une véritable condamnation à mort de la civilisation européenne » : ils décèlent dans cet idéalisme « la véritable antithèse de la force qui “toujours désire le mal et toujours crée le bien” ». Au reste, la plupart du temps, comme ils se heurtent au cours du monde, qui s'oppose à leurs bonnes intentions, les bons sentiments sont sans efficacité et se retranchent dans une vertu immaculée qui refuse de se compromettre avec la réalité, ne serait-ce que pour la comprendre(2). Ils rabattent la raison sur la conscience du bien : pourquoi alors se fatiguer à comprendre, puisque ce qu'on déplore est autant irrationnel que déraisonnable ? Il ne leur reste plus qu'à s'indigner du mal et à élever le ton devant ceux qui cherchent à connaître les causes des choses et des passions(3). Les bons sentiments sont alors soupçonnés de n'être pas si inconscients qu'on le croit. À la bonne foi apparente se substitue la mauvaise foi revendicative, à l'inconscience réelle, la volonté d'ignorer. Ainsi Sartre(4) montre que, si l'on défend si farouchement l'innocence enfantine, c'est pour charger quelqu'un d'ignorer ce que nous savons et ne voulons pas savoir. Bref, les bons sentiments n'ont qu'une apparence de moralité, ils dissimulent la mauvaise foi, l'hypocrisie et la lâcheté. Les bons sentiments sont devenus de mauvais sentiments.
On le voit : si la conscience morale dérivait des bons sentiments, tels qu'elle les juge, elle serait anéantie. Le bien se réduirait à un sentiment instable et subjectif, la volonté à la velléité, la loi à une généralité.
La reconnaissance de la dette
C'est que le tort des bons sentiments réside dans leur prétention à légiférer immédiatement, à réduire la loi aux mœurs, à confondre le cœur et la raison : ils confondent la véritable universalité avec une généralité consensuelle (se montrant ainsi complices du mal qu'ils combattent) et la justice avec le lynchage (en pourchassant le mal au lieu d'établir le droit). Inconscients des principes, ils peuvent les contredire : « Une certaine tendresse de cœur, écrit Kant(5), qui entre aisément dans un chaud sentiment de pitié, est belle et aimable [...]. Seulement cette passion, née d'un bon naturel, est toutefois faible et toujours aveugle. Car supposez que ce sentiment vous entraîne à secourir à vos frais un indigent, mais que vous ayez une dette à l'égard d'un autre et que vous vous mettiez par là hors d'état de remplir le rigoureux devoir qu'impose la justice... ». Nécessité fait loi, disent les bons sentiments secourables ; nécessité n'est pas vertu, répond la rigoureuse conscience morale.
Remarquons que l'argumentation de Kant suppose que, abstraction faite du motif, l'acquittement de la dette est en toute rigueur supérieure à la bienfaisance envers les indigents, la justice à la charité. Il y a en effet toujours quelque chose d'embarrassant dans la bienfaisance, car, d'une part, celle-ci n'est jamais aussi manifestement morale que la conscience de la dette alors que, d'autre part, la conscience de la dette présuppose de fait l'existence de la bienfaisance.
Les bons sentiments sont en effet essentiellement ceux qui nous poussent à venir en aide aux hommes malheureux, à les soulager de misère, maladie et captivité. Avec la dépendance qui en découle mûrit un autre fruit, moins plaisant : le sentiment de la dette. C'est donc chez ces malheureux qu'apparaît la conscience morale : les bons sentiments ne se métamorphosent pas en conscience chez ceux qui les ont, mais produisent cette conscience chez ceux qui bénéficient de leurs effets. La conscience morale est l'effet des bons sentiments dans la mesure où elle est réponse à leur action.
Quand Nietzsche(6) affirme que « le sentiment du devoir, de l'obligation personnelle, a tiré son origine des plus anciennes et primitives relations entre créancier et débiteur », il observe que nous pouvons nous acquitter du mal que nous avons fait (par le châtiment), mais jamais du bien qu'on nous a fait. La conscience morale n'est pas née du châtiment – qui en a retardé l'apparition –, mais du « bienfait » de la société, dont les hommes ne peuvent plus s'acquitter, dont ils sont devenus définitivement dépendants et redevables. On peut dire que ces analyses répondent à celles de Kant dans la Métaphysique des mœurs. La reconnaissance, lit-on dans la Doctrine de la vertu (§ 32), est l'unique devoir saint, auprès duquel tous les autres devoirs sont simplement ordinaires, c'est-à-dire « un devoir dont la violation peut anéantir (comme exemple scandaleux) le mobile moral de la bienfaisance dans son principe même ». L'obligé demeure en effet toujours obligé : « il n'y a aucun moyen de s'acquitter d'un bienfait reçu parce que celui qui le reçoit ne peut jamais compenser l'avantage du mérite que s'est acquis celui qui a donné, et qui consiste à avoir été le premier à avoir été bienveillant », et cela quelle que soit la nature de son motif(7). La conscience morale est donc bien un effet de la bienfaisance qu'opèrent les bons sentiments, mais un effet qui doit se retourner aussitôt sur son origine, pour la modifier et la moraliser, pour l'empêcher de produire de mauvais effets. Son devoir est de ne pas envenimer les sentiments. Face à leur priorité, la conscience morale n'a pas le droit de protester, affirme Kant. Au lieu de les dénoncer pour leur immoralité potentielle, elle doit faire au contraire comme si les bons sentiments étaient moraux afin d'en prévenir les revendications : elle doit non pas chercher, par la reconnaissance, à augmenter la bienfaisance, mais veiller simplement à ce que celle-ci ne cesse pas d'être bienveillante et agir comme si la bienveillance morale était son unique mobile. La véritable conscience morale n'a pas le droit de supposer que la bienfaisance d'autrui a un mobile autre que moral ; sans cela la moralité ne commencerait jamais. Elle peut bien critiquer en général les bons sentiments, mais ne peut accuser quiconque de « bons sentiments ».
La conscience morale ne doit donc pas être occasion de scandale pour les bons sentiments, qu'il lui faut au contraire cultiver. Si les sentiments, sans conscience, sont aveugles, la conscience coupée des sentiments est vide. C'est parce que la volonté humaine n'est pas sainte (c'est-à-dire toujours tournée vers le bien) que la reconnaissance doit l'être, pour appuyer la moralité sur la confiance en une possible coopération entre les hommes. Il s'agit donc d'éviter que les bons sentiments exigent un retour pour leur bienfaisance, en faisant d'un petit bienfait pour moi un grand bien pour l'humanité.
Jean-Benoît Birck et Ariel Suhamy
Notes bibliographiques
* Freud, S., et Bullitt, W., le Président T. W. Wilson. Un portrait psychologique (1938), trad. M. Tadié, Payot, Paris, 1990, pp. 17 et 446.
* Cf. Hegel, F., La Phénoménologie de l'esprit, « La Loi du cœur et le Délire de la présomption » et « La Vertu et le cours du monde », trad. J. Hyppolite, tome I, Aubier, Paris, 1983, pp. 302-321.
* Cf. Spinoza, B., Éthique, partie I, appendice, et partie III, préface.
* Sartre, J.-P., Vérité et existence, Gallimard, Paris, 1989, pp. 99-101.
* Kant, E., Observations sur le sentiment du beau et du sublime, trad. B. Lortholary, tome I, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1980, pp. 461-462.
* Nietzsche, F., Généalogie de la morale, II, § 8, trad. I. Hildenbrandt et J. Gratien, in Œuvres philosophiques complètes, vol. VII, Gallimard, Paris, 1971, p. 232.
* Cf. Kant, E., Métaphysique des mœurs, Doctrine de la vertu, §§ 29-35, trad. J. et O. Masson, tome III, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1986, pp. 745-752.
* Voir aussi : Jullien, F., Fonder la morale, dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières, Grasset, Paris, 1995, repris sous le titre Dialogue sur la morale, Le Livre de Poche, Paris, 1998.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
moi |
|
|
| |
|
| |

moi
En allemand : Ich, « moi » et « je ».
Le « moi » peut être considéré comme l'unité empirique de toutes les déterminations qui adviennent à l'individu. Il peut également être envisage d'un autre point de vue, comme ce qui constitue l'essence du sujet, désignant de ce fait plutôt l'âme que le corps. Kant tente de résorber cette scission du moi, en montrant que, si nous n'avons de celui-ci qu'une connaissance phénoménale, nous pouvons néanmoins l'unifier par la visée de l'idée transcendantale du « moi ». Cependant, Kant ne parvient à constituer véritablement l'unité du moi empirique et du moi nouménal. Le moi apparaît toujours comme cette étrangeté intérieure, que Rimbaud exprime en disant que « je est un autre ».
Psychanalyse
Formation psychique à qualités conscientes et inconscientes, objet et sujet d'investissements libidinaux, agent dans de multiples fonctions (médiation réalité-pulsions, défenses, liaison, adaptation). Le moi représente l'individu (personnalité et corps), bien qu'il en soit une partie et une projection, et que sa détermination demeure essentiellement ambiguë.
Agent du conflit défensif(1) et organisation stable dont l'investissement inhibe les processus primaires(2), le Moi outrepasse la conscience, dès les premiers écrits freudiens. Néanmoins, il demeure en « première topique » le pôle raisonnable de la personne, agent des pulsions d'auto-conservation, de la perception, de la motilité et du principe de réalité(3). Avec l'introduction du narcissisme(4), il devient investi de libido, et se définit comme une forme (par rapport au morcellement auto-érotique) créée, entre autres, par identifications et trace des relations intersubjectives(5). En 1923(6), le Moi est l'une des trois instances de l'appareil psychique ; il regroupe des fonctions et processus divers, qui confortent son ambiguïté.
Dans l'œuvre freudienne, la notion du Moi se renouvelle et complique par des apports successifs, qui évitent la cohérence et démentent la tradition occidentale d'un Moi unifié et conscient. Pour cette raison les interprétations théoriques divergentes, mais unificatrices (Egopsychology, Self-psychology, Anzieu, Aulagnier, Federn, Lacan), ont pullulé. Les psychoses ainsi que les pathologies de l'agir et du narcissisme réclament de nouveaux développements, remettant au jour les conceptions freudiennes.
Mauricio Fernandez
Notes bibliographiques
* Freud, S., et Breuer, J., Études sur l'hystérie, PUF, Paris, 1956.
* Freud, S., « Esquisse de psychologie », in la Naissance de la psychanalyse, PUF, Paris, 1956.
* Freud, S., « Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques », in Résultat, idées, problèmes I, PUF, Paris, 1984.
* Freud, S., « Pour introduire le narcissisme », in la Vie sexuelle, PUF, Paris, 1969.
* Freud, S., « Psychologie des foules et analyse du moi », in Essais de psychanalyse, Payot, Paris, 1981.
* Freud, S., « Le Moi et le Ça », in Essais de psychanalyse, Payot, Paris, 1981.
→ ça, défense, ego, identification, inconscient, je, liaison / déliaison, narcissisme, principe, processus primaire / secondaire, sujet
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Comment le cerveau élabore-t-il la conscience ? |
|
|
| |
|
| |

CERVEAU ET PSY
Comment le cerveau élabore-t-il la conscience ?
Par Hugo Jalinière le 13.04.2016 à 17h33, mis à jour le 13.04.2016 à 17h33
Le fait d'être conscient procède-t-il d'un phénomène cérébral continu ou discontinu ? Un vaste débat en neurosciences auquel des chercheurs proposent de substituer une troisième voie.
©ALFRED ANWANDER/MAX PLANCK INSTITUTE FOR HUMAN COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES
400 millisecondes, c'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour transformer un stimulus en une perception consciente. Telle est la conclusion d'une étude conduite par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et publiée le 12 avril 2016 dans la revue Plos Biology. L'objet de ces recherches était d'étudier la façon dont on prend conscience d'une information et de tenter de trancher un vaste débat : la conscience procède-t-elle de façon continue ? Ou bien, à la façon d'un cinématographe, par images se succédant très rapidement les unes aux autres et donnant ainsi l'impression d'un flux continu ?
Intuitivement, le fait d'être conscient se caractérise par un état continu de sensations diverses - sons, images, odeurs, mouvements... - traduites simultanément en perceptions conscientes. Sauf que lorsqu'on regarde de plus près le fonctionnement du cerveau, les choses ne sont pas si simples. Pour tenter d'y voir plus clair, le Pr Michael Herzog propose ainsi un nouveau "cadre conceptuel" fondé sur "des données d'expériences psychologiques et comportementales déjà publiées, qui visaient à déterminer si la conscience est continue ou discontinue", notamment par observation de l'activité cérébrale explique l'EPFL dans un communiqué.
Un processus en 2 phases
En collaboration avec Frank Scharnowski de l'Université de Zurich, les chercheurs proposent un modèle en deux phases pour expliquer comment la conscience procède. Face à un stimulus sensoriel, le cerveau commence par analyser de façon inconsciente les détails de l'objet de la sensation (couleur, forme...). Les chercheurs décrivent une sorte de machinerie inconsciente qui ne cesse jamais de traiter les informations sensorielles. Le modèle suggère également que cette phase exclut la perception du temps.
Une fois ce traitement effectué, le cerveau va en quelque sorte livrer son bilan en le rendant conscient. C'est la deuxième phase : "Le cerveau rend simultanément conscients tous les éléments. Cela forme l'image finale que le cerveau présente à notre conscience. En d'autre termes, après ce traitement inconscient nous sommes finalement conscients du stimulus", expliquent les chercheurs. Un processus qui pourrait durer jusqu'à 400 millisecondes donc. Un laps de temps qui paraît ridiculement petit mais qui, "d'un point de vue physiologique, constitue un décalage considérable".
La perception du temps, le chaînon manquant
"Le cerveau veut vous donner l'information la meilleure et la plus claire possible, et cela exige un certain temps, explique Michael Herzog. Il n'y a aucun avantage à vous faire connaître son traitement inconscient, parce que cela serait extrêmement déconcertant", poursuit le chercheur.
Si ce modèle reste hypothétique et devra être mis à l'épreuve dans une étude originale, il a le mérite de voir au-delà du traditionnel débat entre conscience continue ou discontinue. En effet, le modèle ne dit pas que la conscience est interrompue par ces phases de traitement inconscient. L'autre intérêt est d'ouvrir un nouveau champ d'interrogations sur "la façon dont le cerveau traite le temps et le met en relation avec notre perception du monde". La perception du temps comme chaînon manquant de la conscience en quelque sorte.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Jean-Hugues Barthélémy « Quel nouvel humanisme aujourd’hui ? » |
|
|
| |
|
| |
Texte de la 686e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 19 octobre 2008
Jean-Hugues Barthélémy « Quel nouvel humanisme aujourd’hui ? »
Introduction : difficultés propres à un humanisme nouveau
Vous savez tous ce que désigne l’expression « les Lumières » : d’une part elle évoque ces philosophes et savants français qui ont écrit la première Encyclopédie ; d’autre part cette expression dit également, depuis le fameux texte « Qu’est-ce que les Lumières ? » du philosophe allemand Kant, la capacité qu’incarnaient ces philosophes et savants : la capacité à penser par soi-même, dit Kant, c’est-à-dire d’abord à libérer sa pensée de toutes les influences et de toutes les habitudes de pensée ininterrogées qui les accompagnent. Or, la philosophie est aujourd’hui très embarrassée : d’un côté elle sent bien que notre monde actuel manque de sens, sauf à retomber justement dans des idélogies autrefois réconfortantes mais naïves, et qu’ainsi de nouvelles Lumières seraient nécessaires ; et d’un autre côté elle ne croit même plus aux Lumières, devenues elles-mêmes pour ainsi dire une idéologie, parce que la philosophie d’aujourd’hui sait que la « raison universelle » à laquelle croyaient les Lumières françaises - mais aussi l’immense philosophe qu’était Kant – n’était qu’une construction par trop européo-centriste et scientiste à la fois. Explicitons ces deux points :
Européo-centriste, d’abord : les Lumières du 18e siècle n’ont pas su s’affranchir tout à fait de la tendance hégémonique qui caractérisait l’Occident chrétien depuis Christophe Colomb, tendance encore aggravée par la naissance de la science positive occidentale avec la physique de Galilée, dont le potentiel anti-religieux a par ailleurs en effet vite été absorbé par une philosophie cartésienne et post-cartésienne devenue la suprême Sapientia universalis conciliant d’une part la maîtrise scientifique et technique de la nature, et d’autre part la connaissance des valeurs universelles issues du Dieu chrétien et transmises elles aussi jusqu’aux Lumières. Kant, encore lui, a dès lors pu, dans sa réflexion morale, prétendre faire passer au concept ce qui n’était selon lui que le sentiment du devoir de tout homme sur Terre, mais qui était en fait d’abord la fondation philosophique des Dix Commandements.
Scientiste, ensuite : depuis Descartes ici encore, l’idée d’une raison universelle s’autorise de la nécessité mathématique, et l’humanisme qui se rattache à cette raison universelle comme à une essence de l’homme assimile la technique à une simple application des connaissances scientifiques, puisque celles-ci auraient d’emblée pour finalité de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes, Discours de la méthode, 6e partie). Nous savons aujourd’hui que la question d’une essence de l’homme est déjà en tant que telle hautement problématique, et que par ailleurs la technique n’est pas seulement l’application de la connaissance scientifique mais aussi et réciproquement sa condition.
Des philosophes contemporains comme Adorno et Horkheimer, premiers maîtres de la fameuse « école de Francfort », ont même reproché à l’humanisme des Lumières de n’avoir pas su prévenir le mal qui, deux siècles après les Lumières, rongea de l’intérieur la raison occidentale devenue techniquement toute-puissante. Les difficultés propres à l’élaboration d’un nouvel humanisme aujourd’hui sont ainsi liées au fait que le sol même sur lequel reposait l’humanisme des Lumières s’est effondré.
Or, il n’est pas dit que les Lumières et l’humanisme se réduisent à la forme si marquante – historiquement – que leur a donnée le 18e siècle. Car, outre l’universalisme de la raison, un autre trait caractérise les Lumières, qui pourrait bien pour sa part être auto-modifiable – parce qu’auto-transcendant -, et qui pourrait ainsi permettre à ces Lumières de se dépasser en direction d’un humanisme moins naïf, et donc entièrement renouvelé : cet autre trait, c’est bien sûr l’Encyclopédisme. Pour bien comprendre en quoi l’Encyclopédisme est en effet auto-transcendant et donc auto-modifiable, il faut préciser d’emblée deux points :
- D’abord l’encyclopédisme, malgré sa visée globalisante, n’a pas vocation à être un Système du Savoir absolu et définitif comme ont pu en proposer les philosophies de Hegel ou bien même de son élève et adversaire Marx, dans la mesure où justement l’encyclopédisme est une tâche toujours ouverte au devenir des sciences dont il reste à l’écoute. Il ne faut pas confondre en ce sens les Systèmes fermés de la philosophie qui se voulait Science suprême avec le système ouvert de l’encyclopédisme compris comme unification non-scientifique des sciences à qui il manque l’unité. C’est pourquoi je ne peux suivre Peter Sloterdijk lorsque, dans le troisième volet de Sphères, intitulé Ecumes, il rattache le « système encyclopédique » à la « métaphysique classique » . Il serait d’ailleurs aisé de montrer que la critique que fait Sloterdijk du substantialisme de la tradition philosophique a déjà été menée de façon radicale et centrale dès 1958 par un philosophe qui se voulait justement un nouvel encyclopédiste, parce que ce philosophe avait conscience qu’il n’ y a de pensée anti-substantialiste cohérente que par la mise en relation non seulement des choses à l’intérieur d’un domaine de connaissance, mais aussi des domaines entre eux. Ce philosophe, c’est bien sûr Gilbert Simondon, qui est connu d’abord pour son profond et difficile ouvrage Du mode d’existence des objets techniques, mais dont Gilles Deleuze le premier avait compris que c’est en fait sa pensée en général, c’est-à-dire aussi bien son ontologie que sa théorie de la connaissance, et pas seulement sa pensée de la technique, qui faisait rupture. Or, puisqu’il s’agit ici de réhabiliter l’encyclopédisme comme auto-modifiable et donc comme vecteur d’un nouvel humanisme, il convient de remarquer que Sloterdijk lui-même mobilise, certes de façon moins maîtrisée que chez Simondon, de nombreux champs de connaissance, même s’il le fait au sein d’une pensée qu’il reconnaît moins relationnelle que « néo-monadologique », comme il dit, prenant ainsi le risque de retomber dans un substantialisme résiduel.
- Ensuite, et c’est le second point annoncé, cette écoute des sciences qui caractérise l’encyclopédisme ne se confond pas non plus avec le scientisme propre aux Lumières du 18e siècle et plus encore à leurs héritiers positivistes du 19e siècle. Car l’encyclopédisme en tant que tel ne doit pas être jugé comme a été jugé ce premier trait des Lumières que j’ai nommé l’ « universalisme de la raison », qui était pour sa part à la fois européo-centriste et scientiste. L’écoute des sciences qui caractérise l’encyclopédisme comme unification non-scientifique des sciences n’est pas la même chose que l’idée proprement scientiste selon laquelle la philosophie n’aurait son mot à dire que si elle parvenait elle-même à la scientificité. Telle était justement l’idée qui courait, du fait même de l’avènement de la physique mathématique, de Descartes jusqu’à Auguste Comte en passant par les Lumières du 18e siècle et le grand Kant lui-même, qui ouvrait sa Critique de la raison pure en promettant une nouvelle méthode inspirée des sciences physiques et mettant fin au « champ de bataille » philosophique. Que Kant ait voulu par ailleurs limiter la raison dans sa capacité à connaître et mettre fin aux ambitions métaphysiques, cela n’est pas incompatible avec son universalisme scientiste, même si bien sûr cette intuition de la finitude qui fait son génie ouvrait sur les pensées plus contemporaines de la finitude en tant qu’elles doivent venir nourrir de nouvelles Lumières – on pensera ici aussi bien à Heidegger et Derrida qu’à Wittgenstein et Habermas, dans la mesure où c’est avec eux qu’il faut aujourd’hui dialoguer.
Gilbert Simondon, dont l’œuvre est progressivement redécouverte depuis sa mort en 1989, a ainsi pu initier dès 1958 un nouvel encyclopédisme dont la vocation était de rendre possible ces nouvelles Lumières. Mais parce qu’il a, pour ce faire, profondément interrogé et combatu certaines habitudes de pensée des philosophes eux-mêmes, Simondon a posé les bases d’un humanisme qui entendait s’opposer à ce qu’il nommait le « facile humanisme ». C’est pourquoi, dans mon dernier livre Simondon, ou l’Encyclopédisme génétique, j’ai qualifié symétriquement d’ « humanisme difficile » la position et la nouvelle compréhension instaurées par Simondon.
Retour sur la critique de l’ « anthropologie » : Simondon et Heidegger.
Afin de poser la question d’un « humanisme difficile » qui sache remplacer « l’humanisme facile » au lieu de nous laisser dans le vide des anti-humanismes, je voudrais revenir ici sur la question de ce que Simondon nomme, pour la critiquer elle aussi, l’ « anthropologie », ce qui nous permettra de prendre du recul et de positionner Simondon par rapport à Heidegger, qui s’en prenait lui aussi à l’anthropologie comme à l’humanisme. J’aurai par là même l’occasion de prolonger des travaux exégétiques antérieurs relatifs à cette question, que je crois décisive parce que liée à la possibilité d’un nouvel humanisme, par-delà ce qu’il s’agit de repérer comme sol commun à Heidegger et à l’humanisme auquel il s’opposait. En d’autres termes, il s’agira de montrer avec Simondon que les naïvetés de l’humanisme des anciennes Lumières ne peuvent être véritablement dépassées que si l’on modifie la critique adressée par Heidegger à l’anthropologie.
Heidegger, lui, apparaîtra alors comme s’opposant d’autant plus violemment à l’humanisme qu’il partage avec cet humanisme ce que l’on peut nommer une vue « essentialiste ». La position heideggerienne se révélera en définitive une position élitiste, voire aristocratique, qui ne se construit contre l’humanisme qu’au nom d’une sur-humanité en laquelle l’essence de l’homme accèderait à la compréhension d’elle-même. Je précise ici que mon analyse sera philosophique et ne s’appuiera aucunement sur des données historiques concernant les relations de Heidegger au nazisme. Si un penseur aussi obsessionnellement philosophe que Heidegger a pu se laisser tragiquement séduire par Hitler, et donc par la folie destructrice, il convient de rendre compte de la possibilité d’une telle éventualité en partant de la singularité de son interrogation philosophique elle-même, à laquelle l’être même de Heidegger appartenait tout entier. Du moins ne saurait-on réduire cet être de Heidegger, ni au contexte idéologique populaire et populiste de l’époque, ni à un simple opportunisme ou à l’orgueil d’un philosophe-recteur qui se voyait « philosophe d’Etat ».
Avant de préciser ce que Heidegger et Simondon entendent par « anthropologie », je rappelle que ce mot souffre depuis longtemps d’une plurivocité qui favorise les malentendus. Tantôt l’anthropologie est définie comme la dimension la plus ambitieuse de l’ethnologie – c’est le cas par exemple de l’ « anthropologie structurale » de Claude Lévi-strauss -, tantôt elle désigne l’ensemble des sciences de l’homme (anthropos), tantôt enfin elle recouvre l’étude philosophique de l’homme. A vrai dire ces trois sens restent encore au moins potentiellement liés, et la polysémie du mot ne devient définitivement dérangeante qu’avec un quatrième sens : l’anthropologie comme recherche des caractères biologiques qui seraient susceptibles de distinguer l’espèce humaine.
Simondon, lui, définit d’une part l’anthropologie comme cette tendance naïve, inhérente à la tradition philosophique occidentale mais aussi à la psychologie et à la sociologie dans leur séparation réciproque, à couper l’homme du vivant sous prétexte que l’homme aurait pour « essence » tantôt le psychisme – même l’Inconscient freudien reste propre à l’homme sans pour autant intégrer une historicité sociale -, tantôt au contraire la vie sociale – même Marx, qui réciproquement ne pense pas le psychisme et son ancrage animal, sépare en ce point l’homme du simple vivant. Contre quoi Simondon montre, dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, que la réalité humaine est centralement et indissociablement psycho-sociale, le « psychique pur » et le « social pur » n’étant que des « cas-limites », comme dit Simondon. Et cette réalité psycho-sociale de la « personnalité » humaine résulte de l’individuation du potentiel porté par le vivant lui-même, sans donc qu’il y ait une prétendue « coupure anthropologique » entre l’homme et le vivant. L’éthologie actuelle, qui étudie le comportement animal et découvre notamment l’étonnante complexité des grands singes, a depuis donné raison à Simondon, qui écrivait pour sa part il y a déjà un demi-siècle.
A ce premier sens de l’ « anthropologie » se rattache d’autre part pour Simondon un second sens : est également anthropologique la tendance à réduire la technique à son usage par le fonctionnement de l’homme, en vertu du paradigme illusionnant du travail – ici encore Marx, qui a frôlé une véritable pensée de la technique, sera pour cette raison même prioritairement visé par Simondon, dans Du mode d’existence des objets techniques.
Or, il importe ici de comprendre en quoi Heidegger, même s’il refuse lui aussi comme « anthropologique » la réduction de la technique à un ensemble de moyens, ne posera cependant ce refus qu’en restant dans l’anthropologie pour un regard simondonien, comme en témoigne le fait que chez Heidegger « l’essence de la technique ne peut être conduite dans la métamorphose de son destin sans l’aide de l’homme » . Avant d’expliciter ce point relatif à la pensée de la technique, je rappelle que pour ce qui est de la réflexion sur l’homme, Heidegger ne remet pas en question l’idée qu’il y aurait une essence de l’homme, et il ne veut penser le vivant animal que par voie « privative », comme il dit dans son grand livre Sein und Zeit, à partir de l’ « être-au-monde » qui singularise le Dasein comme cette essence de l’homme.
Certes, Heidegger a pour lui une double subtilité : d’une part, dans sa pensée de la technique il distingue la technique et l’essence de la technique, en posant que « l’essence de la technique n’est absolument rien de technique » ; d’autre part, dans sa réflexion sur l’homme il définit très largement l’anthropologie, à laquelle il s’oppose, comme cette pensée qui fait de l’homme un « étant là-devant », définition si large qu’on peut se demander si la perspective simondonienne ne serait pas alors, à son tour, anthropologique.
Examinons donc les deux points, qui nous reconduiront d’eux-mêmes à l’explicitation critique annoncée de la formule heideggerienne rattachant la « métamorphose » du « destin de l’essence de la technique » à l’homme. D’abord, en posant que cette essence de la technique n’est absolument rien de technique, la pensée heideggerienne de la technique ne désanthropologise l’essence de la technique qu’en anthropologisant « le » technique – comme ensemble de moyens auquel ne se ramène justement pas l’essence de la technique. Or, non seulement la subtilité se révèle ici peu économique en hypothèses - puisqu’elle introduit une différence pour ainsi dire interne qu’il s’agirait de justifier -, mais en outre le paradoxe voire la contradiction est que cette différence vise aussi à dire par ailleurs que l’essence de la technique réside dans une volonté de puissance qui n’est pas humainement technique mais…humaine. Où nous retrouvons l’homme comme fondement, ou plutôt son essence si Heidegger distingue l’homme et l’essence de l’homme comme il distingue la technique et l’essence de la technique. Ainsi commence de s’éclairer la formule rattachant la métamorphose du destin de l’essence de la technique à l’homme, mais d’une lumière qui jette sur la pensée heideggerienne un soupçon d’anthropologie résiduelle.
Ensuite, et pour en venir au second point, relatif à la réflexion sur l’homme, Heidegger ne reproche à l’ « anthropologie » de faire de l’homme un « étant là-devant » que parce qu’il accorde à l’homme de ne pas être un étant comme les autres : l’essence de l’homme est l’ « être-là » (Dasein). Plutôt donc que de réserver à l’être en tant qu’être - ou au sens, dirais-je pour ce qui me concerne - de ne pas être ob-jet de connaissance stricte, il accorde ce privilège au Dasein lui-même en tant qu’ « être-là », et il ne rassemble les démarches proprement objectivantes et les philosophies du sujet sous le titre général d’ « anthropologie » qu’en empruntant encore à ces philosophies du sujet le motif qui les anime, et qui fait d’elles, via la pensée mouvante de son ancien maître Husserl, un courant de pensée toujours porté au-delà de lui-même et par là déjà porteur de la discontinuité théorique pourtant revendiquée par Heidegger .
Ainsi s’explique que Heidegger, conscient de ne pouvoir ramener tout à fait les philosophies du sujet à ce sol commun qu’elles étaient censées partager avec les démarches objectivantes, s’en prenne à l’ « humanisme » dont elles sont une expression. Mais en faisant de cet humanisme l’affirmation impensée d’une volonté de puissance qui se retournerait au XXe siècle contre l’homme devenu « fonds » (Bestand) techniquement exploitable, Heidegger entend rattacher encore les philosophies du sujet aux démarches objectivantes, et il se présente comme celui qui redonnera à l’homme la liberté de son destin. Loin donc d’être anti-humaniste au sens habituel du terme, Heidegger procède à une interprétation critique de l’humanisme qui vise à montrer que ce dernier nuit à l’homme dans sa dignité, parce que cet humanisme était l’expression d’une volonté de puissance qui a transformé l’homme lui-même en un « fonds » exploitable. Heidegger plaide ainsi pour une sur-humanité en laquelle l’homme accèderait à la compréhension du privilège métaphysique de son essence, et il ne le fait qu’en se proposant lui-même comme l’homme « à être », dans tous les sens de cette expression. Tel est, pour y revenir une dernière fois, le sens profond de la formule rattachant la métamorphose du destin de la technique à « l’homme », devenu ce « dieu » qui « seul » peut « nous sauver », comme osera l’écrire le prophète Heidegger.
Voilà pourquoi il ne s’agit pas d’inventer une opposition - toujours artificielle, on le voit - à l’humanisme, mais de permettre à ce dernier de se dépasser pour se maintenir, s’il est vrai que l’humanisme est auto-transcendant : comme l’écrit Simondon, « l’humanisme ne peut jamais être une doctrine ni même une attitude qui pourrait se définir une fois pour toutes ; chaque époque doit découvrir son humanisme, en l’orientant vers le danger principal d’aliénation » . Il faut donc prendre garde de ne pas mésinterpréter le propos de Simondon, lorsqu’au seuil de Du mode d’existence des objets techniques il rejette le « facile humanisme » . Car ce rejet ne procède en fait que de l’exigence d’un humanisme difficile , c’est-à-dire un humanisme capable d’une part de faire dériver l’homme du vivant, d’autre part d’intégrer la technique à la culture. Un humanisme , donc, qui n’impliquerait ni la « coupure anthropologique » entre l’homme et l’animal, ni la réduction, elle aussi anthropologique, de la technique à un simple ensemble de moyens pour l’usage de l’homme. Or, nous allons voir que Simondon, en nous expliquant magistralement ce qu’est la technique dans sa technicité, donc dans son fonctionnement et non dans son simple usage, va dévoiler le fait suivant : la nouvelle forme d’aliénation dont l’humanisme lui aussi nouveau doit nous libérer est justement une aliénation dont la cause profonde réside dans le divorce entre la technique, réduite à une simple phase du travail, et la culture, qui n’a pas compris ce qu’est une machine, et quel rôle cette machine doit avoir.
Une nouvelle pensée de la technique
Du mode d’existence des objets techniques, Thèse complémentaire de Simondon pour le Doctorat d’Etat, est incontestablement le classique de l’auteur. Pour autant, il faudrait entrer d’abord dans la Thèse principale de Simondon, c’est-à-dire l’énorme « grand œuvre » du philosophe - intitulé L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information -, pour se donner les moyens de comprendre pleinement l’intention et les concepts de l’ouvrage sur la technique. C’est pourquoi mon livre consacré à Simondon ne commençait pas mais s’achevait par un chapitre sur sa pensée de la technique, malgré le fait que sa géniale ontologie, admirée par Deleuze, et sa théorie de la connaissance ne soient pas aussi connues que cette pensée de la technique.
Dans Du mode d’existence des objets techniques comme dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, il s’agit de penser l’individuation des êtres, comprise comme leur genèse, afin de combattre non seulement l’hylémorphisme qui a dominé d’Aristote à Kant, mais aussi l’ « anthropologie » et son « facile humanisme » . Même si je ne peux ici développer cette compréhension préalable de l’ontologie simondonienne, je rappelle malgré tout rapidement que l’hylémorphisme est la doctrine selon laquelle une réalité individuelle, comme par exemple un animal, est la réunion d’une matière et d’une forme. Simondon montre alors, dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, que d’une part ce schème hylémorphique, dans son origine aristotélicienne, possède pour paradigme conscient la prise de forme technologique, avec l’exemple du moulage de la brique, et que d’autre part ce même schème hylémorphique possède pour paradigme inconscient la relation sociale appauvrie entre celui qui donne l’ordre de mouler la brique et celui qui exécute l’opération, donc chez les Grecs la relation entre le maître et l’esclave qui travaille. Or, dans Du mode d’existence des objets techniques cette fois, Simondon montre que le travail est justement ce qui a servi de paradigme trompeur pour se représenter la technique comme étant seulement un ensemble de moyens au service de l’homme, qui en ferait usage. Simondon s’en prend alors au « facile humanisme » dans la mesure où :
- premièrement, cet humanisme réduit ainsi la technique au statut d’outil pour l’homme ;
- deuxièmement, cet humanisme considère que la technique ne fait pas partie de la culture et qu’elle devient même dangereuse pour l’homme lorsque l’outil devient une machine. C’est pourquoi le « facile humanisme » est volontiers anti-techniciste, de même d’ailleurs que le technicisme est volontiers anti-humaniste.
Je l’ai annoncé, il ne s’agira pas pour Simondon, pourtant défenseur des techniques, de verser dans l’anti-humanisme, mais de montrer que libérer l’homme c’est d’abord et indissociablement libérer la machine. Tel est le sens profond de la « prise de conscience du sens des objets techniques » à laquelle Simondon veut nous conduire, et qui passe par une remise en question de l’alternative ou de l’opposition entre humanisme et technicisme. Comme toujours, donc, Simondon vise à subvertir une opposition : ici, celle entre culture et technique. Et j’ai montré dans mon livre que Simondon, en vertu de son ambition encyclopédique, entend également subvertir cette autre opposition classique qu’est l’opposition entre nature et culture, ainsi que celle, enfin, entre nature et technique.
Que veut dire qu’il faille libérer la machine pour libérer l’homme ? Simondon développe une réponse que je crois particulièrement puissante, et qui engage la totalité de son ouvrage au service du combat nouveau de l’Encyclopédisme renouvelé contre l’aliénation machinique inédite. Tout Encyclopédisme, rappelle Simondon, a visé à libérer l’homme d’une aliénation déterminée, et il s’agit aujourd’hui de combattre une aliénation nouvelle, parce que machinique, par un Encyclopédisme nouveau, parce que génétique. C’est même selon lui une loi du devenir humain que celle selon laquelle « toute invention éthique, technique, scientifique, qui est d’abord un moyen de libération et de redécouverte de l’homme, devient par l’évolution historique un instrument qui se retourne contre sa propre fin et asservit l’homme » .
Je rappelle qu’ « éthique, technique et science » ne sont chez lui rien d’autre que des dimensions ou « phases », comme il dit, de la culture. Ce qu’il importe alors de comprendre, c’est qu’aux yeux de Simondon la culture peut souffrir de son propre retard sur l’une de ses phases. D’où ce propos autrement incompréhensible : « La prise de conscience des modes d’existence des objets techniques doit être effectuée par la pensée philosophique, qui se trouve avoir à remplir dans cette œuvre un devoir analogue à celui qu’elle a joué pour l’abolition de l’esclavage et l’affirmation de la personne humaine » . Loin d’attribuer ici une intentionnalité à la machine, ce qui serait à ses yeux une naïveté, Simondon demande à la culture, par le biais de la philosophie, de dépasser une compréhension de la machine qui conduit, par son retard sur la réalité technique, à une organisation du travail faisant souffrir l’homme lui-même. Nous verrons bientôt plus en détail en quoi c’est en fait le paradigme même du travail, ainsi que je l’ai annoncé, qui nuit à la compréhension de la réalité technique, et donc par ce biais à l’homme dans Restons-en pour l’instant à cette étrange loi du devenir humain affirmée par Simondon. Là où réside le danger croît aussi ce qui sauve, disait le « prophète » Heidegger reprenant Hölderlin, et appliquant son propos à la technique. Simondon, lui, croit lire dans l’histoire humaine que ce qui sauve une époque en aliène une autre, parce que la culture y devient par exemple en retard sur les techniques, comme c’est le cas à son époque et sans doute encore aujourd’hui :
« avant le grand développement des techniques, la culture incorporait à titre de schèmes, de symboles, de qualités, d’analogies, les principaux types de techniques donnant lieu à une expérience vécue. Au contraire, la culture actuelle est la culture ancienne, incorporant comme schèmes dynamiques l’état des techniques artisanales et agricoles des siècles passés. Et ce sont ces schèmes qui servent de médiateurs entre les groupes et leurs chefs, imposant, à cause de leur inadéquation aux techniques, une distorsion fondamentale » .
Ainsi en va-t-il donc des techniques que les Encyclopédistes valorisèrent mais qui conduisent à la machine moderne et, dans l’état hérité de la culture, à son usage « machiniste », dont seul un « nouvel Encyclopédisme » pourra nous désaliéner en permettant à la culture de faire le pas appelé par celui des techniques : « Le XXe siècle cherche un humanisme capable de compenser cette forme d’aliénation qui intervient à l’intérieur même du développement des techniques, par suite de la spécialisation que la société exige et produit » .
Le dialogue central avec Marx.
On l’aura compris, pour Simondon il faut libérer la machine si l’on veut libérer l’homme de l’aliénation machinique : c’est à la culture de comprendre que la machine, objet technique intégré à la culture et non pas étranger à elle, est devenue le véritable « individu technique », qui doit « porter les outils » et permettre ainsi à l’homme de la surveiller et la réparer au lieu d’être son auxiliaire, soumis à son rythme. Dans cette « simple » affirmation tous les grands thèmes de Du mode d’existence des objets techniques sont engagés, en tant que conditions de compréhension de ce qu’elle pose : notamment le thème de l’ « individualisation » des objets techniques, lui-même amené dans la Première Partie de l’ouvrage par celui de la « concrétisation » des objets techniques, mais aussi le thème du travail en tant qu’il est une « phase » de la technique plutôt que l’inverse.
Simondon avait lu Le travail en miettes de Georges Friedmann, où était déjà dénoncée une autre forme d’aliénation que celle privilégiée par les marxistes dans leur combat contre la propriété privée des moyens de production. Friedmann décrivait en effet ce que Simondon nommera l’aliénation psycho-physiologique du travailleur devenu simple auxilaire de la machine. C’est donc en un sens le dialogue avec Marx qui définit le cœur – dans tous les sens du terme - de l’ouvrage de Simondon, puisque ce dialogue, qui s’explicite au début du Chapitre II de la Deuxième Partie de l’ouvrage, donc au centre de l’ouvrage, porte sur la nature de l’aliénation fondamentale moderne dont l’Encyclopédisme génétique, de l’Introduction à la Conclusion de l’ouvrage, se propose de fournir l’antidote en tant que nouvel humanisme qui saurait intégrer cette fois la technique à la culture :
« Cette aliénation saisie par le marxisme comme ayant sa source dans le rapport du travailleur aux moyens de production, ne provient pas seulement, à notre avis, d’un rapport de propriété ou de non-propriété entre le travailleur et les instruments de travail. Sous ce rapport juridique et économique de propriété existe un rapport encore plus profond et plus essentiel, celui de la continuité entre l’individu humain et l’individu technique, ou de la discontinuité entre ces deux êtres. L’aliénation n’apparaît pas seulement parce que l’individu humain qui travaille n’est plus, au XIXe siècle, propriétaire de ses moyens de production alors qu’au XVIIIe siècle l’artisan était propriétaire de ses instruments de production et de ses outils. […] Elle apparaît aussi en dehors de tout rapport collectif aux moyens de production, au niveau proprement individuel, physiologique et psychologique. L’aliénation de l’homme par rapport à la machine n’a pas seulement un sens économico-social ; elle a aussi un sens psycho-physiologique ; la machine ne prolonge plus le schéma corporel, ni pour les ouvriers, ni pour ceux qui possèdent les machines » .
L’ancien humanisme, encore présent dans la pensée marxiste, avait conçu le travail comme le propre de l’homme, et la machine n’était pas considérée comme pouvant devenir le travailleur ou le « porteur d’outils ». Elle n’était pas vue comme le nouvel individu technique. Plus généralement la technique était seulement pensée comme un ensemble de moyens pour l’usage humain. Dès lors, dans les sociétés marxistes comme dans les sociétés capitalistes, le devenir-industriel du travail ne pouvait que déboucher sur le couple homme-machine, et le travail, de son statut libérateur dans le rapport de l’homme à la nature, ne pouvait que devenir aliénant dans le cadre du nouveau couple homme-machine tel qu’il avait été agencé, c’est-à-dire avec un homme qui n’est pas mécanologue mais bien plutôt simple auxilaire de sa machine. Au contraire, « libérer » la machine en lui accordant pleinement le statut d’individu technique, ce serait permettre à l’homme d’accéder à des fonctions qui ne sont plus au-dessous mais au-dessus du rôle de porteur d’outils.
C’est donc ici la conception anthropologique nichée dans la réduction de la technique au travail qui engendre en définitive l’aliénation machinique, et c’est pourquoi Simondon suggérait, par-delà Friedmann cette fois, que « ceux qui possèdent les machines », comme il disait, sont eux aussi, cette fois, aliénés. L’aliénation machinique est donc bien une aliénation culturelle, au sens où c’est la culture elle-même qui y éprouve les conséquences d’une ignorance par laquelle elle s’était définie comme culture du travail
En fait, dès la « Note complémentaire » à L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Simondon avait montré que ni le psychisme ni le collectif ne se réalisent pleinement dans le travail, qui ne participe pas aux conditions de ce qu’il nomme la « transindividualité », c’est-à-dire d’une relation humaine qui permet à l’individuation vitale de se prolonger-dépasser et qui par là réalise notre être psycho-social en obligeant l’individu à s’individuer encore à partir de la ralité pré-individuelle qu’il porte avec lui en tant que « sujet », laquelle entre en communication avec la réalité pré-individuelle portée par les autres sujets. Telle est donc l’individuation transindividuelle, dont l’accomplissement ultime est nommé par Simondon « spiritualité ».
Le travail, lui, est au contraire une relation entre les individus tels qu’ils sont déjà, donc une relation qui ne fait pas appel à leur « charge de nature » pour l’individuer et porter plus loin les sujets. D’autre part le travail est exploitation de la nature par l’homme en tant qu’espèce. Ainsi, selon chacun des deux aspects qui viennent d’être mentionnés, le travail ne rend possible que de l’intra-social dans le rapport à la nature et de l’inter-individuel dans le rapport entre travailleurs, mais pas de la trans-individualité. Or, l’invention technique, elle, relève de la transindividualité. D’où ce passage extraordinaire de la Conclusion de Du mode d’existence des objets techniques, par lequel nous accédons à l’aspect le plus profond de la pensée non-anthropologique de la technique :
« l’objet technique pris selon son essence, c’est-à-dire l’objet technique en tant qu’il a été inventé, pensé et voulu, assumé par un sujet humain, devient le support et le symbole de cette relation que nous voudrions nommer transindividuelle. [...] Par l’intermédiaire de l’objet technique se crée alors une relation interhumaine qui est le modèle de la transindividualité. On peut entendre par là une relation qui ne met pas les individus en rapport au moyen de leur individualité constituée les séparant les uns des autres, ni au moyen de ce qu’il y a d’identique en tout sujet humain, par exemple les formes a priori de la sensibilité, mais au moyen de cette charge de réalité pré-individuelle, de cette charge de nature qui est conservée avec l’être individuel, et qui contient potentiels et virtualité. L’objet qui sort de l’invention technique emporte avec lui quelque chose de l’être qui l’a produit, exprime de cet être ce qui est le moins attaché à un hic et nunc ; on pourrait dire qu’il y a de la nature humaine dans l’être technique, au sens où le mot de nature pourrait être employé pour désigner ce qui reste d’originel, d’antérieur même à l’humanité constituée en l’homme […] Aucune anthropologie qui partirait de l’homme comme être individuel ne peut rendre compte de la relation technique transindividuelle. Le travail conçu comme productif, dans la mesure où il provient de l’individu localisé hic et nunc, ne peut rendre compte de l’être technique inventé ; ce n’est pas l’individu qui invente, c’est le sujet, plus vaste que l’individu, plus riche que lui, et comportant, outre l’individualité de l’être individué, une certaine charge de nature, d’être non individué. Le groupe social de solidarité fonctionnelle, comme la communauté de travail, ne met en relation que les êtres individués » .
Remarquons d’abord qu’en faisant ici de l’objet technique lui-même le support d’une relation fournissant le modèle de cette transindividualité que la Thèse principale de Simondon avait antérieurement pensée comme dernier « régime d’individuation » après les individuations physique puis vitale, la Thèse complémentaire n’entend pourtant pas détacher l’homme de la nature, à la manière de ce que Simondon, dans la Thèse principale, nommait « anthropologie ». C’est bien plutôt parce que l’objet technique est érigé au statut de support que la pensée simondonienne de l’homme échappe à l’anthropologie en ce premier sens. En effet l’objet technique est pour Simondon nature dans l’homme. Non pas donc essence de l’homme, puisque « ce n’est pas à partir d’une essence que l’on peut indiquer ce qu’est l’homme » , mais préindividualité venant du « sujet » tel que l’a défini la Thèse principale, c’est-à-dire comme couple individu-charge préindividuelle. C’est pourquoi Simondon ne peut appliquer à l’objet technique l’expression « nature humaine » qu’en insistant sur le sens non-essentialiste donné ici au mot « nature », pour ainsi dire détaché de ce qui le qualifie puisque la nature « humaine » de l’objet technique est en fait « antérieure même à l’humanité constituée en l’homme ». On le voit, le second sens de la non-anthropologie – la réalité culturelle de la technique - ne contredit pas son premier sens – la dérivation de la culture à partir de la nature -, puisque la technique elle-même prolonge la vie. Il y a là, nous le savons aujourd’hui, une leçon héritée par Simondon à la fois de Leroi-Gourhan et de Canguilhem, leçon que Simondon approfondit et précise par le biais d’une pensée de la transindividualité.
Revenons une dernière fois à ce que j’ai nommé antérieurement le cœur de Du mode d’existence des objets techniques, tel qu’il avait été anticipé, certes de façon bien moins philosophique et systématique, par Georges Friedmann dans Le travail en miettes. Dans ses Sept études sur l’homme et la technique, publiées en 1966, Georges Friedmann prolongera à son tour le propos de Simondon, que Friedmann avait en effet lu entre-temps, en affirmant que l’aliénation machinique n’appartenait pas au seul capitalisme, et il le faisait en revisitant cette fois la pensée de Marx lui-même .
Je voudrais, pour finir, donner la parole à ce maître « à distance » - une distance d’un demi-siècle - qu’est pour moi Simondon, dont je vous ai présenté ici quelques réflexions, mais dont il faudrait montrer en quoi sa pensée est d’un bout à l’autre d’une actualité brûlante, elle qui avait anticipé sur tant de choses, par exemple sur ce qu’on nomme aujourd’hui les « réseaux informatiques ». Mon ami Bernard Stiegler, dans son œuvre extrêmement ambitieuse et complexe consacrée à ce qui fait l’homme et ce qui le menace aujourd’hui, fait d’ailleurs un usage explicite et constant de Simondon. L’Introduction de Du mode d’existence des objets techniques, que je voudrais donc citer en guise de conclusion aujourd’hui, posait ces lignes désormais célèbres :
« La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture. La culture est déséquilibrée parce qu’elle reconnaît certains objets, comme l’objet esthétique, et leur accorde droit de cité dans le monde des significations, tandis qu’elle refoule d’autres objets, et en particulier les objets techniques, dans le monde sans structure de ce qui ne possède pas de significations, mais seulement un usage, une fonction utile. Devant ce refus défensif, prononcé par une culture partielle, les hommes qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à justifier leur jugement en donnant à l’objet technique le seul statut actuellement valorisé en dehors de celui de l’objet esthétique, celui de l’objet sacré. Alors naît un technicisme intempérant qui n’est qu’une idolâtrie de la machine et, à travers cette idolâtrie, par le moyen d’une identification, une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel » .
Ces dernières lignes nous reconduisent à cet autre dialogue qui, à l’instar de celui avec Marx, traverse la Thèse complémentaire de Simondon mais aussi, déjà, sa Thèse principale : je veux bien sûr parler du dialogue avec cette vision technicienne du monde qu’est la cybernétique, refuge d’un certain nombre de « technicistes intempérants », comme les appelait ici Simondon, et inspiratrice de ce qu’il nommera le « mythe » de l’ « automate parfait ».
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
