|
|
|
|
 |
|
L’Afrique, berceau du genre Homo |
|
|
| |
|
| |
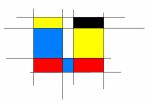
L’Afrique, berceau du genre Homo
28.07.2025, par Kheira Bettayeb
Temps de lecture : 11 minutes
Reconstitution du spécimen d’Homo ergaster surnommé Turkana Boy.
Sylvain Entressangle, sculpture Elisabeth Daynes / LookatSciences
Série d’été « Homo avant Sapiens » 2/6 – Il y a environ 7 millions d’années, en Afrique, la lignée humaine se serait séparée de celle des chimpanzés. Mais que sait-on de l’émergence du genre Homo, de son évolution et de ses migrations avant l’apparition de Sapiens ?
Cet article est paru à l'origine dans la revue Carnets de science n° 17
D’où venons-nous ? Pour répondre à cette grande question, il est crucial de comprendre les débuts du genre Homo, auquel appartient notre propre espèce, Homo sapiens, mais aussi plusieurs autres aujourd’hui toutes éteintes. Malgré les données accumulées ces dernières années, l’histoire de nos origines reste parsemée de nombreuses zones d’ombre. Cela dit, les paléoanthropologues ont déjà plusieurs éléments de réponse intéressants.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
La fusion nucléaire |
|
|
| |
|
| |
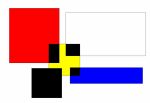
LA FUSION NUCLÉAIRE
La fusion nucléaire (ou thermonucléaire) est une réaction nucléaire dans laquelle deux noyaux atomiques s’assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est à l’œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'Univers, dans lesquelles sont créés tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium. Elle est, avec la fission nucléaire, l’un des deux principaux types de réactions nucléaires appliquées.
La fusion nucléaire dégage une quantité d’énergie colossale par unité de masse, provenant de l’attraction entre les nucléons due à l’interaction forte (voir énergie de liaison nucléaire). La masse du ou des produits d'une réaction de fusion étant inférieure à la somme des masses des noyaux fusionnés, la différence est transformée en énergie cinétique (puis en chaleur) selon la formule d'Einstein E = mc2.
La fusion nucléaire est utilisée dans les bombes H et, de façon plus anecdotique, dans les générateurs de neutrons. Elle pourrait être utilisée pour la production d'électricité, pour laquelle elle présente deux intérêts majeurs :
• la disponibilité de son « combustible » :
• le deutérium, présent à l'état naturel en quantités importantes dans les océans,
• le tritium (pour la réaction de fusion « deutérium + tritium »), qui peut être produit par bombardement neutronique du lithium 6. Les réserves mondiales en minerai de lithium suffiraient théoriquement à garantir plus d'un million d'années de fonctionnement ;
• son caractère essentiellement « propre » : les produits de la fusion eux-mêmes (principalement de l’hélium 4) ne sont pas radioactifs. Les déchets potentiels se limitent, lorsque la réaction utilisée émet des neutrons rapides, aux matériaux environnants, qui peuvent capturer ces neutrons et devenir à leur tour des isotopes radioactifs.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT wikipédia LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
humanisme |
|
|
| |
|
| |
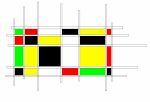
humanisme
Consulter aussi dans le dictionnaire : humanisme
Cet article fait partie du dossier consacré à la Renaissance.
Mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe du xvie siècle et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes antiques.
HISTOIRE ET LITTÉRATURE
1. UN TERME À LA MULTIPLE ET FÉCONDE AMBIGUÏTÉ
Le terme d'humanisme est l'un de ceux sur le sens desquels personne ou à peu près ne s'entend vraiment. C'est que le mot se trouve lié à l'évolution de la pensée occidentale, tout au long de plusieurs siècles de culture et d'histoire, comme en témoignent les emplois successifs des termes humanitas, humances, humain, humanité, humanisme, tous inséparablement liés.
En latin déjà, humanitas désigne ce qui distingue l'homme de toutes les autres créatures, ce qui, donc, est précisément le propre de l'homme, la culture.
1.1. LE MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge, on appelle humaniores litterae les connaissances profanes, telles qu'elles sont apprises dans les facultés des arts (notre actuel enseignement du second degré), qui ouvrent elles-mêmes accès aux facultés – de rang élevé – où l'on enseigne le droit ou la médecine. Elles se distinguent ainsi des diviniores litterae (lettres divines) : commentaires de la Bible, science de la religion chrétienne qui relèvent des éminentes facultés de théologie.
1.2. LE XVIe SIÈCLE
Cette expression de lettres humaines se trouve encore employée au xvie siècle (Rabelais, Amyot) pour marquer la différence – qui n'implique pas opposition – entre la culture sacrée et un enseignement non religieux, dans lequel les littératures antiques sont venues s'ajouter à l'essentiel des disciplines scolastiques du curriculum médiéval.
Ce retour aux textes classiques, enseignés comme un complément nécessaire aux études de théologie qui, alors, sont les seules à compter vraiment, les écrivains du temps le nomment instauratio, restauratio, restitutio bonarum litterarum (établissement, rétablissement, remise en honneur des bonnes lettres). Certains, usant d'un style plus liturgique et plus imagé, parlent de reflorescentia (nouvelle floraison), renascentia (renaissance).
François Rabelais
D'autres reprennent au latin le mot humanitas, que Rabelais traduit, en 1532, pour faire éclater dans le Pantagruel la fameuse formule lettres d'humanité, par laquelle il célèbre les littératures grecque et latine, envisagées comme un instrument d'éducation morale, à la fois philologie et philosophie, docte érudition et sagesse prudente. Aux érudits, nourris de ces lettres d'humanité, s'appliquera bientôt le nom d'humaniste (peu employé, il est vrai, en France au xvie siècle). Par leur culture littéraire et encyclopédique, ils se différencient des spécialistes étroits, ceux des questions juridiques, par exemple, et des théologiens, préoccupés des seules questions de la foi.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Sibérie |
|
|
| |
|
| |

Sibérie
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Asie.
Lac Baïkal
Partie nord-est de l'Asie, entre l'Oural et le Pacifique.
Au sens traditionnel du terme, la Sibérie, presque exclusivement russe (→ Russie), s'étend de l'Oural à l'océan Pacifique, entre l'océan Arctique au N., et la frontière avec la Mongolie et la Chine et débordant au Kazakhstan au S. (près de 13 millions de km2, environ 25 fois la France). Elle regroupe environ 25 millions d'habitants. Au sens restreint, la Sibérie comprend les régions économiques de Sibérie occidentale et de Sibérie orientale, les régions bordières de l'océan Pacifique formant l'Extrême-Orient russe.
GÉOGRAPHIE
Espace périphérique, éloigné des centres vitaux de la Russie d'Europe, la Sibérie subit le double handicap de l'étendue (7 500 km de Tcheliabinsk à Vladivostok) et des milieux bioclimatiques hostiles à l'homme. Le nombre de fuseaux horaires (huit), la durée des voyages (notamment par le Transsibérien) donnent une idée plus concrète encore de cet espace. Espace stratégique, elle recèle la plus grande partie des réserves énergétiques et minérales de la Russie, dont la mobilisation constitue un facteur déterminant de la puissance économique russe. La mise en valeur se heurte à l'insuffisance du peuplement, aux contraintes de l'environnement géographique et des distances qui renchérissent les coûts de production et de transport et impliquent la mise au point de techniques et d'équipements spécifiques.
1. LE MILIEU
1.1. LE RELIEF
La Sibérie est montagneuse. Sans doute, le bassin de l'Ob est-il un immense marécage, mais ailleurs s'élèvent des montagnes. Ainsi, au sud, l'Altaï, qui dépasse 4 000 m, et les monts Saïan, plus modestes, sont des massifs anciens, rajeunis au cénozoïque. Ces montagnes ont gardé des forêts de résineux, des minerais non ferreux et d'alliage ; le Kouzbass s'étend à leur pied. Elles possèdent dans leur partie la plus élevée de beaux bassins de steppe d'altitude et des réserves de bois inexploitées.
À l'est du lac Baïkal, qui trace dans l'écorce terrestre une cicatrice de près de 2 000 m de profondeur, s'allongent des arcs élevés, plus ou moins moulés sur le bouclier de l'Angara : ainsi, vers l'est, les monts Iablonovyï, les monts Stanovoï, les chaînes de Verkhoïansk, et au nord-est celles qui constituent la presqu'île des Tchouktches. Les altitudes se tiennent entre 2 000 et 3 000 m.
En Sibérie centrale, le bouclier de l'Angara représente une boursouflure assez négligeable sur le plan orographique. Il est entouré de bassins houillers, de chaînes bien moulées sur la forme du bouclier, creusées de gorges superbes qui rendent le relief très accidenté.
Enfin, en Extrême-Orient, les plis de l'île de Sakhaline, les îles Kouriles, le Kamtchatka appartiennent au nord de la Ceinture de feu du Pacifique, où le volcanisme est loin d'être éteint, trait original en Russie.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
