|
|
|
|
 |
|
Une thérapie génique prometteuse dans le traitement d’une maladie musculaire génétique rare |
|
|
| |
|
| |

Une thérapie génique prometteuse dans le traitement d’une maladie musculaire génétique rare
12 Juin 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Génétique, génomique et bio-informatique
Des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Strasbourg, au sein de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), ont réalisé une avancée majeure dans le traitement d’une maladie musculaire génétique grave pour laquelle il n’existe actuellement aucune thérapie, la myopathie centronucléaire liée à la mutation du gène BIN1. Leur étude, publiée dans Molecular Therapy, identifie pour la première fois une thérapie génique capable non seulement de prévenir totalement, mais aussi d’inverser la progression de cette maladie rare dans un modèle murin. Des résultats prometteurs qui sont un pas de plus dans l’identification d’un potentiel traitement chez l’humain.
Les myopathies congénitales sont des maladies musculaires génétiques rares dont les symptômes et la sévérité varient selon la nature du gène impliqué. Parmi elles, les myopathies centronucléaires sont caractérisées par une atteinte musculaire qui progresse avec le temps, causée par des anomalies de la structure interne des cellules des muscles squelettiques. Des mutations du gène BIN1, essentiel à l’adaptation des cellules à leur environnement et à l’organisation des fibres musculaires, sont responsables d’une part importante des cas de cette maladie.
À Strasbourg, une équipe de recherche menée par Jocelyn Laporte, directeur de recherche Inserm, s’intéresse tout particulièrement à l’étude des mutations du gène BIN1 dans la maladie avec l’objectif d’en comprendre les mécanismes et d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Fani Koukouli : cibler les interneurones pour traiter les maladies du cerveau |
|
|
| |
|
| |
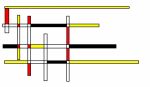
Fani Koukouli : cibler les interneurones pour traiter les maladies du cerveau
PUBLIÉ LE : 05/08/2025 TEMPS DE LECTURE : 4 MIN PORTRAITS
Il existe dans le cerveau des cellules peu nombreuses mais essentielles à la régulation des réseaux de neurones : on les appelle les interneurones inhibiteurs. Lorsqu’ils dysfonctionnent, ces « postes de contrôle » favorisent l’apparition de maladies psychiatriques ou neurodégénératives. Fani Koukouli étudie leur fonctionnement, avec l’objectif de mettre au point de nouveaux traitements.
?
Fani Koukouli est chercheuse Inserm à l’Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (IPNP, unité 1266 Inserm/Université Paris-Cité).
À première vue, la schizophrénie et la maladie d’Alzheimer sont deux pathologies très différentes : la première apparaît généralement au début de la vie adulte, tandis que la seconde touche les personnes âgées. La première se manifeste d’abord par des hallucinations ou des délires, alors que la seconde est en premier lieu associée à des troubles de la mémoire. Pourtant, elles ont un point commun : toutes deux peuvent être liées au dysfonctionnement d’un groupe de neurones particuliers, les interneurones. Ces cellules nerveuses minoritaires dans le cerveau ont des propriétés inhibitrices très importantes pour le bon équilibre des circuits neuronaux locaux, notamment ceux du cortex préfrontal qui sont associés aux fonctions cognitives supérieures (langage, raisonnement, mémoire de travail…). C’est à ces interneurones que Fani Koukouli, chercheuse Inserm, dédie sa carrière de scientifique depuis son doctorat en neurosciences, conduit à l’Institut Pasteur. « Mon travail visait alors à comprendre le rôle de la nicotine sur l’activité du cerveau. J’ai montré que cette molécule peut moduler localement l’activation ou l’inhibition des neurones du cortex préfrontal. Plus précisément, la nicotine se lie à des récepteurs présents sur les interneurones et modifie ainsi leur activité. Par ailleurs, j’ai observé une sous-activation corticale chez les souris dont les récepteurs nicotiniques portent une mutation qui prédispose les humains à la dépendance à la nicotine et à la schizophrénie, relate la chercheuse. Chez la souris, il est possible de rétablir une activité normale du cortex préfrontal en modulant l’activation des récepteurs nicotiniques mutés. On peut penser qu’il pourrait en être de même chez les patients porteurs de la mutation. »
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Le cervelet : chef d’orchestre méconnu du temps cérébral |
|
|
| |
|
| |
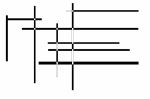
Le cervelet : chef d’orchestre méconnu du temps cérébral
02.07.2025, par Tanguy Sourd pour le CNRS Alsace
Mis à jour le 17.07.2025
Le neuroscientifique Philippe Isope explore les secrets du cervelet, ce « petit cerveau » qui, en synchronisant notre corps et notre esprit, s'avère indispensable à nos fonctions motrices et cognitives.
Quel est le point commun entre rattraper une balle de tennis lancée à vive allure, synchroniser nos dix doigts au piano, ou maintenir notre équilibre sur une surface instable ? Tous ces exploits impliquent le cervelet, et plus précisément sa remarquable capacité à contrôler nos actions et gérer le temps. Dans son laboratoire, à Strasbourg, Philippe Isope explore les secrets de ce « petit cerveau » qui synchronise notre corps et notre esprit à la milliseconde près. Véritable maître du temps, il s’avère indispensable à bien de nos fonctions motrices et cognitives.
Si le rôle du cervelet dans la coordination motrice est connu de longue date – il fut même longtemps cantonné à cette unique fonction –, les neurosciences révèlent aujourd’hui une dimension plus fondamentale et surprenante : ce « petit cerveau » est avant tout un calculateur temporel exceptionnel.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Découverte du mécanisme cérébral impliqué dans la réponse face au danger |
|
|
| |
|
| |

Découverte du mécanisme cérébral impliqué dans la réponse face au danger
29 Juil 2021 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Cellules neuronales/ Onimate © Adobe Stock
Chez l’humain et l’animal, la réponse défensive est un mécanisme de notre cerveau qui nous permet de réagir efficacement face à un danger. L’une des principales réponse défensive est l’évitement. Mais l’évitement excessif en l’absence de menace réelle est un marqueur de pathologies liées à l’anxiété, et les mécanismes neuronaux qui en sont à l’origine sont encore mal compris. Une équipe de chercheurs de l’Inserm et de l’Université de Bordeaux au Neurocentre Magendie a récemment révélé l’interdépendance de deux régions du cerveau, l’amygdale basolatérale et le cortex préfrontal dorsomédial, dans ce mécanisme. Ces nouvelles données, publiées dans la revue Nature, permettent d’ouvrir de nouvelles pistes pour traiter les patients atteints de troubles de l’anxiété, en ciblant directement les régions du cerveau qui en sont à l’origine.
Lorsqu’un danger est proche, on retrouve chez l’humain et l’animal un mécanisme d’évitement, qui lui permet de prendre la fuite pour se protéger. Chez certaines personnes, cette réponse défensive est disproportionnée, se produit en dehors de tout danger et est symptomatique d’un trouble de l’anxiété. Connaître les mécanismes du cerveau qui sont à l’origine de cette réaction est crucial pour ouvrir des pistes thérapeutiques durables et efficaces sur les patients atteints de ces troubles.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] - Suivante |
|
|
|
|
|
|
