|
|
|
|
 |
|
MAGNESIUM |
|
|
| |
|
| |

Magnesium
Indications
Prévenir certains troubles cardiovasculaires.
Prévenir le diabète de type 2 et ses complications; soulager les symptômes du syndrome prémenstruel.
Prévenir les crises d’asthme; soulager les symptômes de la migraine; prévenir la récurrence des calculs rénaux; améliorer les performances sportives; contribuer à la prévention de l’ostéoporose; soulager les crampes dans les jambes durant la grossesse; traiter le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH).
Note. Le magnésium possède d'autres usages thérapeutiques reconnus ou potentiels qui relèvent d'un suivi médical spécifique. Par exemple, il est employé en injections intraveineuses ou intramusculaires pour l’éclampsie et la prééclampsie, le tétanos, les troubles du rythme cardiaque, la neuropathie associée au cancer, etc., bien que son efficacité ne soit pas nécessairement démontrée pour tous ces usages. Il est aussi utilisé comme laxatif et est l’un des ingrédients des médicaments antiacides en vente libre.
Note. L’utilisation du sulfate de magnésium (sel d'Epsom) et de l'hydroxyde de magnésium (lait de magnésie) comme laxatifs n’est pas abordée dans cette fiche.
Posologie du magnésium
Protection cardiovasculaire
* Consommer chaque jour des aliments riches en magnésium, comme des céréales entières, des noix, des graines, des légumineuses et des légumes à feuilles vert foncé. Voir le tableau des apports nutritionnels recommandés ci-dessous.
* En cas de présence d’un facteur de risque (résistance à l’insuline, syndrome métabolique, diabète de type 2, antécédent familial de maladies cardiovasculaires, par exemple), si les mesures alimentaires ne suffisent pas, prendre, avec un repas, un supplément fournissant 300 mg de magnésium.
* En cas d’hypertension, commencer avec un dosage de 300 mg par jour, avec un repas. Si nécessaire, on peut augmenter le dosage jusqu’à 1 000 mg par jour, en doses divisées.
En cas de présence de facteurs de risque ou de maladie diabétique ou cardiovasculaire, un suivi par un professionnel de la santé est nécessaire.
Syndrome prémenstruel
* Prendre, avec un repas, un supplément fournissant 300 mg de magnésium. Si après 2 mois, les résultats ne sont pas significatifs, prendre 300 mg 2 fois par jour.
En cas de supplémentation, il est préférable de diviser les doses et de les prendre avec un repas afin de réduire les risques de diarrhée (le magnésium a un effet laxatif) : ne pas excéder 350 mg par dose. Privilégier le gluconate, le citrate ou le chlorure de magnésium, car ces suppléments sont moins susceptibles de provoquer la diarrhée et constituent une source de magnésium plus assimilable que les autres formes. Consulter la section Sur les tablettes pour en savoir davantage sur les différents sels de magnésium.
Apport nutritionnel recommandé en magnésium
Âge mg/jour
de 1 à 3 ans 80
de 3 à 8 ans 130
de 9 à 13 ans 240
Garçon, de 14 à 18 ans 410
Fille, de 14 à 18 ans 360
Homme, de 19 à 30 ans 400
Femme, de 19 à 30 ans 310
Homme, 31 ans et plus 420
Femme, 31 ans et plus 320
Femme enceinte 18 ans et moins : 400
de 19 à 30 ans : 350
31 ans et plus : 360
Femme qui allaite 18 ans et moins : 360
de 19 à 30 ans : 310
31 ans et plus : 320
Source : Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride, 1997, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board.
Ces données sont le résultat d'un consensus entre les autorités canadiennes et américaines qui ont entrepris une démarche d'uniformisation des apports nutritionnels recommandés (ANR).
Description du magnésium
Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme humain. Il participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Il agit en association étroite avec le sodium, le potassium et le calcium, avec lesquels il doit rester en équilibre dans l’organisme. Environ la moitié du magnésium corporel se trouve dans les os et les dents, tandis que le reste est localisé dans les muscles, le foie et d’autres tissus mous. Il est éliminé par les reins.
Le magnésium contribue notamment à la transmission nerveuse et à la relaxation musculaire après la contraction, ce qui est vital pour la fonction cardiaque. Il est essentiel au maintien d’un rythme cardiaque régulier, au métabolisme des lipides, ainsi qu’à la régulation du taux de sucre sanguin et de la tension artérielle. Par son action relaxante sur les muscles lisses, dilatante sur les vaisseaux et normalisatrice sur la conduction nerveuse, le magnésium peut notamment jouer un rôle dans le soulagement des douleurs associées au syndrome prémenstruel, aux menstruations et aux migraines, par exemple (voir la section Recherches).
Sources alimentaires de magnésium
Les légumineuses, les graines, les noix, les grains entiers, le germe de blé, les légumes à feuilles vert foncé et la levure de bière sont de bonnes sources de magnésium. Noter que le raffinage, notamment celui des céréales, ainsi que la transformation des aliments réduisent beaucoup leur teneur en ce précieux minéral.
Aliments Portions Magnésium
Haricots de soya rôtis à sec 250 ml (1 tasse) 414 mg
Chocolat à cuisson, mi-sucré ou mi- amer 125 ml (1/2 tasse) 103-228 mg
Haricots noirs ou blancs, haricots de lima, cuits 250 ml (1 tasse) 127-191 mg
Noix du Brésil déshydratées 60 ml (1/4 tasse) 133 mg
Céréales à déjeuner, 100 % son (type All bran) 30 g 111 mg
Amandes rôties dans l’huile ou à sec 60 ml (1/4 tasse) 99-109 mg
Flétan de l’Atlantique cuit au four 100 g (3 ½ oz) 107 mg
Noix de cajous rôties à sec ou dans l’huile 60 ml (1/4 tasse) 90 mg
Noix de pin (pignons) déshydratées 60 ml (1/4 tasse) 86 mg
Goberge de l’Atlantique grillée au four 100 g (3 ½ oz) 86 mg
Noix mélangées, incluant des arachides, rôties 60 ml (1/4 tasse) 85 mg
Épinards bouillis 125 ml (1/2 tasse) 83 mg
Artichauts bouillis 1 moyen (125 g) 72 mg
Source : Santé Canada, Fichier canadien sur les éléments nutritifs, versions 2001b et 2005 et ministère de l'Agriculture des États-Unis(USDA), National Nutrient Database for Standard Reference.
Carence en magnésium
Des données européennes et nord-américaines indiquent que les apports alimentaires en magnésium sont souvent en deçà des apports nutritionnels recommandés1,2. En Amérique du Nord, ce sont les personnes à la peau noire et les personnes âgées qui ont le régime alimentaire le moins riche en magnésium.
En général, la carence en magnésium est difficile à diagnostiquer, car elle n’entraîne pas de symptômes évidents et la quantité de magnésium dans l’organisme est difficile à mesurer, même par une prise de sang. Cependant, les experts s’inquiètent des conséquences de réserves insuffisantes en magnésium dans l’organisme (voir la section Recherches).
En plus d’un apport alimentaire insuffisant, d’autres causes peuvent entraîner une carence en magnésium :
* Prise à long terme de certains médicaments qui augmentent les pertes en magnésium dans l’urine : diurétiques de l’anse (furosémide) et diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide, par exemple); antibiotiques (dentamicine, amphotéricine) et cyclosporine (immunosuppresseur).
* Mauvaise absorption intestinale du magnésium causée par la maladie de Crohn, la maladie coeliaque ou une chirurgie intestinale, par exemple.
* Alcoolisme.
* Prise de contraceptifs oraux, d’oestrogènes et de cisplatine (médicament anticancéreux).
* Consommation excessive d’autres suppléments minéraux. Les minéraux interagissent les uns avec les autres et un excès de manganèse ou de potassium, par exemple, peut entraîner une carence en magnésium.
Les suppléments de calcium peuvent diminuer l’absorption du magnésium, mais ne semblent pas avoir d’effet sur les réserves et les taux sanguins de magnésium. Jusqu’à présent, aucun cas de carence en magnésium n’a été rapporté à la suite de la prise de suppléments de calcium.
Les premiers symptômes d’une déficience en magnésium sont une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la fatigue et de la faiblesse. Si la carence s’aggrave, les symptômes suivants peuvent survenir : engourdissements, contractions et crampes musculaires, irrégularité du rythme cardiaque et spasmes coronariens.
Historique du magnésium
Le mot « magnésium » vient du nom de la ville grecque Magnesia, dans les environs de laquelle se trouvaient d’importants dépôts de carbonate de magnésium. En 1810, un chimiste britannique du nom de Sir Humphrey Davy a isolé le magnésium et, en 1926, un chercheur français a prouvé, grâce à des essais sur des animaux de laboratoire, qu'il s'agissait d'un minéral essentiel.
Recherches sur le magnésium
Maladies cardiovasculaires. Des enquêtes épidémiologiques ont permis d’établir une relation inversement proportionnelle entre le taux de magnésium dans le sang (magnésémie) et le risque de souffrir de troubles cardiovasculaires3,4. En d’autres termes, un déficit chronique en magnésium (hypomagnésémie) exposerait à un plus grand risque de maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne,5, l’accident vasculaire cérébral (AVC)6 et l’hypertension12.
Par contre, les bienfaits d’un apport nutritionnel en magnésium, égal ou légèrement supérieur à celui recommandé, sont difficiles à quantifier. Ils sont probablement modestes chez des personnes qui n’ont pas de carence en magnésium6,16,74,75.
D’autres études99 ont rapporté que l’injection intraveineuse de magnésium réduirait l’incidence de la fibrillation auriculaire (la plus fréquente des troubles du rythme cardiaque), avec cependant une faible efficacité. De plus, l’apport de magnésium ne réduit pas la durée d’hospitalisation. Enfin, Les données sont insuffisantes pour affirmer que le magnésium réduit ou non le risque d’AVC.
Des études cliniques indiquent que l’administration d’un supplément de magnésium peut améliorer la capacité à l’exercice de sujets souffrant de maladie coronarienne8,9,76 ou avoir un effet antithrombotique10. Cette supplémentation est aussi importante chez les patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque et qui sont traités avec des diurétiques, car cette médication entraîne une perte de magnésium11.
Le magnésium contribuerait aussi à la prévention de l’athérosclérose, en réduisant l’absorption intestinale des lipides au moment des repas77 et en augmentant le taux de bon cholestérol (HDL)78.
Chez les personnes souffrant d’hypertension, une supplémentation en magnésium permet d’abaisser la tension artérielle15,79,80. Par ailleurs, les effets du magnésium sont suffisamment probants pour qu’en Amérique du Nord, les autorités médicales recommandent un apport alimentaire élevé en magnésium pour prévenir et traiter l’hypertension13, notamment par l’adoption du régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)14.
L’auteur d’une synthèse parue en 2004 recommande un suivi serré du taux de magnésium des patients à risque de maladies cardiovasculaires, ainsi que la supplémentation pour prévenir ces troubles et leur récurrence12. En considérant l’ensemble des données cliniques, il semble que le magnésium soit plus bénéfique en prévention qu’en traitement de plusieurs maladies cardiovasculaires. Plusieurs auteurs notent d’ailleurs qu’étant donné le faible coût, la facilité d’administration et la grande innocuité du supplément de magnésium, sa prise devrait être encouragée auprès des patients à risque de maladies cardiovasculaires.
Déficience en magnésium. Un manque de magnésium est fréquent chez les personnes âgées, notamment chez celles placées en institution. Ce manque peut être provoqué par une réduction de l’absorption de magnésium, une perte urinaire accrue ou certaines maladies (ex. résistance à l’insuline). Certains auteurs100 suggèrent que la prise orale de magnésium, à des doses physiologiques, pallierait cette carence.
Diabète. Les études épidémiologiques indiquent qu’il existe un lien entre un faible apport nutritionnel en magnésium et l’incidence du diabète de type 218-21,84,85. De plus, la diminution du taux de magnésium sanguin (hypomagnésémie) augmente la résistance à l’insuline, un trouble avant-coureur du diabète22, 23. Certaines complications du diabète de type 2 (neuropathie, ulcères aux pieds) sont également associées à une carence en magnésium25.
Si le magnésium semble contribuer à la prévention du diabète, son utilité dans le traitement de la maladie reste controversée24. Néanmoins, selon une méta-analyse récente, les suppléments de magnésium réduiraient la glycémie de diabétiques de type 2 et augmenteraient le taux des HDL (bon cholestérol), de façon significative78. Les résultats divergents, auxquels arrivent les études cliniques, peuvent s’expliquer en partie par les différences entre les sels de magnésium utilisés, leur dosage et les taux initiaux de magnésium des participants24,86 .
Les chercheurs ont également observé une tendance à la carence en magnésium chez les personnes souffrant de diabète de type 1 et une étude récente démontre que l’hypomagnésémie chez ces patients engendre un épaississement de la paroi des vaisseaux, causant ainsi une athérosclérose précoce26. Des essais préliminaires permettent de supposer que la supplémentation en magnésium pourrait, dans le cas du diabète de type 1, contribuer à augmenter la sensibilité à l’insuline et à réduire les risques de complications27-29.
Syndrome prémenstruel (SPM) et douleurs menstruelles. Par rapport à des personnes en bonne santé, les personnes souffrant de syndrome prémenstruel ont un rapport magnésium/calcium sanguin, plus faible. Les chercheurs pensent que ce déséquilibre joue un rôle important dans le SPM, notamment dans les changements de l’humeur30 qui le caractérisent.
Les résultats d’études cliniques indiquent que le magnésium pourrait atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel31-35, s’il est combiné avec la vitamine B636. Une synthèse récente suggère également que la nature du sel de magnésium joue un rôle, car des effets ont été observés avec le pidolate de magnésium, mais pas avec l’oxyde de magnésium87.
Au cours de deux études publiées en 1989 et en 1990, le magnésium a atténué plusieurs symptômes de la dysménorrhée37,38. D’autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
Migraine. Quelques études ont donné des résultats contradictoires40-43. Les auteurs de synthèses récentes s’entendent pour dire que les données actuelles sont limitées et que des études supplémentaires sont nécessaires pour documenter l’efficacité du magnésium pour soulager la migraine44-46.
Calculs rénaux (pierres aux reins). Comme le magnésium augmente la solubilité du calcium, particulièrement dans l'urine, il semble qu’il puisse avoir un effet préventif sur les calculs rénaux. Il réduit aussi l’absorption intestinale d’oxalate, une substance qui contribue à la formation des calculs.
L’utilisation de sels d’oxyde et d’hydroxyde de magnésium donne des résultats mitigés qui seraient attribuables à la faible absorption de ces formes de magnésium, alors qu’une autre étude avait rapporté un effet prophylactique de l’hydroxyde de magnésium47. En revanche, le mélange potassium-magnésium-citrate préviendrait de façon nettement plus efficace la récurrence des calculs rénaux48,88.
Performances athlétiques. L’exercice physique peut réduire les réserves de magnésium. Des réserves faibles jumelées à un apport alimentaire insuffisant peuvent réduire la capacité à l’effort physique49,50. Dix études de petite envergure ont porté sur l’efficacité d’une supplémentation en magnésium sur les performances : 5 ont donné des résultats positifs, 5 des résultats non concluants49,51.
Ostéoporose. Le magnésium joue un rôle important dans le métabolisme osseux et le maintien de la densité osseuse52. On a récemment démontré qu’une carence en magnésium causait l’ostéoporose chez des rats de laboratoire54.
Chez l’être humain, des études épidémiologiques ont établi une association entre l’apport en magnésium (aliments et suppléments) et la densité osseuse chez les personnes à la peau blanche55.Elles confirment aussi que la déficience en magnésium joue un rôle important dans l’ostéoporose56,89.
Les études cliniques portant sur les effets d’une supplémentation sont rares. Deux essais préliminaires menés au début des années 1990 auprès de femmes ménopausées indiquent que la prise d’un supplément de magnésium pourrait avoir un effet positif sur la prévention et l’évolution de l'ostéoporose57,58; un effet qui a été confirmé dans une récente étude90.
Crampes dans les jambes durant la grossesse. Selon une synthèse publiée en 2002, les suppléments de magnésium constitueraient le meilleur traitement contre les crampes dans les jambes qui surviennent parfois en cours de grossesse60. Ils en diminueraient la fréquence59 et n’ont aucun effet néfaste sur l’accouchement et le post-partum61. Toutefois, les bienfaits du magnésium seraient modestes60; certains chercheurs allant même jusqu’à conclure qu’il n’a aucun effet91. Par ailleurs, la supplémentation en magnésium n’a pas d'effet probant sur les crampes nocturnes des femmes qui ne sont pas enceintes62,63.
Trouble de déficit d'attention avec hyperactivité(TDAH). Au cours d’une étude portant sur des enfants souffrant du TDAH, on a observé que 95 % d’entre eux présentaient des signes de carence en magnésium64. Si quelques études cliniques suggèrent que la prise quotidienne de magnésium, seul65 ou combiné avec de la vitamine B666,67, peut améliorer l’état des enfants hyperactifs, des études additionnelles sont nécessaires pour confirmer l’efficacité du magnésium92.
Asthme. En médecine, le sulfate de magnésium administré par voie intraveineuse a un effet démontré pour soulager les crises d’asthme aiguës, particulièrement chez les enfants71,93,94.
Par voie orale, par contre, le magnésium n’a pas démontré une grande efficacité pour prévenir l’asthme, que ce soit la fréquence des crises ou leur gravité. Il pourrait diminuer la réactivité des bronches95,96, mais les études sur la question n’arrivent pas toutes aux mêmes conclusions72,97.
D’autre part, la combinaison de sulfate de magnésium avec un traitement classique (beta-agoniste, corticostéroïde), par voie intraveineuse ou brumisation, a montré une certaine efficacité, en particulier chez les enfants avec des symptômes sévères101, 102, 103
Fibromyalgie. Deux études préliminaires indiquent qu’un supplément de magnésium et d’acide malique pourrait soulager la douleur provoquée par la fibromyalgie68,69. Les auteurs d’une synthèse se sont penchés sur 3 essais cliniques préliminaires (33 sujets en tout) menés auprès d’enfants atteints d’autisme auxquels on avait donné un supplément de magnésium ainsi que de la vitamine B6. Ils ont conclu que les données étaient nettement insuffisantes pour juger de l’efficacité clinique de cette supplémentation70.
Perte auditive. Un traitement oral au magnésium semble réduire l’incidence de perte auditive de nature idiopathique ou provoquée par le bruit. D’autres études104 sont nécessaires pour confirmer cet effet préventif.

Neuroprotection. Un accouchement prématuré peut provoquer des troubles neurologiques tels qu’une surdité, une cécité ou des déficits neurosensoriels. Des méta-analyses105-106-107 ont rapporté le fait que la prise de magnésium prénatale pouvait améliorer les fonctions motrices des enfants nés prématurément. De même, le sulfate de magnésium semble réduire le risque de développer une paralysie cérébrale chez les bébés à risque de naître prématurément. Le dosage optimal reste à déterminer.

Anxiété. La plupart des études108 ont examiné les effets d’une combinaison de magnésium avec des vitamines ou de produits naturels. Seule une étude a rapporté une absence d’effet du magnésium sur l’anxiété utilisé en monothérapie.
Précautions
Attention
* Les autorités canadiennes et américaines ont établi l’apport maximal tolérable de magnésium sous forme de supplément (tableau ci-dessous). Il s’agit en fait du dosage quotidien à partir duquel les suppléments de magnésium ont causé un effet laxatif chez certaines personnes au cours de quelques études. Au cours d’autres études, des dosages plus élevés (jusqu’à 1 200 mg par jour) n’ont pas provoqué de diarrhée chez les participants73.
* Notez que le magnésium fourni par les aliments ne provoque pas la diarrhée et que l’effet laxatif des sels de magnésium facilement assimilables est nettement moins prononcé (voir la section Sur les tablettes ci-dessous).
* En cas de diarrhée, interrompre la supplémentation et la reprendre plus tard, en plus petites doses ou en doses divisées.
*
Apport maximal tolérable de supplément de magnésium
Âge mg/jour
de 1 à 3 ans 65 mg
de 4 à 8 ans 110 mg
de 9 à 13 ans 280 mg
13 ans et plus 350 mg
Source : Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride, 1997, Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, pages 246 et 245.
Contre-indications
* Maladies rénales graves. La très grande majorité des cas répertoriés d’un excès de magnésium dans l’organisme sont associés à l’insuffisance rénale.
Effets indésirables
* Aux dosages recommandés, les effets indésirables se limitent généralement à de la diarrhée ou à une irritation intestinale.
Interactions
Avec des plantes ou des suppléments
* Les suppléments de bore semblent diminuer l’élimination du magnésium chez les femmes.
* Les suppléments de calcium peuvent diminuer l’absorption du magnésium, mais ne semblent pas avoir d’effet sur les réserves et les taux sanguins de magnésium. Jusqu’à présent, aucun cas de carence en magnésium n’a été rapporté à la suite de la prise de suppléments de calcium.
Avec des médicaments
* La prise de suppléments de magnésium réduit l’absorption des antibiotiques de la famille des tétracyclines. Prendre à 2 heures d'intervalle.
* La prise de suppléments de magnésium peut réduire l’absorption de la nitrofurantoïne (un antibiotique). Prendre à 2 heures d'intervalle.
* La prise de suppléments de magnésium peut nuire à l’absorption des biophosphonates (alendronate et étidronate), utilisés contre l'ostéoporose. Prendre à 2 heures d'intervalle.
* Si vous suivez un traitement à l'amiloride (un diurétique), consultez votre médecin avant de prendre un supplément de magnésium : cette combinaison peut provoquer un taux de magnésium trop élevé dans l’organisme.
*
L'avis de notre pharmacien
Magnésium, le nutriment oublié
Que ce soit dans le discours populaire ou dans le milieu médical, on entend souvent parler du calcium, mais très peu du magnésium. D’ailleurs, avant d’avoir lu ce qui précède, qui aurait pu nommer une bonne source de magnésium alimentaire? Par contre, tout le monde est en mesure de nommer une bonne source de calcium! Pourtant, les données scientifiques démontrent que la carence en magnésium est plus importante dans notre société que la carence en calcium. Les personnes âgées et les personnes à la peau noire sont les populations dont le risque de carence est le plus élevé.
Le magnésium joue de multiples rôles dans l’organisme. De façon générale, on peut dire que, partout où le calcium joue un rôle dans la contraction, le magnésium joue le rôle inverse pour faciliter la relaxation. Sa présence est donc essentielle au bon fonctionnement des muscles, des artères et même des cellules nerveuses. Selon certains auteurs, la carence en magnésium est impliquée dans des troubles allant de la nervosité, l’anxiété et la fatigue jusqu’à l’artériosclérose, le syndrome métabolique (syndrome X) et les altérations du système immunitaire.
Sur le plan osseux, le magnésium contribue à la fixation du calcium dans la matrice osseuse (structure minérale de l’os). Ainsi, un complexe de minéraux comprenant du calcium, du magnésium et d’autres oligo-éléments, associé à de la vitamine D, est beaucoup plus efficace pour combattre l’ostéoporose que le calcium seul.
Certains prétendent que le calcium inhibe l’absorption du magnésium. Il est vrai qu’il y a concurrence entre ces deux minéraux au site d’absorption dans l’intestin. Cependant, le corps a besoin des deux minéraux et il est en mesure d’absorber chacun d’eux en quantités adéquates.
Taux difficile à mesurer
Pour mesurer le taux de fer ou de calcium, une prise de sang suffit. Par contre, ce n’est pas le cas pour le magnésium puisque le taux sanguin de magnésium ne reflète pas l’état des réserves. En effet, le taux de magnésium circulant dans le sang peut être adéquat malgré des réserves très déficientes.
La dose de supplément
Au Canada et aux États-Unis, la dose maximale de suppléments de magnésium est fixée à 350 mg par jour pour les personnes de plus de 13 ans. Cependant, cette dose est en contradiction avec l’apport nutritionnel recommandé pour les hommes (420 mg par jour) et pour les femmes enceintes (de 350 mg à 400 mg), de même qu’avec les dosages utilisés dans les études cliniques. Ainsi, au cours d’essais sur l’hypertension et le syndrome prémenstruel, on a utilisé jusqu’à 1 000 mg de magnésium par jour en doses divisées de 250 mg à 300 mg, aux repas.
À la lumière de ces renseignements, cette dose de 350 mg représente donc la limite maximale de supplément de magnésium par prise (ou dose) et non par jour. Elle a été établie parce qu’au-delà de 350 mg par dose, le risque de diarrhée augmente.
Par ailleurs, le type de sel de magnésium employé a son importance : moins il est absorbé (biodisponible), plus le risque de diarrhée augmente. Ainsi, un oxyde de magnésium risque d’entraîner plus de diarrhée qu’un citrate (voir la section Sur les tablettes, ci-dessous).
Contre-indication
Une contre-indication très importante existe pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale. Pour ces patients, toute supplémentation minérale doit faire l’objet d’un suivi auprès d’un professionnel de la santé.
Jean-Yves Dionne, pharmacien
Sur les tablettes
* Le magnésium est commercialisé sous forme de sels (chlorure, citrate, gluconate, hydroxyde, oxyde, etc.) dont la teneur en magnésium élémentaire varie considérablement (voir le tableau ci-dessous). Comme c’est le cas pour tous les suppléments minéraux vendus au Canada, la teneur est indiquée en milligrammes de magnésium élémentaire.
* Le magnésium que renferment ces sels est plus ou moins assimilable par l’organisme (biodisponibilité et solubilité). Moins le magnésium d’un sel est assimilable, moins il sera utilisé par l’organisme et plus l’effet laxatif sera important. Si l’on désire combler ou prévenir une carence en magnésium, on recherchera plutôt un sel facilement assimilable (bonne biodisponibilité et bonne solubilité), lequel aura par ailleurs moins d’effets laxatifs.
DOCUMENT passeportsante LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA BANANE |
|
|
| |
|
| |

LA BANANE
Riche en antioxydants, la banane préviendrait l’apparition de nombreuses maladies. De plus, les sucres qu’elle contient contribueraient à maintenir une bonne santé gastro-intestinale. D’un point de vue culinaire, on distingue 2 types de bananes : les bananes à dessert, comme celles que nous mangeons au petit-déjeuner, et les bananes à cuire, comme le plantain.
Caractéristique de la banane
* Source de fibres douces ;
* Excellente source de potassium ;
* Favorise la satiété ;
* Régule le transit ;
* Riche en vitamines, minéraux et antioxydants.
*
Valeurs nutritionnelles et caloriques de la banane
Nutriments Banane crue (douce), 100 g Banane plantain crue, 100 g
Calories 90,5 122
Protéines 1,06 g 1,28 g
Glucides 19,7 g 29,6 g
Lipides < 0,5 g 0,39 g
Fibres alimentaires 2,7 g 2,3 g
Charge glycémique : Modérée
Pouvoir antioxydant : Élevé
Zoom sur les micronutriments contenus dans la banane
La banane a un profil nutritionnel bien à elle. Entre autres, elle renferme divers nutriments essentiels à la bonne santé de l’organisme. Parmi ces nutriments, nous pouvons citer les suivants :
* Vitamine B6 (pyridoxine) : la banane est une excellente source de vitamine B6 et la banane plantain, une bonne source ;
* Manganèse : la banane est une bonne source de manganèse pour la femme, mais seulement une source pour l'homme ;
* Vitamine B9 (folate) : la banane et la banane plantain sont des sources de vitamine B9 ;
* Vitamine C : la banane et la banane plantain sont des sources de vitamine C ;
* Cuivre : la banane et la banane plantain sont des sources de cuivre ;
* Magnésium : la banane et la banane plantain sont des sources de magnésium ;
* Potassium : la banane et la banane plantain sont des sources de potassium ;
Les bienfaits de la banane
Grâce à sa composition unique, la chair de la banane s’avère être une véritable alliée santé au quotidien. Rassasiante, riche en fibres alimentaires et micronutriments, elle a toute sa place dans le cadre d’une alimentation santé variée et équilibrée.
Cancers
Une étude prospective, effectuée auprès de 61 000 femmes suisses, a démontré un lien entre une consommation élevée de fruits et le risque moindre de souffrir d’un cancer du rein. De tous les fruits à l’étude, c’est pour la banane que les chercheurs ont constaté la plus forte relation. La banane aurait le même effet bénéfique sur le risque de cancer colorectal, autant chez les femmes que les hommes.
Ulcères de l'estomac
Quelques études in vitro et chez l’animal tendent à démontrer que la banane sous forme d’extrait (surtout la banane plantain, mais également la variété à dessert) pourrait protéger la muqueuse de l’estomac contre les ulcères. Une étude a démontré que l’extrait de 2 variétés de bananes cultivées en Thaïlande (Palo et Hom) aurait un potentiel gastroprotecteur chez le rat. Toutefois, seule la variété Hom aurait un effet sur la guérison des ulcères. Ce type de banane se rapprocherait de la Cavendish, la variété la plus répandue dans le monde. Les recherches actuelles sont cependant insuffisantes pour recommander la consommation de bananes pour la prévention ou le traitement des ulcères gastriques.
Diarrhée chronique
Quelques études menées au Bangladesh ont démontré que la consommation de bananes pouvait diminuer les symptômes de la diarrhée chronique chez les enfants. Dans certains cas, un mélange de riz et de bananes plantain cuites ou un mélange de riz et de pectine pouvait diminuer le nombre et le poids des selles, ainsi que la durée de la diarrhée chez les bébés. Dans d’autres cas, la consommation de bananes non mûres (de ½ à 3 bananes par jour, selon l’âge des enfants) hâtait la guérison de la diarrhée aiguë et chronique. Une autre étude effectuée au Venezuela a démontré qu’une diète comprenant une préparation à base de banane plantain cuite diminuait le nombre et le poids des selles, la durée de la diarrhée et favorisait le gain de poids, comparativement à une préparation traditionnelle à base de yaourt.
Aussi, la banane non mûre contient de l’amidon résistant, un type de sucre qui résiste à l’action des enzymes digestifs (de la même manière que les fibres alimentaires) et qui se rend intact dans le côlon. Sous l’action de la flore intestinale, l’amidon non digéré y subit alors une fermentation, ce qui le transforme en acides gras à chaînes courtes (par exemple l’acide butyrique). Ces derniers stimulent l’absorption des liquides et du sel dans le côlon, diminuant ainsi la perte d’eau dans les selles. Les acides gras à chaînes courtes amélioreraient aussi indirectement la perméabilité de l’intestin grêle, un phénomène qui contribue à soulager les symptômes de la diarrhée.
Maladies cardiovasculaires
Une étude a indiqué qu’une consommation élevée de bananes pendant un repas (400 g, soit plus de 3 bananes) réduisait les radicaux libres présents dans le corps, 2 heures après le repas. Cette diète diminuait l’oxydation du LDL-cholestérol (mauvais cholestérol), un processus impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires. Toutefois, d’autres études seront nécessaires afin de cibler les effets de la banane à plus long terme et avec des doses plus modérées.
Diabète de type 2
L’amidon résistant (un type de sucre) de la banane non mûre contribuerait à la perte de poids chez des individus obèses souffrant de diabète de type 2, ainsi qu’à améliorer la sensibilité des cellules à l’insuline. Un extrait d’amidon résistant provenant des bananes non mûres diminuerait aussi la sécrétion d’insuline et la glycémie (taux de sucre dans le sang) tant chez les individus en santé que chez ceux ayant un diabète de type 2.
Des chercheurs ont observé que l’amidon résistant diminuait l’absorption des sucres consommés au même moment, ce qui entraînait une diminution de la glycémie (taux de sucre dans le sang). De plus, la consommation régulière d’amidon résistant mènerait à une augmentation plus importante de la ghréline lors des repas, une hormone qui a été associée à l’amélioration de la sensibilité à l’insuline.
Antioxydants et caroténoïdes
Bien que la banane ne figure pas parmi les fruits qui contiennent le plus d’antioxydants, elle a tout de même une capacité antioxydante élevée, pouvant possiblement contribuer à prévenir l’apparition de certains cancers, de maladies cardiovasculaires et de diverses maladies chroniques. La très populaire banane Cavendish contiendrait de la dopamine, une molécule de la famille des catécholamines. La dopamine a démontré une activité antioxydante similaire à celle de la vitamine C, l’antioxydant hydrosoluble le plus puissant. Comme la banane contient à la fois de la dopamine et de la vitamine C, cela pourrait expliquer sa capacité antioxydante élevée. La banane plantain serait également une source importante de plusieurs composés phénoliques qui seraient bien absorbés par le corps, optimisant ainsi leur potentiel antioxydant.
Un antioxydant de la famille des flavonoïdes, la leucocyanidine, a été extrait de bananes plantains non mûres. Ce composé actif a démontré un effet protecteur contre l’érosion de la muqueuse de l’estomac, à la suite de la prise d’aspirine.
La banane plantain contient du bêta et de l’alpha-carotène, 2 caroténoïdes ayant la faculté de se transformer en vitamine A dans l’organisme. Parmi tous les caroténoïdes, le bêta-carotène est celui dont la conversion en vitamine A est la plus efficace. Cette dernière favorise la croissance des os et des dents, maintient la peau en santé et protège contre les infections.
Le mot du nutritionniste
La banane plantain contient davantage d’amidon résistant que la banane douce. De plus, à mesure que la banane mûrit, la quantité d’amidon résistant diminue à un point tel que seules les bananes non parvenues à leur stade de maturation optimale contiendraient de l’amidon résistant en quantité significative.
Comment bien choisir la banane ?
Si la consommation annuelle de bananes par personne est de 2 kg en Chine, de 10 kg en Europe et de 12 kg aux États-Unis, elle passe à 50 kg en Océanie et à 210 kg, voire plus, dans les pays d’Afrique de l’Est. Une consommation variable, donc, pour ce fruit au profil nutrition unique.
Carte d'identité
* Famille : musacées ;
* Origine : Afrique et Asie ;
* Saison : octobre à janvier ;
* Couleur : verte à jaune ;
* Saveur : sucrée.
Choisir la banane en fonction de sa couleur
Plus la banane présente de marques vertes, moins elle est mûre et plus elle se conservera longtemps. On peut alors l’utiliser pour la cuisson. Par contre, il faudra la laisser mûrir avant de la consommer crue, car à ce stade, elle est indigeste. Elle est prête à consommer lorsque la chair cède légèrement à la pression et que la pelure est bien jaune et légèrement tigrée, sans aucune coloration verte. Lorsqu’elle présente des taches brunes ou noires, elle a dépassé ce stade et convient alors mieux pour la cuisson. À noter que les petites bananes sont généralement plus sucrées que les grosses.
La banane plantain est généralement vendue lorsque sa peau est verte.
Produits dérivés
On trouve dans les épiceries spécialisées une banane rose rouge, qui se consomme crue ou cuite. Les bananes séchées du commerce sont souvent additionnées de sucre : il faut bien lire l’étiquette.
L’« essence de banane », dont on se sert pour aromatiser les liqueurs et les confiseries (de même que certains fromages fondus), est en fait de l’acétate d’amyle, une substance de synthèse obtenue à partir de l’acide acétique. L’essence de banane naturelle est trop volatile pour présenter un intérêt culinaire.
Enfin, on trouve, dans les épiceries asiatiques, des feuilles de bananier congelées, dont on peut se servir pour cuire les aliments en papillote.
Quand peler la banane ?
Ne pelez la banane qu’au moment de la consommer ou de la préparer, car sa chair s’oxyde au contact de l’air. S’il faut la peler à l’avance, on la citronne légèrement.
La banane plantain se pèle plus facilement après qu’on l’ait fait blanchir 5 minutes dans l’eau bouillante salée.
Bien conserver
* Température ambiante : comme la banane noircit au contact du froid, on recommande de la conserver à la température ambiante, dans un compotier ou sur le comptoir. Pour hâter le mûrissement des bananes vertes, on les met dans un sac de papier brun ;
* Congélateur : retirez la peau et congelez-la entière, en morceaux ou en purée. Arrosez de jus de citron à la sortie du congélateur pour empêcher son oxydation.
*
Comment préparer la banane
D’un point de vue culinaire, on distingue 2 types de bananes : les bananes à dessert et les bananes à cuire. Dans cette dernière catégorie, la banane plantain est de loin la plus répandue. Pour chacun de ces types, il existe une multitude de variétés donnant des fruits dont la taille, la forme, la couleur et la saveur varient considérablement. La plupart de ces variétés sont inconnues hors de leurs pays de production. Les principaux pays producteurs de bananes sont situés en Amérique latine et en Asie, ainsi qu’en Afrique pour les bananes à cuire. Pratiquement toutes les bananes à dessert exportées à travers le monde proviennent d’une seule variété, la Cavendish.
Cuisiner la banane en version sucrée
* Cuisiner la banane dans un gâteau, c'est possible avec notre recette de banana bread ;
* Crue, telle quelle, ajoutée aux salades de fruits, aux céréales, dans les crêpes, ou en brochettes, avec d’autres fruits ;
* Dans les mousses, sorbets, glaces. Ou écrasez des bananes bien mûres et ajoutez-les aux préparations de pains, muffins, gâteaux, tartes, etc ;
* Passez-la au mélangeur avec du lait, du yogourt, du fromage blanc, du lait de soya ou du tofu, et d’autres fruits si désiré ;
* Bananes congelées. Sortez-les du congélateur et laissez-les légèrement décongeler. Fouettez ou passez au robot jusqu’à l’obtention d’une mousse dont la texture rappelle celle de la crème glacée ;
* Au lait de coco. Amenez à ébullition du lait de coco additionné de miel, ajoutez des morceaux de banane, réchauffez et servez.
… Ou en version salée pour encore plus d’originalité
* Faites frire des morceaux de bananes plantains bien mûres dans de l’huile d’olive et servez comme légume d’accompagnement ;
* Ajoutez des tronçons de banane plantain ou de banane verte aux currys ou autres types de ragoûts ;
* Salade au concombre. Coupez des bananes et des concombres en cubes. Mélangez-les avec du jus de citron, de la coriandre hachée, de la noix de coco râpée (de préférence fraîche), un piment fort finement haché et des morceaux d’arachides. Salez, réfrigérez 30 minutes et servez ;
* Salade de pommes de terre. Faites cuire les pommes de terre coupées en dés. À la fin de la cuisson, ajoutez des rondelles de bananes et faites cuire 1 minute de plus. Égouttez, ajoutez des câpres, des olives noires et assaisonnez d’une vinaigrette à la moutarde. Réfrigérez 1 ou 2 heures avant de servir ;
* Une autre salade. Tranches de bananes, morceaux de pommes, échalote et céleri hachés. Ajoutez du yogourt, un peu de jus de citron et, si désiré, de la mayonnaise. Réfrigérez et servez sur des feuilles de laitue avec des noix hachées et grillées à sec dans une poêle ;
* Raita. Faites revenir des graines de moutarde dans un peu de beurre clarifié. Ajoutez de la noix de coco râpée, faites cuire quelques minutes et retirez du feu. Ajoutez du yogourt, des rondelles de banane, des feuilles de coriandre hachée, versez dans un bol et mettez au réfrigérateur 1 heure. Servez avec un curry épicé ;
* Poisson à la banane plantain. Faites revenir des filets de poisson dans du beurre ou de l’huile, en les tournant une fois. Ajoutez du jus de lime additionné de poudre de cari, couvrez, faites cuire 5 minutes. Ajoutez des morceaux de plantain fendus dans le sens de la longueur, faites cuire 5 minutes encore et servez ;
* À la thaïlandaise. Faites cuire les haricots noirs mis à tremper la veille jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Par ailleurs, faites cuire du riz glutineux dans du lait de coco épais additionné d’un peu de miel, jusqu’à ce que le lait soit entièrement absorbé et que le riz soit moelleux. Découpez une feuille de papier d’aluminium en rectangles de 15 cm par 25 cm. Déposez à une extrémité d’un rectangle une petite quantité du riz cuit auquel vous aurez ajouté une cuillerée de haricots noirs, couvrez d’un morceau de banane fendue en deux puis d’une autre couche de riz aux haricots et repliez la feuille aluminium de façon à former un paquet. Faites cuire 15 minutes à la vapeur et servez.
*
Un fruit pour une multitude de cuissons possibles
* Faites pocher les bananes à dessert vertes dans leur peau (après les avoir lavées). Elles seront alors plus digestes et pourront être consommées sans aucune autre préparation ou ajoutées à divers plats.
* On peut également faire pocher ou cuire à la vapeur des bananes mûres, entières ou coupées en tronçons. Il faut compter environ ½ heure de cuisson ; Réchauffez quelques minutes des bananes à dessert vertes, préalablement cuites, dans un mélange d’huile d’olive et de vinaigre, avec de l’oignon, de l’ail, une feuille de laurier, du sel et du poivre.
* Retirez du feu et laissez mariner 24 heures. Servez comme condiment ;
* Percez la peau de bananes entières avec une fourchette et mettez-les une quinzaine de minutes dans un four réglé à 200°C (400°F). Servez avec une sauce au beurre fondu et au jus de citron, un coulis
* de fruits ou toute autre sauce de votre choix. Ou fendez des bananes pelées en deux et mettez-les à cuire au four. Servez avec une viande, en les garnissant d’arachides rôties.
Contre-indications
Bien qu’excellente pour la santé, la banane n’en reste pas moins un fruit allergisant pour de nombreuses personnes. Il convient donc d’être prudent et attentif aux signes d’une éventuelle allergie orale, celle-ci pouvant avoir des conséquences graves si elle n’est pas traitée à temps.
Attention aux allergies
La banane est un aliment incriminé dans le syndrome d’allergie orale. Ce syndrome est une réaction allergique à certaines protéines d’une gamme de fruits, de légumes et de noix. Il touche certaines personnes ayant des allergies aux pollens de l’environnement et est presque toujours précédé par le rhume des foins.
Ainsi, lorsque certaines personnes consomment la banane crue (la cuisson dégrade habituellement les protéines allergènes), une réaction immunologique peut survenir. Ces personnes ressentent des démangeaisons et des sensations de brûlure à la bouche, aux lèvres et à la gorge. Les symptômes peuvent apparaître, puis disparaître, habituellement quelques minutes après avoir consommé ou touché l’aliment incriminé. En l’absence d’autres symptômes, cette réaction n’est pas grave et la consommation de banane n’a pas à être évitée de façon systématique. Toutefois, il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions aux aliments végétaux. Ce dernier sera en mesure d'évaluer si des précautions spéciales devraient être prises.
Les personnes allergiques au latex peuvent démontrer une hypersensibilité à la banane ainsi qu’à d’autres aliments tels le kiwi et l’avocat. Les réactions sont diverses, passant de l’urticaire aux réactions anaphylactiques. Étant donné la gravité potentielle des réactions, une attention très particulière doit être portée au moment de la consommation de ces aliments chez les personnes qui se savent allergiques au latex. Encore une fois, il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions à certains aliments ainsi que les précautions à prendre.
Histoire et anecdotes
Le terme « banane » est apparu en 1602. Il vient du portugais banana, emprunté, selon les uns, à une langue bantoue; selon les autres, à un mot arabe signifiant « doigt ». Le fruit a d’abord été désigné sous les noms de « pomme de paradis » et « figue des jardins ».
Le terme « plantain » pour désigner la banane plantain est apparu d’abord sous la forme de « plantin » au début du XVIIe siècle. Il dérive de l’espagnol platano, qui désigne le platane, un arbre n’ayant rien à voir avec le bananier. On ne sait d’ailleurs pas pourquoi les Espagnols qui accostèrent en Amérique du Sud le nommèrent ainsi. À noter que « plantain » désigne également une petite plante herbacée dont le nom dérive du latin plantago.
Un peu d’Histoire
Le bananier est l’une des plus anciennes plantes connues. C’est probablement aussi l’une des premières à avoir été domestiquées. On pense toutefois que le fruit n’était guère consommé par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs puisque, avant la domestication de la plante, il était peu charnu et contenait de nombreuses graines non comestibles. Par contre, on consommait fort probablement ses bourgeons de même que ses gaines foliaires internes. Les pêcheurs primitifs se servaient des fibres de sa tige pour fabriquer des filets. Les feuilles connaissaient également divers usages.
La famille des musacées ne comprend que 2 genres botaniques, Musa étant de loin le plus répandu et le plus diversifié. Ce genre se subdivise en de nombreuses espèces (de 30 à 50, selon les experts), dont plusieurs poussent encore à l’état sauvage. Toutefois, la majorité des variétés de bananiers et de bananiers plantains sont issues des espèces M. acuminata et M. balbisiana ou de leur croisement.
Originaire de l’Asie du sud-est, le bananier a suivi les migrations humaines vers la péninsule indienne, les îles du Pacifique et l’Afrique. Sous l’influence de l’évolution naturelle et des interventions humaines, il s’est grandement diversifié. En Afrique, les paysans cultivent un large éventail de bananiers plantains, nettement différents de ceux de la zone Pacifique, de même qu’un autre groupe de bananes à cuire, possédant leurs propres caractéristiques.
Comme la banane se conserve mal et s’abîme facilement durant le transport, elle tardera à être connue en Occident. Elle ne semble pas avoir été consommée par les Égyptiens, les Grecs ou les Romains, et ne serait apparue au Proche-Orient qu’au VIIe siècle de notre ère. Elle ne se répandra en Europe et en Amérique du Nord qu’au XIXe siècle, les navires étant alors plus rapides et les méthodes de conservation mieux maîtrisées.
Une consommation qui diffère suivant les régions
Si la banane est considérée comme un simple dessert ou une collation dans les pays riches, il en va tout autrement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Pour près de 400 millions de personnes, elle constitue un aliment de subsistance, à mettre sur le même pied que les tubercules nutritifs, comme le taro, le manioc ou la patate douce. Les recherches menées dans ces régions par des organismes nationaux et internationaux revêtent une grande importance. Elles visent à accroître la productivité des bananeraies et à trouver des solutions aux problèmes de maladies et d’insectes qui attaquent cette culture.
Outre le fruit, on consomme, dans diverses parties du monde, la jeune pousse, la base de la tige ou la fleur mâle. Les cendres des feuilles brûlées servent de sel en Asie. Certaines espèces de bananiers ne sont cultivées que comme plantes ornementales. D’autres servent à la production de fibres pour fabriquer cordes, tissu, papier, paniers, tapis, matériaux de recouvrement des toitures et portent le nom de « chanvre de Manille ».
Le bananier et son régime
Le bananier n’est pas un arbre, mais plutôt une herbe géante. Le tronc est en réalité un pseudotronc, composé de gaines foliaires (feuilles qui se superposent à la base).
L’ensemble des bananes produites sur un même plant (de 100 à 400) se nomme « régime », lequel est divisé en groupes de 10 ou 20 fruits appelés « mains » ou « pattes ». Les fruits individuels portent le nom de « doigts ».
Rédaction : Léa Zubiria
DOCUMENT passeportsante LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les acides gras, essentiels au système nerveux…de l’intestin (aussi) |
|
|
| |
|
| |

Les acides gras, essentiels au système nerveux…de l’intestin (aussi)
COMMUNIQUÉ | 09 NOV. 2015 - 16H02 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Comment le défaut d’un acide gras explique la maladie de Crohn ?
Deux équipes de recherche de l’Inserm viennent de montrer qu’un défaut de production par l’intestin d’un « messager » lipidique, était associé à la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) fréquente et très invalidante. Ce messager, dérivé d’un acide gras essentiel, régule la perméabilité de la barrière intestinale et pourrait ainsi devenir une cible de choix dans la prise en charge des MICI. Ces travaux éclairent aussi d’un jour nouveau le rôle des cellules gliales entériques. A l’égal de leurs homologues du système nerveux central, trop longtemps considérés comme jouant un « second rôle », les cellules gliales de l’intestin commencent à dévoiler leur « jeu » en réalité indispensable à l’homéostasie intestinale. Le détail de ces travaux est publié dans Gastroenterology.
Le système nerveux entérique joue un rôle central dans le contrôle de l’homéostasie des fonctions digestives telles que la motricité ou encore le contrôle des fonctions de la barrière épithéliale intestinale. Ce système nerveux intégratif, situé tout le long du tube digestif, est constitué de neurones et de cellules gliales. Le rôle des cellules gliales entériques reste encore largement à découvrir. Un nombre croissant d’études montrent qu’elles régulent, de manière analogue aux astrocytes du cerveau, les fonctions des neurones entériques mais aussi de la barrière épithéliale intestinale telles que la prolifération des cellules épithéliales, leur migration, la perméabilité (paracellulaire et transcellulaire) ainsi que les processus de réparation. Les cellules gliales régulent ces fonctions via la libération de différents gliomédiateurs dont certains dérivés lipidiques des acides gras polyinsaturés (AGPI) n-6.
Par ailleurs, les atteintes des cellules gliales entériques (CGE) dans des pathologies associées à des dysfonctions de la barrière intestinale, restent limitées à la description de modification d’expression de marqueurs gliaux. Ces dysfonctions de la barrière intestinale (augmentation de la perméabilité, défaut de réparation) sont reconnues comme pouvant jouer un rôle clef dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) en participant au déclenchement des rechutes. Réduire ces dysfonctions est aussi un mécanisme d’action probable des biothérapies utilisées dans la prise en charge des MICI.
Dans ce contexte Malvyne Rolli Derkinderen et Michel Neunlist, chercheurs de l’Unité mixte de recherche Inserm-Université de Nantes « Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives », et leurs collaborateurs de l’Institut de Recherche en Santé Digestive de Toulouse Purpan, ont cherché dans un premier temps à caractériser la production de médiateurs lipidiques dérivés des n-6 dans les cellules gliales entériques animales et humaines. Ils ont ensuite analysé l’impact des dérivés des AGPI majoritairement produits sur des fonctions de la barrière épithéliale intestinale, et, enfin, ont mis en évidence le défaut de production de l’un d’entre eux chez les patients atteints de maladie de Crohn.
En vert : en situation physiologique, les cellules gliales entériques produisent des dérivés lipidiques dont la 15-HETE qui renforce l’étanchéité de la barrière épithéliale intestinale et empêche le passage de pathogène.
En rouge : au cours de la Maladie de Crohn, il existe un déficit de production gliale de 15-HETE qui conduit à une augmentation de la perméabilité de la barrière et facilite le passage de pathogènes. Ceci contribuerait aux rechutes de la maladie ou à sa sévérité.
Ainsi les chercheurs ont montré que les CGE humaines (et de rat) sont capables de produire des AGPI n-6, et notablement le 15-HETE, synthétisé par la 15-lipoxygenase-2. Ce 15-HETE renforce la barrière épithéliale intestinale en diminuant la perméabilité paracellulaire in vivo et in vitro, en particulier en augmentant l’expression de molécules des jonctions serrées dont la Zonula Occludens-1.
Dans des CGE isolées de patients atteints par la Maladie de Crohn, les chercheurs ont mis en évidence un défaut de production de 15-HETE associé à une perte de la capacité des CGE à contrôler la perméabilité de la barrière épithéliale intestinale.
Ces travaux identifient donc les AGPI n-6 comme source de dérivés aux effets potentiellement bénéfiques sur les fonctions de la barrière épithéliale intestinale dans les MICI. Pour Camille Pochard et Sabrina Coquelorge, les 2 premières auteures, « ces résultats contribuent à la fois à renforcer le rôle des cellules gliales en particulier et du système nerveux entérique en général dans les processus physiopathologiques des MICI et aussi d’identifier de nouvelles cibles d’intérêt thérapeutique».
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Covid-19 : quel impact de l’infection au SARS-CoV-2 sur l’irrigation vasculaire du cerveau ? |
|
|
| |
|
| |
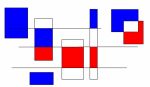
Covid-19 : quel impact de l’infection au SARS-CoV-2 sur l’irrigation vasculaire du cerveau ?
COMMUNIQUÉ | 21 OCT. 2021 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
COVID-19 | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Image fluorescente d’un tissu cérébral humain post-mortem montrant des noyaux cellulaires (bleu) mettant en évidence un vaisseau sanguin dans lequel les cellules endothéliales vasculaires expriment le matériel génétique du SARS-CoV2 (rouge). © Vincent Prévot/Inserm
De nombreux chercheurs et chercheuses sont actuellement mobilisés pour accroître les connaissances relatives au virus du SARS-CoV2, pour une meilleure prise en charge des patients infectés, mais également pour essayer de prévoir les conséquences futures d’une infection sur la santé. Dans le cadre d’une collaboration internationale, des chercheurs de l’Inserm, de l’Université, du CHU et de l’Institut Pasteur de Lille, au sein du laboratoire « Lille neuroscience & cognition », et des collègues du CNRS[1], identifient pour la première fois un effet direct du SARS-CoV-2 sur les vaisseaux sanguins du cerveau. Certaines cellules, les cellules endothéliales vasculaires cérébrales, composantes essentielles de la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau sont affectées par un phénomène de mort cellulaire. Ces résultats, qui font l’objet d’une publication dans la revue Nature Neuroscience, interrogent notamment sur les conséquences à long terme de la maladie.
Les vaisseaux sanguins sont composés de cellules endothéliales. Parmi elles, les cellules endothéliales vasculaires du cerveau qui composent la barrière hémato-encéphalique (BHE). La fonction principale de la BHE est d’isoler le système nerveux central de la circulation sanguine, empêchant ainsi que des substances étrangères ou molécules potentiellement toxiques ne pénètrent dans le cerveau et la moelle épinière, tout en permettant le transfert de nutriments essentiels à leur activité. Participant à cet effort, les cellules endothéliales vasculaires du cerveau jouent donc un rôle primordial dans la bonne irrigation sanguine du cerveau et leur survie est essentielle à son bon fonctionnement.
Dans le cadre d’une collaboration internationale financée par le Conseil Européen de la Recherche[3], les auteurs de l’étude se sont intéressés aux cellules endothéliales vasculaires du cerveau et aux conséquences d’une infection par le SARS-CoV-2 sur leur fonctionnement.
Grâce à des modèles d’étude précliniques mais également en étudiant le cortex de patients décédés des suites d’une infection au SARS-CoV-2, les chercheurs montrent que l’infection entrainerait la mort des cellules endothéliales du cerveau, ce qui donnerait lieu à l’apparition de « vaisseaux fantômes » dans le cerveau (c’est à dire des tubes vides, sans cellules endothéliales).
En conséquence, ces cellules essentielles ne pourraient plus assurer leur fonction au niveau de la barrière hémato-encéphalique.
Comment cette mort des cellules endothéliales survient-elle ? Quels sont les mécanismes impliqués ? Grâce à des techniques de pointes[2], l’équipe a découvert que le SARS-CoV-2 fait fabriquer, à partir de son propre matériel génétique, des ciseaux moléculaires par les cellules endothéliales qu’il infecte. Ces ciseaux vont couper une protéine appelée NEMO, indispensable à la survie des cellules endothéliales qui vont donc mourir.
Les conséquences de la mort des cellules endothéliales sur le fonctionnement du cerveau
Selon les scientifiques, la mort des cellules endothéliales vasculaires du cerveau peut entrainer deux conséquences majeures :
* Une rupture temporaire de la barrière hémato-encéphalique provoquant des microhémorragies dans des régions où le sang n’est pas censé accéder librement.
* Une hypoperfusion de certaines régions du cerveau (due à la présence de vaisseaux fantômes non fonctionnels), c’est-à-dire une diminution du débit sanguin pouvant entrainer le décès des patients dans les cas les plus graves.
L’étude révèle toutefois que la situation serait réversible.
Par ailleurs, les scientifiques s’interrogent sur les conséquences à long-terme de cette phase de vulnérabilité au cours de laquelle le cerveau des patients est moins irrigué. Selon eux, même si cette hypothèse reste encore à vérifier, cette fenêtre de temps pourrait prédisposer certaines personnes ayant contracté la maladie à développer des troubles cognitifs, neurodégénératifs, voire des démences.
« Cette prise de conscience de la gravité de l’infection par le SARS-CoV2 et ses conséquences pour le bon fonctionnement de notre cerveau est capitale pour permettre la meilleure prise en charge possible des patients ayant été infectés dans les années à venir », conclut Vincent Prévot, directeur de recherche à l’Inserm.
[1] Au sein du Centre d’infection et d’immunité de Lille (CNRS/Inserm/Institut Pasteur de Lille/Université de Lille/CHU de Lille)
[2] Telles que la transgénèse, le séquençage de l’ARN en cellule unique, la spectrométrie de masse et la microscopie à super-résolution.
[3] Programme financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC Synergy) impliquant les Drs. Prévot (Inserm, France), Nogueiras (Université de Saint-Jacques de Compostelle, Espagne) et Schwaninger (Université de Lübeck, Allemagne).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
