|
|
|
|
 |
|
Un cerveau virtuel pour décrypter l’épilepsie |
|
|
| |
|
| |
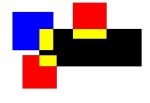
Un cerveau virtuel pour décrypter l’épilepsie
COMMUNIQUÉ | 29 JUIL. 2016 - 10H55 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | TECHNOLOGIE POUR LA SANTE
Le Cerveau Virtuel : reconstruction des régions du cerveau et des connexions qui les relient. Les cubes verts indiquent le centre des régions du cerveau qui sont connectées
© INS UMR1106 Inserm/AMU.
Des chercheurs du CNRS, de l’Inserm, d’Aix-Marseille Université et de l’AP-HM viennent de créer pour la première fois un cerveau virtuel permettant de reconstituer le cerveau d’une personne atteinte d’épilepsie. Ce travail permet de mieux comprendre le fonctionnement de la maladie mais aussi d’aider à préparer des gestes chirurgicaux par exemple. Ces résultats viennent d’être publiés en ligne sur le site de la revue Neuroimage.
Un pour cent de la population mondiale souffre d’épilepsie. La maladie affecte les individus différemment, d’où l’importance d’un diagnostic et d’un traitement individualisé. Or actuellement les moyens de comprendre les mécanismes de cette pathologie sont peu nombreux et relèvent surtout de l’interprétation visuelle d’un IRM et d’un électroencephalogramme. Cela s’avère d’autant plus difficile que 50% des patients ne présentent pas d’anomalie visible à l’IRM et que la cause de leur épilepsie reste donc inconnue.
Des chercheurs ont réussi pour la première fois à élaborer un cerveau virtuel personnalisé, en concevant un « modèle » de base et en y additionnant les informations individuelles du patient, comme la façon, propre à chaque individu, dont sont organisées les régions de son cerveau et l’interconnexion des aires entre elles. Le résultat permet de tester sur celui-ci des modèles mathématiques engendrant une activité cérébrale. Les scientifiques ont ainsi pu reproduire le lieu d’initiation des crises d’épilepsie et leur mode de propagation. Ce cerveau a donc une véritable valeur de prédiction du fonctionnement des crises pour chaque patient, ce qui offre un diagnostic beaucoup plus précis.
Par ailleurs, 30% des patients épileptiques ne répondent pas aux médicaments. Leur seul espoir reste alors la chirurgie. Celle-ci est efficace si le chirurgien a de bonnes indications sur les zones à opérer.
Le cerveau virtuel permet aux chirurgiens d’avoir une « plate-forme » virtuelle. Ils peuvent ainsi repérer les zones à opérer, en évitant pour ce faire d’avoir à procéder à un geste invasif, et surtout de préparer l’opération en testant différents gestes possibles, en voyant lequel est le plus efficace et quelles sont ses conséquences, chose évidemment impossible à faire sur le patient.
A terme, le but de l’équipe est d’offrir une médecine personnalisée du cerveau, en proposant, grâce à la virtualisation, des solutions thérapeutiques individualisées et spécifiques pour chaque patient. Les chercheurs travaillent actuellement sur des essais cliniques, afin de démontrer la valeur prédictive de leur découverte. Cette technologie est par ailleurs à l’essai sur d’autres pathologies affectant le cerveau, comme l’AVC, Alzheimer, les maladies neuro dégénératives, ou la sclérose en plaques.
Ces travaux impliquent des chercheurs de l’Institut de neurosciences des systèmes (Inserm/AMU), du Centre de résonance magnétique biologique et médicale (CNRS/AMU/AP-HM), du département épileptologie et du département neurophysiologie clinique de l’AP-HM, et l’Epilepsy Center de Cleveland. Ils ont été réalisés au sein de la Fédération hospitalo-universitaire Epinext (www.epinext.org).
Le Patient Epileptique Virtuel : les régions du cerveau et leurs connexions sont reconstruites par ordinateur. Les simulations numériques génèrent un signal électrique similaire à celui généré par le cerveau pendant les crises. Ces simulations permettent de tester informatiquement de nouvelles stratégies thérapeutiques
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des techniques synchrotrons révèlent l’action d’une molécule métallo-organique dans des cellules d’une forme agressive du cancer du sein |
|
|
| |
|
| |

Des techniques synchrotrons révèlent l’action d’une molécule métallo-organique dans des cellules d’une forme agressive du cancer du sein
| 04 FÉVR. 2019 - 15H18 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
CANCER
Cartographie par fluorescence excitée par rayonnement synchrotron de la distribution du potassium, élément physiologique essentiel de la cellule (K, rose) et, de l’osmium (Os, vert), élément constitutif du dérivé osmocénique de l’hydroxytamoxifène, au sein de cellules de cancer du sein type triple négatif. Credits: Sylvain Bohic.
Certains types de cancer, comme le cancer du sein type triple négatif, restent réfractaires aux traitements par chimiothérapie. Des scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne université, de l’université PSL, de l’Université Grenoble Alpes et de l’ESRF, le synchrotron européen de Grenoble, ont étudié une molécule organométallique, intéressante pour son activité antitumorale. Leurs recherches ont apporté une meilleure compréhension de son mécanisme d’action. Ces résultats sont publiés dans Angewandte Chemie.
Le cancer du sein type triple négatif (TNBC en anglais, « triple negative breast cancer »), représente 10 à 20% des cas de cancers du sein. Il se caractérise par l’absence de récepteur des œstrogènes, de récepteur de la progestérone et de récepteurs du facteur de croissance épidermique humaine (HER2). Ceci signifie qu’il ne répond ni à l’hormonothérapie ni à l’immunothérapie. Le manque de cibles moléculaires pour le traitement adapté de ce type de cancer très agressif reste un défi pour la communauté scientifique et médicale.
Une équipe pluridisciplinaire de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), du CNRS, de Sorbonne université, de l’université PSL, de l’Université Grenoble Alpes et de l’ESRF, a étudié une molécule organométallique de la famille des métallocènes, un dérivé du métabolite actif du tamoxifène, – un médicament oral d’hormonothérapie très utilisé pour la prévention et le traitement du cancer du sein non invasif et invasif – , et précisé son mécanisme d’action au sein de cellules de cancer du sein type triple négatif.
Ces composés organométalliques ont été développés par le professeur G.Jaouen et son groupe à Sorbonne université et à l’université PSL à Paris. Il sont démontré leur large spectre d’efficacité envers différents types de cellules cancéreuses et leur potentiel à surmonter la résistance aux médicaments anticancéreux.
« Nous connaissions l’efficacité de cette molécule à base d’osmium grâce aux travaux approfondis déjà effectués. Mais, nous ne connaissions pas exactement son mécanisme d’action dans des cellules de cancer du sein type triple-négatif. C’est pourquoi nous avons localisé et mesuré les concentrations de cette molécule à l’intérieur même de la cellule cancéreuse, afin de mieux évaluer son efficacité », explique Sylvain Bohic, chercheur Inserm et auteur principal de l’étude.
Les chercheurs ont utilisé la ligne de lumière ID16A pour leur expérience. La technique de pointe de nano-imagerie synchrotron permet un éclairage unique sur la distribution intracellulaire de ce métallocène, avec une résolution de 35 nanomètres. « Depuis plusieurs années, les recherches sont menées dans ce domaine. Aujourd’hui, elles bénéficient des dernières techniques en matière de cryo-fluorescence des rayons X en 2D et 3D » explique Peter Cloetens, scientifique ESRF, en charge de ID16A.
Pour la première fois, l’équipe scientifique a montré comment la molécule pénètre aisément les membranes de la cellule cancéreuse en raison de sa nature lipophile et comment elle cible un organite cellulaire essentiel, le réticulum endoplasmique, un réseau de tubules membranaires (souvent interconnectées) dispersées dans tout le cytoplasme des cellules eucaryotes. La molécule, un dérivé osmocénique de l’hydroxytamoxifène, qui est oxydée à cet endroit engendre des métabolites qui vont attaquer différentes parties de la cellule en même temps, menant à l’activité anticancéreuse observée. « la cellule cancéreuse doit faire face à de nombreux feux démarrant à différents endroits dans la cellule. La cellule tumorale, débordée par autant d’attaques, ne peut faire face et meurt, ou s’inactive»,explique S. Bohic.
Les résultats sont prometteurs. En effet, cette nouvelle famille de composés organométalliques, qui présentent un mécanisme d’action multi-cibles, pourrait devenir une alternative intéressante dans l’arsenal de chimiothérapie classique et, permettre de surmonter la résistance aux médicaments actuels tout en ayant un coût faible. Le médicament Cisplatine, une autre molécule contenant un métal de transition qui est largement utilisé pour le traitement du cancer, a comme cible primaire l’ADN qu’il endommage à l’intérieur de la cellule. Souvent efficace, il a cependant des effets secondaires et les cellules cancéreuses développent aussi des mécanismes de résistance à ce type de chimiothérapie. Le cancer du sein triple négatif, comme d’autres cancers, est souvent résistant au Cisplatine. « Cette étude contribue au développement de mécanismes alternatifs à ceux des molécules de chimiothérapie classique utilisées dans le traitement des cancers. Nous sommes au début de cette recherche. A ce stade, des tests cliniques ne peuvent être envisagés, mais cette étude est prometteuse »,indique leprof.G.Jaouen co-auteur de cette étude.
La prochaine étape est de découvrir comment cette molécule agit sur des cellules saines et d’étudier sa toxicologie.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer |
|
|
| |
|
| |

Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer
COMMUNIQUÉ | 15 FÉVR. 2018 - 10H05 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
SANTÉ PUBLIQUE
Une nouvelle étude associant des chercheurs de l’Inserm, de l’Inra et de l’Université Paris 13 (Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité, équipe EREN) suggère une association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et le sur-risque de développer un cancer. Au total, 104 980 participants de la cohorte française NutriNet-Santé ont été inclus. Au cours du suivi (8 ans), 2 228 cas de cancers ont été diagnostiqués et validés. Une augmentation de 10% de la proportion d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire s’est révélée être associée à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer au global et un cancer du sein en particulier. Parmi les différentes hypothèses qui pourraient expliquer ces résultats, la moins bonne qualité nutritionnelle globale des aliments ultra-transformés ne serait pas la seule impliquée, suggérant des mécanismes mettant en jeu d’autres composés (additifs, substances formées lors des process industriels, matériaux au contact des aliments, etc.). Ces résultats doivent donc être considérés comme une première piste d’investigation dans ce domaine et doivent être confirmés dans d’autres populations d’étude. Notamment, le lien de cause à effet reste à démontrer. Cette étude est publiée le 15 février 2018 dans le British Medical Journal.
Durant les dernières décennies, les habitudes alimentaires se sont modifiées dans le sens d’une augmentation de la consommation d’aliments ultra-transformés qui contribuent aujourd’hui à plus de la moitié des apports énergétiques dans de nombreux pays occidentaux. Ils se caractérisent souvent par une qualité nutritionnelle plus faible, mais aussi par la présence d’additifs alimentaires, de composés néoformés et de composés provenant des emballages et autres matériaux de contact.
Des études récentes ont montré des associations entre la consommation d’aliments ultra-transformés et un risque accru de dyslipidémies, de surpoids, d’obésité, et d’hypertension artérielle. Toutefois, aucune étude n’a porté sur le risque de cancer, alors que des expérimentations chez l’animal suggèrent de potentiels effets cancérogènes de plusieurs composants habituellement présents dans les aliments ultra-transformés.
Au total, 104 980 participants de la cohorte française NutriNet-Santé (suivis entre 2009 et 2017) ont été inclus. Les données alimentaires ont été recueillies à l’entrée dans l’étude à l’aide d’enregistrements de 24h répétés, conçus pour évaluer la consommation habituelle des participants pour 3300 aliments différents. Ceux-ci ont été classés en fonction de leur degré de transformation par la classification NOVA (voir encadré ci-dessous).
Au cours du suivi, 2 228 cas de cancers ont été diagnostiqués et validés. Une augmentation de 10% de la proportion d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire s’est révélée être associée à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer au global et un cancer du sein en particulier. Ces résultats étaient significatifs après prise en compte d’un grand nombre de facteurs sociodémographiques et liés au mode de vie, et également en tenant compte de la qualité nutritionnelle de l’alimentation. Ceci suggère que la moins bonne qualité nutritionnelle globale des aliments ultra-transformés ne serait pas le seul facteur impliqué dans cette relation.
Ces résultats doivent être considérés comme une première piste d’investigation dans ce domaine et doivent être confirmés dans d’autres populations d’étude. Notamment, le lien de cause à effet reste à démontrer. De même, d’autres études sont nécessaires afin de mieux comprendre l’impact relatif des différentes dimensions de la transformation des aliments (composition nutritionnelle, additifs alimentaires, matériaux de contact et contaminants néoformés) dans ces relations.
Pour poursuivre ces travaux, l’équipe de recherche lance actuellement un nouveau programme sur les additifs alimentaires, dont l’objectif principal sera d’évaluer les expositions alimentaires usuelles à ces substances et d’étudier leurs effets potentiels sur la santé et la survenue de maladies chroniques. Ceci sera rendu possible grâce à une évaluation précise et répétée de l’exposition alimentaire dans la cohorte NutriNet-Santé (mais également des compléments alimentaires et des médicaments), incluant les marques et noms commerciaux des aliments industriels consommés. Ce dernier point est fondamental pour estimer de manière précise l’exposition aux additifs au niveau individuel étant donné la grande variabilité des compositions entre les marques. Le recrutement de nouveaux volontaires pour participer à l’étude NutriNet-Santé se poursuit. Il suffit pour cela de s’inscrire en ligne (www.etude-nutrinet-sante.fr) et de remplir des questionnaires, qui permettront aux chercheurs de faire progresser les connaissances sur les relations entre nutrition et santé et ainsi d’améliorer la prévention des maladies chroniques par notre alimentation.
Définition et exemples d’aliments ultra-transformés
La classification NOVA permet de catégoriser les aliments selon 4 groupes, en fonction de leur degré de transformation industrielle (aliments peu ou pas transformés, ingrédients culinaires, aliments transformés, aliments ultra-transformés). Cette étude portait sur le groupe des «aliments ultra-transformés», qui comprend par exemple les pains et brioches industriels, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs, les sodas et boissons sucrées aromatisées, les nuggets de volaille et de poisson, les soupes instantanées, les plats cuisinés congelés ou prêts à consommer, et tous produits transformés avec ajout de conservateurs autre que le sel (nitrites par exemple), ainsi que les produits alimentaires principalement ou entièrement constitués de sucre, de matières grasses et d’autres substances non utilisées dans les préparations culinaires telles que les huiles hydrogénées et les amidons modifiés. Les procédés industriels comprennent par exemple l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion, et le prétraitement par friture. Des colorants, émulsifiants, texturants, édulcorants et d’autres additifs sont souvent ajoutés à ces produits.
Exemples :
-Les compotes de fruits avec seulement du sucre ajouté sont considérées comme des «aliments transformés», tandis que les desserts aux fruits aromatisés avec du sucre ajouté, mais également des agents texturants et des colorants sont considérés comme des «aliments ultra-transformés».
-Les viandes rouges ou blanches salées sont considérées comme des «aliments transformés» alors que les viandes fumées et/ou avec des nitrites et des conservateurs ajoutés, comme les saucisses et le jambon, sont classées comme «aliments ultra-transformés».
-De même, les conserves de légumes uniquement salées sont considérées comme des «aliments transformés» alors que les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés (comme les poêlées industrielles de légumes) sont considérés comme des «aliments ultra-transformés».
Source : Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC, Jaime PC. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutr 2018;21:5-17. http://dx.doi.org/10.1017/S1368980017000234
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Selon le sexe et l’âge, les cellules immunitaires du cerveau réagissent différemment à des perturbations du microbiote |
|
|
| |
|
| |

Selon le sexe et l’âge, les cellules immunitaires du cerveau réagissent différemment à des perturbations du microbiote
COMMUNIQUÉ | 21 DÉC. 2017 - 18H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
©AdobeStock
Une étude conjointe entre des chercheurs Inserm de l’IBENS (Institut de biologie de l’Ecole Normale Supérieure – Inserm/CNRS/ENS Paris) à Paris et des chercheurs du SIgN (Singapore Immunology Network, A*STAR) de Singapour montre un rôle inédit du microbiote sur des cellules immunitaires du cerveau dès le stade fœtal. Ces cellules immunitaires, les microglies, jouent un rôle clé dans le développement et le fonctionnement cérébral et sont différemment perturbées par des modifications du microbiote chez les souris mâles et femelles à différents stades de la vie. Les résultats de ces travaux sont publiés dans la revue Cell.
Les microglies sont des cellules immunitaires qui répondent à des traumatismes ou des signaux inflammatoires pour protéger le cerveau, agissant comme des senseurs capables de détecter de nombreux signaux environnementaux. Ces cellules immunitaires sont également impliquées dans différentes étapes du développement et du fonctionnement cérébral. Ainsi, des dysfonctionnements de ces cellules sont associés à un large spectre de pathologies humaines, allant des troubles neuro-développementaux jusqu’aux maladies neurodégénératives. Les microglies jouent donc un rôle crucial dans le fonctionnement normal et pathologique du cerveau, ce qui laisse suggérer qu’elles constituent une interface régulatrice entre les circuits cérébraux et l’environnement.
Pour tester cette hypothèse, Morgane Thion et Sonia Garel, chercheuses Inserm, et leurs collaborateurs, ont utilisé une approche multidisciplinaire sur des modèles de souris axéniques, qui n’ont pas de microbiote (ensemble des bactéries présentes dans l’organisme) et des modèles de souris adultes traitées avec un cocktail d’antibiotiques (qui détruisent de façon aigue le microbiote). En combinant analyses génomiques globales et études histologiques, les chercheurs ont montré que les microglies sont profondément affectées par un dysfonctionnement du microbiote, dès les stades prénataux et ce, en fonction du sexe de l’animal : les microglies appartenant à des mâles semblent affectées au stade prénatal alors que les microglies issues de femelles le sont à l’âge adulte. Ce surprenant dimorphisme sexuel fait écho au fait que l’occurrence de nombreuses pathologies neurodéveloppementales est plus élevée chez les hommes alors que les maladies auto-immunes sont plutôt prévalentes chez les femmes.
Si les mécanismes impliqués et les conséquences fonctionnelles restent à découvrir, cette étude révèle un rôle clé des microglies à l’interface entre environnement et cerveau et montre que les mâles et femelles auraient des susceptibilités différentes à des altérations du microbiote. Pour les auteurs, ces éléments mériteraient maintenant d’être pris en considération au niveau clinique et ce, dès les stades fœtaux.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
