|
|
|
|
 |
|
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) |
|
|
| |
|
| |

Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
Sous titre
Vers une meilleure prise en charge
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont des comportements répétitifs et irraisonnés mais irrépressibles qui touchent le plus souvent des sujets jeunes, voire des enfants. Des traitements médicamenteux et les thérapies cognitivo-comportementales
thérapies cognitivo-comportementales
Traitement des difficultés du patient dans « l’ici et maintenant » par des exercices pratiques centrés sur les symptômes observables au travers du comportement.
permettent de soulager certains patients. D’autres solutions thérapeutiques, comme la stimulation cérébrale profonde
stimulation cérébrale profonde
Consiste à délivrer un courant électrique de faible intensité dans certaines structures spécifiques du cerveau, grâce à des électrodes directement implantées.
ou la chirurgie dite lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les plus sévères. Les progrès en imagerie médicale et le développement de modèles animaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes des TOC au cours des dernières années.
Dossier réalisé en collaboration avec Antoine Pelissolo (UPMC - CNRS USR 3246, service de psychiatrie adulte, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris) et Luc Mallet (UPMC - Inserm UMRS 975 - CNRS UMR 7225, Institut du cerveau et de la moelle épinière- ICM, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)
Comprendre les TOC
Des obsessions irraisonnées et des comportements irrépressibles
Se laver les mains de façon répétée, vérifier sans cesse que la machine à café est bien éteinte ou encore remettre systématiquement les objets à leur place relèvent de ces comportements appelés troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Les personnes qui souffrent de TOC sont obsédées par la propreté, l'ordre, la symétrie ou sont envahies de doutes et de peurs irrationnels. Pour réduire leur anxiété, elles effectuent des rituels de rangement, de lavage ou de vérification durant plusieurs heures chaque jour dans les cas graves.
Les obsessions typiques sont la propreté, les germes et la contamination, la peur de commettre des actes d'impulsions violentes ou agressives ou encore le sentiment de se sentir excessivement responsable de la sécurité d'autrui. Il s’agit d’une véritable maladie, très handicapante au quotidien, pouvant même empêcher une vie sociale ou professionnelle normale. La personne perd le sens des priorités, même si elle a conscience que ses obsessions proviennent de sa propre activité mentale.
La maladie touche le plus souvent des sujets jeunes, voire des enfants. La plupart des obsessions et compulsions sont les mêmes que chez les adultes. Chez l’enfant, les compulsions impliquent le plus souvent la famille. Ils peuvent, par exemple, insister pour que leur linge soit lavé de nombreuses fois, vérifier de façon répétée leur travail ou se mettre en colère face au désordre d’autres membres de la famille.
Quelle fréquence parmi la population ?
Les TOC touchent environ 2 % de la population (1). Il s’agit ainsi de la 4e pathologie psychiatrique la plus fréquente après les troubles phobiques, les addictions et les troubles dépressifs. Le début du trouble est le plus souvent précoce et son évolution est chronique : environ 65 % des cas débutent avant l'âge de 25 ans et 15 % après 35 ans. Il peut survenir dès la petite enfance avec une prévalence
prévalence
Nombre de cas enregistrés à un temps T.
allant jusqu’à 3,6 % avant 18 ans (2).
Des mécanismes propres et communs à d’autres maladies psychiatriques
Les progrès en imagerie médicale ou encore le développement de modèles animaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes de la maladie au cours des dernières années. Les scientifiques ont identifié plusieurs circuits cérébraux perturbés, notamment les ganglions de la base
ganglions de la base
Zone du cerveau impliquée dans les fonctions motrices, oculomotrices, cognitives et limbiques.
impliqués dans le comportement et la motricité, ou encore le cortex cingulaire antérieur et le cortex orbito-frontal, davantage impliqués dans la gestion des émotions. Les malades présentent une hyperactivité au niveau de ces zones qui pourrait s’expliquer par l’action de certains neuromédiateurs comme la sérotonine
sérotonine
Un des principaux transmetteurs du système nerveux central.
, la dopamine
dopamine
Hormone sécrétée par certains neurones dopaminergiques, impliquée dans le contrôle de la motricité, dans la maladie de Parkinson ou encore les addictions.
ou encore la vasopressine.
Le dysfonctionnement des structures impliquées dans les émotions est retrouvé dans d’autres maladies psychiatriques. Cela pourrait expliquer en partie le fait que la maladie est souvent associée à d’autres troubles psychiatriques : dépression, trouble anxieux ou encore phobie sociale. En revanche, la perturbation des ganglions de la base est spécifique aux troubles obsessionnels compulsifs et pourrait expliquer les problèmes de contrôle de l’action chez ces patients.
Par ailleurs, les études familiales ont montré l’influence de facteurs génétiques dans l’émergence de la maladie, même si leur rôle reste mal défini(1).
Quels traitements pour quels patients ?
En cas d’angoisse et/ou de handicap lié aux troubles, la maladie doit être prise en charge. Les traitements de référence chez l’adulte et l’enfant sont les antidépresseurs (inhibiteurs de recapture de la sérotonine en première intention) et la thérapie cognitivo-comportementale (séances individuelles ou familiales, hebdomadaires ou quotidiennes en fonction de la sévérité) ou l’association des deux. Les antipsychotiques qui ciblent la dopamine peuvent également être utiles. Ces traitements permettent d’améliorer nettement deux tiers des patients et d’en guérir environ 20 % (1).
De nombreux patients restent donc réfractaires à la prise en charge. On parle alors de troubles obsessionnels compulsifs résistants. Pour ces derniers, des techniques chirurgicales ou de stimulation cérébrale peuvent être proposées au cas par cas.
Les enjeux de la recherche
Vers un nouveau mode de prise en charge des TOC résistants
Les traitements médicamenteux actuels ne sont pas satisfaisants pour deux raisons, ils ne ciblent pas des mécanismes spécifiques de la maladie et laissent de nombreux patients en échec thérapeutique. A ce titre, de nouvelles techniques font peu à peu leur chemin.
La chirurgie lésionnelle est pratiquée au cas par cas chez les sujets les plus sévères. Elle consiste actuellement à léser légèrement une zone du cerveau impliquée dans le TOC à l’aide de rayons gamma, sans ouverture de la boîte crânienne. Le taux de réponse varie de 50 % à 67 % mais l’incertitude plane sur le choix des zones à cibler (1). En outre, ces lésions sont irréversibles et la technique est donc éthiquement discutable. Elle pourrait être rapidement abandonnée au profit de la stimulation cérébrale profonde ou la stimulation magnétique transcrânienne qui sont réversibles, et être réservée aux cas exceptionnels de patients justifiant une intervention et présentant une contre-indication à ces dernières techniques.
La stimulation cérébrale profonde est actuellement évaluée chez les patients les plus atteints. Elle a déjà fait ses preuves dans le traitement de la maladie de Parkinson ou encore de l’épilepsie et les complications sont relativement rares. Elle consiste à implanter des électrodes dans le cerveau et à envoyer de façon chronique des impulsions électriques permettant de moduler l’activité de certaines zones impliquées dans la production des comportements. Ces électrodes sont connectées à un neurostimulateur implanté sous la peau et les paramètres de stimulation (fréquence, voltage, durée d’impulsion) sont ajustés par le médecin à l’aide d’un programmateur externe.
Une étude française parue en 2008 (3) montre qu’après trois mois de stimulation, deux tiers des patients répondent au traitement avec la disparition de plus d’un quart des symptômes et le retour à un fonctionnement global satisfaisant. Les auteurs ont par ailleurs constaté que certains dysfonctionnements étaient prédictifs de la réponse à ce traitement (4).
Trois études sont en cours en France pour identifier les meilleures cibles à stimuler, évaluer le bénéfice de cette technique versus placebo
placebo
Médicament composé de substances neutres, sans effet pharmacologique dans la maladie considérée.
ou encore le coût de cette prise en charge par rapport aux coûts de la maladie. Il s’agit des études PRESTOC2, UNIBIL et STOC2. Cette dernière compare la stimulation du striatum ventral ou du noyau sous-thalamique
noyau sous-thalamique
Zone du cerveau associée à la commande des mouvements.
chez une trentaine de patients.
La stimulation magnétique transcrânienne est également en cours d’évaluation. Elle est moins invasive puisqu’elle ne nécessite pas l’implantation d’électrodes et repose sur l’application d’un champ magnétique dirigé vers certaines zones du cerveau impliquées dans la maladie.
Cette technique est utilisée depuis plus de 10 ans dans la dépression et montre des résultats préliminaires positifs dans les TOC. Une étude est en cours chez 40 patients versus placebo pour une durée de trois ans.
Les autres champs de la recherche
Mécanismes de la maladie
La recherche se poursuit pour tenter de clarifier les dysfonctionnements à l’origine de la maladie. Des travaux ont récemment mis en avant l’implication probable de facteurs auto-immuns dans certaines formes précoces de la maladie. Des auto-anticorps seraient dirigés contre les ganglions de la base, siège de la motricité et du comportement, entraînant des dysfonctionnements neuronaux. Ce phénomène serait concomitant à des infections, par exemple à streptocoque chez l’enfant, qui dérégleraient le système immunitaire (5).
Suivi des patients atteints de TOC
Les experts cherchent par ailleurs à mieux connaître le devenir des patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs, notamment grâce à des études de cohortes. Une étude longitudinale démarre ainsi dans quatre centres français dont l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette étude, dite RADAR, permettra de suivre 200 patients pendant trois ans afin de récupérer des données sur l’évolution de la maladie, les facteurs de risque, les comorbidités
comorbidités
Maladie associée à une pathologie principale.
, les complications, les traitements mis en œuvre, etc.
Notes
(1) Haute Autorité de Santé, Rapport 2004 "Troubles obsessionnels compulsifs résistants : prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle"
(2) Association AFTOC
(3) Mallet et coll. Subthalamic Nucleus Stimulation in Severe Obsessive Compulsive Disorder. New England Journal of Medicine, Volume 359, Issue 20: November 13, 2008
(4) Welter et coll. Basal ganglia dysfunction in OCD: subthalamic neuronal activity correlates with symptoms severity and predicts high-frequency stimulation efficacy. Translational Psychiatry (2011) 1, e5 (groupe Nature)
(5) Nicholson TR et coll. Prevalence of anti-basal ganglia antibodies in adult obsessive−compulsive disorder: cross-sectional study. Br J Psychiatry. 2012 Jan 26.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le sommeil réduit les capacités de prédiction du cerveau |
|
|
| |
|
| |
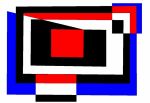
Le sommeil réduit les capacités de prédiction du cerveau
COMMUNIQUÉ | 03 MARS 2015 - 17H56 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Pourquoi ne prenons-nous pas conscience des bruits extérieurs pendant notre sommeil ? Une étude, réalisée à Neurospin (CEA/Inserm), en collaboration avec le centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP), l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), Collège de France et les Universités Paris-Sud et Paris-Descartes, montre que même si les sons pénètrent toujours dans le cortex auditif, le sommeil perturbe la capacité du cerveau à les anticiper. Les chercheurs ont démontré que le cerveau n’est plus capable d’élaborer des prédictions dans le sommeil, car les signaux prédictifs en provenance des aires corticales supérieures semblent abolis. Ces résultats sont publiés dans la revue américaine PNAS du 2 Mars 2015.
A l’écoute d’une mélodie, le cerveau à l’état de veille utilise les régularités de la séquence de sons pour prédire les sons à venir. Cette capacité de prédiction s’appuie sur un fonctionnement hiérarchique d’un ensemble d’aires cérébrales. Si un son rompt la régularité de la séquence, le cerveau génère alors une série de signaux d’erreurs de prédiction responsables entre autres des réactions à la nouveauté ou des réactions de surprise. Des études antérieures en électro-encéphalographie ont permis de décrire au moins deux signaux d’erreur successifs : la Mismatch Négativité (MMN) et la P300. La MMN a déjà été observée chez des sujets à l’état non conscient (y compris en état de coma), alors que la P300 serait spécifique du traitement conscient, car elle reflète l’intégration de l’information à travers un vaste réseau cérébral au-delà des régions auditives.
Au cours du sommeil, les sons de l’environnement ne sont pas consciemment perçus. Cependant, on ne sait pas à quel niveau s’interrompt l’intégration de ces sons par le cerveau, et si il est toujours capable d’en extraire les régularités et de les anticiper. Cet aspect particulier du fonctionnement du cerveau a été testé par une équipe de Neurospin (Inserm/CEA), en collaboration avec le centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP), l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), Collège de France et les Universités Paris-Sud et Paris-Descartes. Les chercheurs ont étudié, par électro et magnétoencéphalographie (E/MEG), les signaux d’erreurs de prédiction (la MMN et la P300) chez des sujets éveillés et endormis.
Les chercheurs ont invité des volontaires à s’endormir à l’intérieur de la machine de magnéto-encéphalographie de NeuroSpin, en présence de sons répétitifs. Les résultats ont confirmé que la P300 est un marqueur spécifique du traitement conscient des sons, puisqu’elle disparaissait dès l’endormissement, dès lors que les sujets n’étaient plus réactifs aux sons. Par contre, la MMN a été observée dans tous les stades de sommeil (sommeil lent et sommeil paradoxal). Cependant, ce signal n’est que partiellement maintenu puisque certaines aires cérébrales, qui normalement s’activent à l’état éveillé, ne répondent plus au stimulus sonore. En effet, le pic d’activité qui résulte d’une erreur de prédiction chez un individu éveillé disparaît pendant le sommeil. Seuls persistent des phénomènes passifs d’adaptation sensorielle, localisés aux aires auditives primaires.
Les chercheurs ont donc démontré que, par un défaut de communication entre les aires cérébrales, le cerveau n’est plus capable d’élaborer des prédictions dans le sommeil.
Il reste cependant capable de représenter les sons au sein des aires auditives et de s’y habituer s’ils sont fréquents, ce qui explique pourquoi une alarme nous réveille, mais pas le bruit régulier de l’horloge.
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L’intelligence artificielle facilite l’évaluation de la toxicité des substances chimiques : le cas du bisphénol S. |
|
|
| |
|
| |

L’intelligence artificielle facilite l’évaluation de la toxicité des substances chimiques : le cas du bisphénol S.
COMMUNIQUÉ | 17 AVRIL 2019 - 15H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION | SANTÉ PUBLIQUE
Un nouvel outil informatique fondé sur les méthodes de l’intelligence artificielle a permis d’identifier des effets toxiques du bisphénol S, substitut fréquent du bisphénol A dans les contenants alimentaires, à partir de données déjà publiées. Plus largement, cet outil développé par des chercheurs de l’Inserm menés par Karine Audouze, au sein de l’unité 1124 “Toxicité Environnementale, Cibles Thérapeutiques, Signalisation Cellulaire et Biomarqueurs”(Inserm/Université de Paris), permettra de révéler des effets toxiques de n’importe quelle substance chimique (ou d’un agent physique) sous réserve qu’elle ait fait l’objet d’études publiées ou soit présente dans des bases de données. Les étapes de développement et d’utilisation de cet outil sont décrites dans Environmental Health Perspectives.
L’intelligence artificielle permet désormais d’analyser de manière conjointe les bases de données et la littérature scientifique pour évaluer la toxicité d’une molécule chez l’homme. Cette « méta-analyse in-silico » est devenue possible grâce à un programme informatique conçu par Karine Audouze et ses collègues de l’unité Inserm UMR-S1124 (Toxicité Environnementale, Cibles Thérapeutiques, Signalisation Cellulaire et Biomarqueurs). Il a été validé par la recherche de toxicité du bisphénol S, un substitut fréquent du bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien déjà interdit dans les contenants alimentaires.
En pratique, les chercheurs ont intégré plusieurs types de données biologiques et chimiques dans leur programme informatique dont les 2000 termes référencés dans la base AOP-wiki (AOP pour Adverse Outcome Pathways). « Cette base est composée des descriptions précises de toutes les étapes biologiques (molécules, voies de signalisation) menant d’une perturbation moléculaire à un effet pathologique comme l’obésité, la stéatose, le cancer, etc. Elle s’enrichit régulièrement avec de nouveaux processus de toxicité », précise Karine Audouze. Parallèlement, le bisphénol S ayant servi à tester ce programme, les auteurs ont intégré toutes les appellations et synonymes de ce constituant retrouvés dans la littérature scientifique. Ainsi équipé, le programme a scanné les résumés d’articles scientifiques soumis par les auteurs, à la recherche de ces termes pré-enregistrés. « L’objectif était d’établir des liens entre les termes représentant la substance chimique et ceux correspondant aux processus pathologiques », clarifie Karine Audouze. Pour cela, les chercheurs ont appris à leur système à lire intelligemment. Ainsi, le programme accorde plus de poids à des termes retrouvés côte à côte plutôt qu’éloignés, à ceux qui sont placés en fin de résumé dans les résultats et les conclusions plutôt qu’en début au stade de l’hypothèse, et enfin, en quantifiant les mots repérés. « Au-delà d’une lecture rapide, le système permet une véritable analyse de texte automatisée ».
L’analyse a finalement révélé une corrélation entre le bisphénol S et le risque d’obésité qui a ensuite été vérifiée manuellement par les auteurs. Puis, pour augmenter encore les performances de leur outil, les auteurs ont également intégré les données biologiques issues de la base américaine ToxCast qui référence les effets de nombreux agents chimiques et physiques sur différents types cellulaires grâce à des analyses robotisées. « Cette stratégie permet ainsi de suggérer des mécanismes associés à la toxicité découverte par le programme », explique Karine Audouze Les chercheurs ont ainsi constaté que le bisphénol S favorisait la formation d’adipocytes.
« Cet outil informatique peut être utilisé pour établir un bilan rapide des effets d’un agent chimique, ce qui est souhaitable s’il s’agit d’un substitut proposé pour une substance existante. Il n’apporte pas, en tant que tel, de preuve de toxicité, mais sert à intégrer rapidement un grand nombre d’informations et à hiérarchiser les effets néfastes les plus probables, permettant ainsi de concevoir les études biologiques et épidémiologiques les plus pertinentes », illustre Karine Audouze.
Cet outil est désormais libre d’accès sur la plateforme GitHub. Tout chercheur désireux de tester la toxicité d’un agent peut l’utiliser en développant un dictionnaire propre à cet agent.
Ce projet a été financé par le programme de recherche européen sur la biosurveillance humaine, HBM4EU (https://www.hbm4eu.eu).
L’intelligence artificielle facilite l’évaluation de la toxicité des substances chimiques : le cas du bisphénol S.
COMMUNIQUÉ | 17 AVRIL 2019 - 15H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION | SANTÉ PUBLIQUE
Un nouvel outil informatique fondé sur les méthodes de l’intelligence artificielle a permis d’identifier des effets toxiques du bisphénol S, substitut fréquent du bisphénol A dans les contenants alimentaires, à partir de données déjà publiées. Plus largement, cet outil développé par des chercheurs de l’Inserm menés par Karine Audouze, au sein de l’unité 1124 “Toxicité Environnementale, Cibles Thérapeutiques, Signalisation Cellulaire et Biomarqueurs”(Inserm/Université de Paris), permettra de révéler des effets toxiques de n’importe quelle substance chimique (ou d’un agent physique) sous réserve qu’elle ait fait l’objet d’études publiées ou soit présente dans des bases de données. Les étapes de développement et d’utilisation de cet outil sont décrites dans Environmental Health Perspectives.
L’intelligence artificielle permet désormais d’analyser de manière conjointe les bases de données et la littérature scientifique pour évaluer la toxicité d’une molécule chez l’homme. Cette « méta-analyse in-silico » est devenue possible grâce à un programme informatique conçu par Karine Audouze et ses collègues de l’unité Inserm UMR-S1124 (Toxicité Environnementale, Cibles Thérapeutiques, Signalisation Cellulaire et Biomarqueurs). Il a été validé par la recherche de toxicité du bisphénol S, un substitut fréquent du bisphénol A qui est un perturbateur endocrinien déjà interdit dans les contenants alimentaires.
En pratique, les chercheurs ont intégré plusieurs types de données biologiques et chimiques dans leur programme informatique dont les 2000 termes référencés dans la base AOP-wiki (AOP pour Adverse Outcome Pathways). « Cette base est composée des descriptions précises de toutes les étapes biologiques (molécules, voies de signalisation) menant d’une perturbation moléculaire à un effet pathologique comme l’obésité, la stéatose, le cancer, etc. Elle s’enrichit régulièrement avec de nouveaux processus de toxicité », précise Karine Audouze. Parallèlement, le bisphénol S ayant servi à tester ce programme, les auteurs ont intégré toutes les appellations et synonymes de ce constituant retrouvés dans la littérature scientifique. Ainsi équipé, le programme a scanné les résumés d’articles scientifiques soumis par les auteurs, à la recherche de ces termes pré-enregistrés. « L’objectif était d’établir des liens entre les termes représentant la substance chimique et ceux correspondant aux processus pathologiques », clarifie Karine Audouze. Pour cela, les chercheurs ont appris à leur système à lire intelligemment. Ainsi, le programme accorde plus de poids à des termes retrouvés côte à côte plutôt qu’éloignés, à ceux qui sont placés en fin de résumé dans les résultats et les conclusions plutôt qu’en début au stade de l’hypothèse, et enfin, en quantifiant les mots repérés. « Au-delà d’une lecture rapide, le système permet une véritable analyse de texte automatisée ».
L’analyse a finalement révélé une corrélation entre le bisphénol S et le risque d’obésité qui a ensuite été vérifiée manuellement par les auteurs. Puis, pour augmenter encore les performances de leur outil, les auteurs ont également intégré les données biologiques issues de la base américaine ToxCast qui référence les effets de nombreux agents chimiques et physiques sur différents types cellulaires grâce à des analyses robotisées. « Cette stratégie permet ainsi de suggérer des mécanismes associés à la toxicité découverte par le programme », explique Karine Audouze Les chercheurs ont ainsi constaté que le bisphénol S favorisait la formation d’adipocytes.
« Cet outil informatique peut être utilisé pour établir un bilan rapide des effets d’un agent chimique, ce qui est souhaitable s’il s’agit d’un substitut proposé pour une substance existante. Il n’apporte pas, en tant que tel, de preuve de toxicité, mais sert à intégrer rapidement un grand nombre d’informations et à hiérarchiser les effets néfastes les plus probables, permettant ainsi de concevoir les études biologiques et épidémiologiques les plus pertinentes », illustre Karine Audouze.
Cet outil est désormais libre d’accès sur la plateforme GitHub. Tout chercheur désireux de tester la toxicité d’un agent peut l’utiliser en développant un dictionnaire propre à cet agent.
Ce projet a été financé par le programme de recherche européen sur la biosurveillance humaine, HBM4EU (https://www.hbm4eu.eu).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Face aux infections, cerveau et système immunitaire coopèrent |
|
|
| |
|
| |

Face aux infections, cerveau et système immunitaire coopèrent
COMMUNIQUÉ | 13 SEPT. 2018 - 12H28 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Et si, face aux infections, notre système immunitaire n’était pas seul à combattre ? Et si son allié majeur s’avérait en fait être le cerveau ? Des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et d’Aix-Marseille Université (AMU) ont en effet pu observer des mécanismes de coopération entre le système nerveux et le système immunitaire dans la réponse aux agressions pathogènes. Ces travaux, parus dans la revue Nature Immunology mettent en évidence l’implication du cerveau dans la régulation de la réaction inflammatoire induite par le système immunitaire lors d’une infection et son effet protecteur contre un emballement autodestructeur possible de cette inflammation.
Lors d’une infection par des virus ou d’autres organismes pathogènes, le système immunitaire s’active pour éliminer l’agent infectieux. Les cellules immunitaires libèrent alors des molécules inflammatoires appelées cytokines, responsables du processus d’inflammation nécessaire pour lutter contre la dissémination des pathogènes dans le corps. Il arrive cependant que la réaction inflammatoire s’avère excessive et toxique pour l’organisme. Elle peut ainsi provoquer des lésions au niveau des organes infectés qui, lorsqu’elles sont trop importantes, peuvent mener au décès.
De précédentes études ont montré qu’en cas d’infection, le cerveau était mobilisé pour réguler la réaction inflammatoire. En effet, lorsqu’il détecte les cytokines produites par les cellules immunitaires, le cerveau induit la sécrétion dans le sang d’hormones connues pour être des régulateurs négatifs de l’inflammation : les glucocorticoïdes. Les propriétés de ces hormones sont largement utilisées en médecine dans de nombreuses conditions pathologiques mais leur mode d’action précis reste encore mal connu.
Dans ce contexte, des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et d’Aix Marseille Université (AMU) au sein du Centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CNRS/Inserm/AMU) se sont intéressés au mode d’action des glucocorticoïdes produits suite à l’activation du cerveau dans le contrôle de l’intensité de la réaction inflammatoire causée par l’infection virale chez la souris.
Ces travaux montrent que les glucocorticoïdes régulent l’activité d’une population de cellules immunitaires, productrices de cytokines inflammatoires et ayant des activités antivirales et antitumorales majeures : les cellules Natural Killer (ou NK).
Ces cellules NK possèdent un récepteur qui est activé par les glucocorticoïdes produits après l’infection. Cette activation entraîne l’expression à la surface des cellules NK d’une molécule appelée PD-1, qui suscite beaucoup d’intérêt dans le milieu médical et est ciblée dans de nombreux traitements anti-cancéreux car elle possède une action inhibitrice sur l’activité des cellules immunitaires qui l’expriment.
Les chercheurs ont ainsi observé que les souris mutantes n’exprimant pas le récepteur aux glucocorticoïdes dans leurs cellules NK, étaient plus susceptibles de développer une réaction grave d’hyper-inflammation et de succomber lors d’une infection. Ces travaux démontrent que l’expression du récepteur aux glucocorticoïdes par les cellules NK est nécessaire pour réguler l’intensité de l‘inflammation afin que la réponse contre le virus ne devienne pas toxique pour l’organisme. De plus, l’étude montre également que cette régulation est régie grâce l’effet inhibiteur de la molécule PD-1 qui, dans le contexte infectieux, limite la production de cytokines inflammatoires par les cellules NK.
Selon Sophie Ugolini, chercheuse Inserm et directrice de l’étude : « L’aspect le plus inattendu de notre découverte a été que cette régulation empêche le système immunitaire de s’emballer et de détruire les tissus sains, tout en maintenant pleinement ses propriétés antivirales nécessaires à l’élimination efficace du virus. »
Cette découverte pourrait permettre de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques qui cibleraient cette voie de régulation. Outre les infections, les chercheurs espèrent notamment pouvoir explorer la piste d’une potentielle implication de cette voie de régulation dans certains cancers.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
