|
|
|
|
 |
|
Des pansements pour régénérer les articulations |
|
|
| |
|
| |
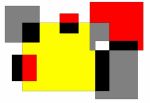
Des pansements pour régénérer les articulations
COMMUNIQUÉ | 14 MAI 2019 - 12H14 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
TECHNOLOGIE POUR LA SANTE
Des chercheurs de l’Inserm et de l’Université de Strasbourg au sein de l’Unité 1260 ” Nanomédecine régénérative” ont mis au point un implant qui, appliqué comme un pansement, permet de régénérer les cartilages en cas de lésions importantes des articulations ou d’arthrose débutante. Les détails de cette innovation validée en phase préclinique sont publiés ce jour dans Nature communication.
L’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation des traumatismes accidentels nécessitent une augmentation des interventions chirurgicales visant à remplacer une articulation défectueuse. Parmi les pathologies chroniques, l’arthrose, décrite comme une destruction du cartilage touchant toutes les structures de l’articulation, dont l’os et le tissu synovial, qui tapisse l’intérieur des articulations représente un réel problème de santé publique. Selon le diagnostic médical, plusieurs options thérapeutiques sont possibles allant de la microgreffe à la pose d’une prothèse. Néanmoins, ces interventions sont toutes invasives et/ou douloureuses pour le patient, avec une efficacité limitée et des effets secondaires.
Aujourd’hui, en dehors de la pose de prothèses, on se contente en réalité de réparer provisoirement le cartilage des articulations et d’alléger les douleurs. Les traitements consistent surtout à injecter des anti-inflammatoires ainsi que de l’acide hyaluronique pour améliorer la viscosité de l’articulation. Des cellules souches peuvent être aussi utilisées, notamment parce qu’elles sécrètent des molécules capables de contrôler l’inflammation.
Dans ce contexte et afin de régénérer ce tissu conjonctif, souple et souvent élastique qui recouvre nos articulations et permet aux os de bouger et de glisser l’un par rapport à l’autre, une équipe de recherche associant l’Inserm et l’université de Strasbourg vient de mettre au point un pansement pour le cartilage – inspiré des pansements de nouvelle génération qui forment comme une seconde peau sur les plaies cutanées. Avec les pansements développés par la chercheuse et son équipe, la réponse thérapeutique passe un nouveau cap. On n’est plus seulement dans la réparation, on parle réellement de régénération du cartilage articulaire.
L’équipe de chercheurs de l’Inserm et de l’Université de Strasbourg 1260 sous la direction de Madame Benkirane-Jessel a en effet mis au point une technique innovante d’implant ostéoarticulaire, capable de reconstituer une articulation endommagée et dont l’application peut être comparée à celle des pansements. “L’implant que nous avons développé se destine à deux cas en particulier, d’une part les grandes lésions du cartilage et d’autre part les arthroses débutantes.” explique la chercheuse.
Dans le détail, ces pansements articulaires sont composés de deux couches successives. La première, qui fait office de support (pansements classiques), est une membrane composée de nanofibres de polymères et dotée de petites vésicules contenant des facteurs de croissance en quantités similaires à celles que nos cellules sécrètent elles même. La seconde est une couche d’hydrogel chargée d’acide hyaluronique et de cellules souches provenant de la moelle osseuse du patient lui-même, ce sont ces cellules qui, en se différenciant en chondrocytes (cellules qui forment le cartilage) vont régénérer le cartilage de l’articulation.
Les scientifiques entrevoient un avenir prometteur pour leur « pansement à cartilage » : en plus de l’articulation du genou et de l’épaule, celui-ci pourrait aussi être utilisé pour l’articulation temporo-mandibulaire, liée à la mâchoire. Assez handicapante, celle-ci peut conduire à des douleurs, des bruits articulaires mais surtout à une baisse de l’amplitude de l’ouverture de la bouche. L’équipe de chercheurs a d’ores et déjà mené des essais concernant des lésions cartilagineuses chez le petit animal, la souris et le rat, ainsi que chez le grand animal, la brebis et la chèvre, des modèles très adaptés à l’étude comparée des cartilages avec l’homme. L’objectif est de lancer un essai chez l’homme avec une petite cohorte de 15 patients.
Ce projet a été soutenu par la Satt conectus, L’ANR et la grande région Est
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Alcool & Santé |
|
|
| |
|
| |

Alcool & Santé
Sous titre
Lutter contre un fardeau à multiples visages
Bien que sa consommation diminue régulièrement en France, 10% des adultes sont aujourd’hui en difficulté avec l’alcool. Une consommation abusive entraîne des complications hépatiques, cardiovasculaires, neurologiques ainsi que des cancers, et l’alcool reste la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Un enjeu majeur est actuellement de repérer les consommateurs à risque et de réduire leur consommation. L’étude de facteurs de vulnérabilité est en cours pour améliorer ce repérage et la prise en charge de l’alcoolodépendance.
Dossier réalisé en collaboration avec le Pr Mickaël Naassila, directeur de l’équipe Inserm ERI 24, "Groupe de recherche sur l'alcool & les pharmacodépendances" (GRAP) et Bertrand Nalpas, directeur de recherche à l’Inserm et chargé de la mission "Addiction"
Comprendre les problématiques Alcool & Santé
La consommation d’alcool diminue régulièrement en France depuis une quarantaine d’années : elle a été divisée par deux entre 1960 et 2009. Les données du Baromètre santé 2017 indiquent qu’environ 13,5% des adultes ne boivent jamais et 10% boivent tous les jours (15,2 % des hommes et 5,1% des femmes). Le vin reste de loin la boisson la plus consommée.
La consommation débute le plus souvent à l’adolescence, période durant laquelle la bière et les prémix (boissons alcoolisées, sucrées et aromatisées) sont les boissons les plus populaires. L’âge moyen de la première ivresse est de 15,2 ans. En 2017, 85,7% des adolescents âgés de 17 ans déclaraient avoir déjà bu de l'alcool au cours de leur vie, près d'un sur 10 (8,4%) buvait régulièrement (au moins 10 fois dans le mois) et 44% avaient connu un épisode d'alcoolisation ponctuelle important au cours du mois écoulé (Source : ESCAPAD 2017).
Une toxicité importante pour l’organisme
La consommation d'alcool expose à de multiples risques pour la santé en fonction des quantités absorbées. Elle est responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses. Certaines de ces maladies sont exclusivement attribuables à l’alcool, notamment la cirrhose alcoolique ou certaines atteintes neurologiques comme le syndrome de Korsakoff. Pour d'autres pathologies, l'alcool constitue un facteur de risques. C’est le cas de certains cancers (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, sein, cancer colorectal) et de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique). Des troubles cognitifs sont en outre observés chez plus de 50% des personnes alcoolodépendantes : altération de la mémoire, inadaptation de certains mouvements... Ces troubles sont lentement réversibles.
Le foie, cible principale des effets de l’alcool
Plusieurs maladies hépatiques peuvent être provoquées par la consommation excessive d’alcool : stéatose (accumulation de lipides dans le foie), hépatite alcoolique, cirrhose. Une étude française effectuée auprès de 2 000 consommateurs excessifs hospitalisés a montré que seulement 11% d’entre eux avaient un foie normal : 34% présentaient une cirrhose alcoolique, 46% une stéatose associée ou non à une fibrose
fibrose
Remplacement de tissus sains par des tissus cicatriciels.
et 9% une hépatite alcoolique aiguë. Il s’agit de pathologies graves : en cas de cirrhose et/ou d’hépatite alcoolique sévère, la survie à 5 ans varie de 20% à 60%.
L’alcool, deuxième cause de mortalité prématurée en France
À dose excessive, la consommation d’alcool contribue de façon directe ou indirecte à 11% des décès masculins et à 4% des décès féminins. Il s’agit de la deuxième cause de mortalité prématurée en France. Ainsi, en 2015, 41 000 décès étaient imputables à l’alcool en France. Il s’agissait surtout de cancers (16 000 décès), de maladies cardio-vasculaires (9 900 décès), de maladies digestives (6 800 morts dues à des cirrhoses) et d’accidents et suicides (5 400 morts). Les autres décès relevaient d'autres maladies dont des troubles mentaux liés à l'alcool.
Les conséquences sociales de la consommation excessive d’alcool sont également lourdes. En 2006, les tribunaux ont prononcé plus de 271 condamnations pour homicide involontaire sous emprise de l’alcool. Et dans 28 % des cas de violences conjugales enregistrées en région parisienne, l'auteur consommait régulièrement des quantités importantes d'alcool. En 2013, 111 550 condamnations pour conduite en état alcoolique (CEA) ont été inscrites au Casier judiciaire national, soit une condamnation sur cinq pour délit en France.
Repères de consommation
Les autorités de santé recommandent de :
* ne pas consommer plus de trois verres de boisson alcoolisée par jour lorsqu’on est un homme, deux verres lorsqu’on est une femme, réserver un jour par semaine sans alcool,
* ne jamais dépasser quatre verres par occasion.
Ces repères sont valables pour les adultes : aucun repère de consommation n’est validé pour les jeunes chez lesquels toute consommation peut être nocive en raison de la vulnérabilité accrue du cerveau en développement.
En deçà de ces seuils, le risque d’atteinte toxique liée à l’alcool est largement diminué mais n’est pas nul, en particulier en ce qui concerne le risque de cancer. Même consommé en quantité quotidienne faible, équivalente à 13 grammes (soit 1,3 verre), l’alcool serait responsable de 1 100 morts par an. C’est pourquoi ces seuils sont discutés et pourraient être abaissés à l’avenir.
Pour mémoire, un verre de bière (250-300 ml), un verre de vin (150 ml) et une mesure de spiritueux (30-50 ml) contiennent une quantité voisine d’alcool (environ 10 g d’éthanol).
"Binge drinking" : un comportement en hausse chez les jeunes
Chez les jeunes, la tendance est au binge drinking, pratique consistant à atteindre l’ivresse le plus rapidement possible. Les seuils sont de quatre verres ou plus d’alcool en moins de deux heures pour une fille et cinq pour un garçon, mais les consommations sont en général beaucoup plus importantes. En France, la moitié des jeunes de 17 ans ont pratiqué le binge drinking au cours des trente derniers jours et ce phénomène ne cesse d'augmenter, notamment chez les filles.
Lorsqu’elle est répétée, cette pratique a pourtant des conséquences néfastes sur la santé : diminution des capacités d’apprentissage et de mémorisation à long terme, impulsivité accrue, impact sur l’apprentissage des émotions, l’anxiété et l’humeur, hypertension, dommages hépatiques, et augmentation des risques de dépendance par la suite. Une récente étude a montré des atteintes de la substance blanche
substance blanche
Zone du cerveau constituée d’axones, les prolongements cellulaires des neurones.
corrélées à des déficits de mémoire de travail spatiale chez les étudiants binge drinkers. La vitesse de la consommation semble particulièrement impliquée dans les effets néfastes. Et une autre étude, menée sur le modèle préclinique du rat, montre que la mémoire est toujours altérée 48 heures après deux épisodes de binge drinking.
Alcool et cerveau
L’alcool agit directement sur le cerveau, avec des conséquences variables sur le comportement en fonction de la dose ingérée :
* Pour des alcoolémies inférieures ou égales à 0,50 g/l, l’éthanol a un effet stimulant qui s’accompagne d’une désinhibition : les tâches cognitives sont exécutées plus rapidement et avec une sensation subjective de facilité, mais avec un taux d’erreurs accru.
* Au-delà de 0,50 g/l, il a un effet sédatif et perturbe les fonctions motrices (perte d’équilibre, de la coordination des mouvements).
Ces effets dépendent également d’une sensibilité individuelle aux effets de l’alcool qui s’explique en partie par des facteurs génétiques.
Le devenir de l’alcool dans le corps
La concentration d’éthanol (c’est-à-dire d’alcool) dans le sang est maximale au bout de 45 minutes si l’alcool est consommé à jeun, au bout de 90 minutes s’il l’est au cours d’un repas. L’élimination se fait au rythme d’environ 0,15 g/l/h en cas de concentration supérieure à 0,50 g/l, avec d’importantes variations d’une personne à l’autre. Pour une même quantité ingérée, la concentration plasmatique en éthanol est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. De plus, les femmes métabolisent plus lentement l’alcool. Elles sont donc plus vulnérables aux effets toxiques de l’alcool.
Des effets multiples sur les neurones
Projet AlcoBinge : Microscopie et étude d'une lame histologique de coupes de cerveau de rats. GRAP "Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépendances", Amiens. © Inserm, P. Latron
Contrairement aux autres drogues, l’éthanol n’a pas de récepteurs spécifiques dans le cerveau : il agit sur de nombreuses cibles dont il modifie l’activité, perturbant la transmission de plusieurs signaux nerveux excitateurs et inhibiteurs. L’alcool stimule notamment la libération de dopamine
dopamine
Hormone sécrétée par certains neurones dopaminergiques, impliquée dans le contrôle de la motricité, dans la maladie de Parkinson ou encore les addictions.
, neuromédiateur du plaisir, impliqué dans la dépendance.
A forte dose, l’alcool entraîne un remodelage des connections entre les neurones. Ce remodelage permet au cerveau de s’adapter à cette consommation et d’en amoindrir les effets, ce qui entraîne, paradoxalement, un appel à la consommation. Ce phénomène explique le danger que représente l’alcool au cours de l’adolescence. Jusqu’à l’âge de 25 ans, le cerveau continue de se développer (myélinisation et élimination des connexions neuronales inutiles). La consommation d’alcool au cours de cette période perturbe le développement normal du cerveau et augmente le risque de dépendance.
Alcool et grossesse : le syndrome d’alcoolisation fœtale
L’exposition prénatale à l’alcool a des effets dramatiques et permanents. L’éthanol franchit facilement la barrière placentaire et les concentrations retrouvées chez le fœtus sont supérieures à celles mesurées chez la mère car le système d’élimination de l’alcool est peu développé chez le fœtus. Les conséquences sont variables, pouvant aller de troubles comportementaux mineurs, dénommés troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF), à des anomalies sévères du développement se manifestant par un syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) : malformation du crâne et du visage, retard de croissance, handicaps comportementaux et cognitifs. Près d’un enfant sur deux atteints de SAF montre un retard mental et la plupart ont des problèmes d’apprentissage, de mémoire, d’attention ou de comportement.
En France, la SAF concerne au moins 1% des naissances (1°/00 pour les formes graves de SAF complet), soit environ 8 000 nouveau-nés par an. Cela implique que près de 500 000 Français souffrent à des degrés divers de séquelles de l’alcoolisation fœtale (source : Académie de médecine, mars 2016).
L’absorption d’alcool est délétère pendant toute la période gestationnelle et il n’a jamais été mis en évidence de seuil en deçà duquel les risques sont nuls, d’où la recommandation "0 alcool pendant la grossesse". En dépit de ces risques, environ 25% des femmes enceintes reconnaissent avoir consommé de l’alcool pendant la grossesse.
Abus et dépendance : les problèmes de consommation
Toute consommation supérieure à trois verres de boisson alcoolisée par jour pour les hommes et deux pour les femmes doit être considérée à risque, même en l’absence de symptômes de dépendance.
La dépendance est quant à elle caractérisée par une consommation compulsive qui persiste en dépit des conséquences négatives qu’elle engendre et l’envie irrépressible et urgente de consommer (craving). L’individu perd totalement le contrôle de sa consommation. Il devient tolérant aux effets négatifs et présente un syndrome de sevrage quand la consommation cesse : confusion, tremblements, voir crises de convulsion. Le risque de récidive est élevé et prolongé après une période d’abstinence ou de réduction.
Un questionnaire (AUDIT) permet de dépister les consommations abusives et les dépendances à l’alcool. Environ 10% des adultes sont en difficulté avec l’alcool (15% d’hommes et 5% de femmes), principalement entre 25 et 64 ans. Cette proportion est restée stable depuis le début des années 1990. Les hommes au chômage et les travailleurs indépendants constituent les populations les plus à risque.
Tous égaux face à la dépendance ?
Il existe une vulnérabilité individuelle à la dépendance dans laquelle interviennent plusieurs facteurs : des facteurs génétiques, comportementaux (impulsivité, recherche de sensations et la prise de risque, consommation précoce) et environnementaux.
Côté génétique, des études conduites sur des familles montrent une contribution notable des facteurs génétiques dans le risque de développer une dépendance. Toutefois, à ce jour, aucun gène de prédisposition à l’addiction n’a été identifié en dépit de très nombreuses études menées dans ce domaine. On présume que la fragilité répondrait à la définition de maladie génétique complexe : de nombreuses altérations au niveau de nombreux gènes sont les déterminants multiples de la maladie, chaque modification étant par elle-même incapable d’induire le trouble.
Des travaux récents indiquent également que l’exposition à l’alcool à un stade précoce du développement - pendant l’adolescence, voire in utero - augmente le risque de devenir dépendant. Un début de la consommation dès l’âge de 11-12 ans multiplie par dix le risque de développer une dépendance par rapport à une initiation vers 18 ans.
Enfin, l’environnement - facteurs sociaux, familiaux ou encore la facilité à consommer cette drogue (prix, disponibilité, publicité, facilité à induire une dépendance) - joue un rôle important. Une étude récente démontre que faire goûter de l’alcool à un enfant facilite l’initiation de la consommation à l’adolescence et l’entrée dans un comportement de binge drinking. Une étude européenne a aussi démontré que l’exposition à l’alcool dans les médias et les films augmente la prévalence
prévalence
Nombre de cas enregistrés à un temps T.
du binge drinking.
Retour à une consommation raisonnée
Malgré le "fardeau" sanitaire et social que constituent les troubles liés à la consommation d’alcool, un faible nombre de patients est en recherche de traitement et moins de 10% bénéficient de soins spécialisés. Cela s’explique en partie par le fait que l’objectif du traitement a longtemps été d’atteindre l’abstinence totale et à vie, décourageant un certain nombre de personnes à démarrer les soins.
L’objectif de réduction de la consommation proposé depuis quelques années est plus facilement acceptable pour une partie des consommateurs excessifs et des dépendants ne souhaitant pas devenir abstinents dans un premier temps. Le but est alors de revenir à une consommation "contrôlée". Cette option choisie par environ la moitié des patients apporte déjà un bénéfice substantiel sur leur santé ; elle n’est toutefois accessible que chez ceux et celles dont la dépendance au produit est modérée.
Pour encourager les consommateurs excessifs à rentrer dans cette dynamique, un repérage précoce est nécessaire et doit être suivi d’une intervention brève consistant à informer et à sensibiliser aux dangers de l’alcool et aux seuils de consommation recommandés, afin de provoquer un changement de comportement et de diminuer le risque de développer une alcoolodépendance.
Des traitements efficaces
Le traitement de la dépendance à l’alcool repose sur une psychothérapie, une modification des liens environnementaux et sociaux et des médicaments comme le recommande la Société française d’alcoologie. L’addiction à l’alcool est une maladie chronique hautement récidivante, qui nécessite un suivi à long terme par un addictologue ou un psychologue. L’alcoolisme s’accompagne en outre souvent de troubles neuropsychiatriques tels que l’anxiété, la dépression, des troubles de l’humeur ou de la personnalité qui compliquent la prise en charge et constituent un mauvais pronostic de réponse au traitement.
Les médicaments actuellement préconisés ont tous démontré leur efficacité. Ils sont majoritairement destinés à maintenir l’abstinence et à lutter contre les rechutes. Mais, après traitement, seul un tiers des patients sont toujours abstinents au bout d’un an et 10 à 20% au bout de 4 ans. Ces médicaments (acamprosate, naltrexone ou encore disulfirame) agissent au niveau du système nerveux central
système nerveux central
Composé du cerveau et de la moelle épinière.
pour décourager la consommation d’alcool. Un nouveau médicament, le nalméfène est indiqué dans la réduction de la consommation. Il est choisi en cas de souhait de retour à une consommation contrôlée (et non d’abstinence).
Enfin, depuis octobre 2018, le baclofène est lui aussi indiqué dans la réduction de la consommation d’alcool, en complément d’un suivi psychosocial, après échec des autres traitements. Il a fait l’objet de deux études cliniques en France (Bacloville et Alpadir), ainsi qu’une étude de pharmacovigilance participative sur ses effets indésirables (Baclophone).
Il n’existe pas encore de preuve scientifique que l’association de plusieurs médicaments serait plus efficace que l’administration d’un seul. Les recherches actuelles visent à trouver des facteurs prédictifs de meilleure réponse aux différents traitements disponibles.
Les enjeux de la recherche
Les axes de recherche actuellement développés atour de la thématique "alcool et santé" couvrent plusieurs domaines : épidémiologie, sciences sociales, neurosciences, neurobiologie, cancérologie.
Traiter de la dépendance
De nombreuses équipes de chercheurs étudient les mécanismes cérébraux associés à la dépendance, notamment en s’intéressant aux structures du cerveau déjà connues pour jouer un rôle dans l’addiction. Le recours à des modèles animaux d’addiction à l’alcool permet d’étudier les bases neurobiologiques de cette dépendance et de rechercher de nouveaux traitements. Des molécules sont en cours d'évaluation, comme l’oxybate de sodium. Elles agissent sur des neurotransmissions ou sur "l'axe du stress" dont l’activité augmente pendant le sevrage, constituant un facteur de rechute.
La stimulation cérébrale profonde ciblant des sites impliqués dans l'addiction (noyau accumbens ou du noyau sous-thalamique
noyau sous-thalamique
Zone du cerveau associée à la commande des mouvements.
du cerveau) a été testée : des résultats positifs ont été obtenus chez le rat et chez l’homme (en cas de rechutes multiples). Il s’agit toutefois d’une méthode lourde, passant par une chirurgie agressive qui consiste à introduire des électrodes dans les zones profondes du cerveau. L’inactivation partielle du noyau accumbens montre également une bonne tolérance et une bonne efficacité avec seulement 25% de rechute à 12 mois.
Comprendre la vulnérabilité individuelle
Un autre objectif est de mieux comprendre les facteurs impliqués dans la vulnérabilité individuelle à la dépendance et au développement de pathologies comme la cirrhose ou l’hépatite.
Ainsi, des études génétiques sont conduites, notamment sur le génome entier, pour permettre l’identification des variations génétiques associées à la dépendance. Les chercheurs s’intéressent également aux mécanismes de développement des maladies organiques associées à la dépendance à l'alcool. Ils ont, par exemple, mis en place un modèle expérimental de la comorbidité
comorbidité
Maladie associée à une pathologie principale.
alcoolisme-schizophrénie chez le rat. Dans ce modèle, une exposition à l’alcool à l’adolescence, même lorsqu’elle est très faible, rend les animaux particulièrement vulnérables à l’alcoolisme.
Le microbiote intestinal
La flore intestinale pourrait bien jouer un rôle important dans la vulnérabilité à l’alcool. Des études montrent un lien entre sa composition et le risque de dépendance à l’alcool, notamment via l’anxiété/dépression et le craving qui favorisent les rechutes. Il existe également un lien entre la composition de ce microbiote et l’apparition de complications chez les dépendants, en particulier celle des maladies hépatiques. Transplanter le microbiote d’un patient alcoolique présentant une hépatite alcoolique sévère chez une souris saine provoque en effet l’apparition d’une inflammation et de lésions hépatiques dans les jours qui suivent. En revanche, la flore de personne alcoolique sans complication hépatique n’entraîne pas de problème hépatique chez les souris transplantées. Une nouvelle piste à explorer pour lutter contre la dépendance et les risques liés à l’alcool.
Concernant les facteurs de risque comportementaux, des études montrent que l'exposition précoce à l'alcool, que ce soit in utero ou à l'adolescence, serait un facteur de risque considérable de dépendance ultérieure. A ce titre, l'Inserm coordonne un projet européen (Alcobinge) relatif à l’impact du binge drinking sur les fonctions cognitives
fonctions cognitives
Ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance tels que la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage..., par opposition aux domaines de l'affectivité.
et le fonctionnement cérébral. Ces travaux sont conduits chez des jeunes et dans des modèles animaux. L'observation par imagerie médicale de cerveaux d'étudiants ayant ou non rapidement consommé une grande quantité d'alcool, a permis de démontrer que le binge drinking induit des atteintes cérébrales associées à des déficits cognitifs. Les atteintes, différentes entre les garçons et les filles, font l’objet d’études en cours.
La génétique bientôt prédictive de l’efficacité du traitement ?
Certains gènes impliqués dans le développement de l’alcoolodépendance pourraient également avoir une influence sur la réponse du patient à son traitement. Une étude Inserm, menée en collaboration avec une équipe hollandaise, a montré que la réponse à la naltrexone et à l’acamprosate varie selon le polymorphisme
polymorphisme
Le fait qu’une espèce présente des individus aux caractéristiques différentes au sein d’une même population/ Propriétés des gènes qui se présentent sous plusieurs formes, appelées allèles.
génétique du patient. Reste à clarifier ces liens dans des populations plus importantes et à étudier les effets à plus long terme, notamment sur la rechute. Dans un second temps, il s’agira de définir quelles sont les variations génétiques à prendre en compte pour choisir le traitement le plus adapté à un patient alcoolodépendant. Le candidat le plus intéressant aujourd’hui est un polymorphisme du gène OPRM1, codant le récepteur mu des opioïdes endogènes. Il pourrait être associé à une meilleure efficacité de la naltrexone, mais les résultats disponibles sont contradictoires et ne permettent pas de conclure.
Le fardeau sociétal
Des travaux consistent à évaluer l’ampleur des retombées socio-économiques de la consommation excessive d’alcool. Une étude récente montre qu’il s’agit de la première cause d’hospitalisation en France (pour le traitement de l’alcoolisation elle-même et de ses conséquences). Ainsi, en 2012, plus de 580 000 séjours hospitaliers en services de chirurgie, obstétrique et odontologie ont été induits par la consommation problématique d’alcool. De plus, plus de 2,7 millions de journées d’hospitalisation ont été enregistrées en psychiatrie, représentant 10,4% du total.
Une autre étude a permis de préciser le coût pour la société en termes de perte de qualité de vie, perte de production, dépenses de prévention, de répression, soins…, en intégrant les recettes des taxes prélevées sur l’alcool ou encore les économies de retraites non versées. La balance penche largement en défaveur de la consommation, avec un coût social de l’alcool proche de 120 milliards d’euros par an, à peu près équivalent à celui du tabac.
La Mission Associations de malades de l’Inserm se penche sur la thématique "Alcool"
La Mission Inserm Associations développe de nombreuses actions avec les associations de malades. Ainsi, depuis fin 2006, un groupe de travail réuni chercheurs et associations d'entraide aux personnes en difficulté avec l'alcool. Ce groupe de travail permet de réfléchir à l’interaction entre chercheurs et associations mais aussi à construire et réaliser des projets de recherche communautaires. Une rencontre-débat est organisée chaque année afin de favoriser les échanges entre membres des mouvements d’entraide, chercheurs et professionnels de santé sur des problématiques communes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Comment le cerveau participe au cancer |
|
|
| |
|
| |

Comment le cerveau participe au cancer
SCIENCE 15.05.2019
De neurones voient le jour au sein même du microenvironnement tumoral, contribuant au développement du cancer. Ces cellules nerveuses dérivent de progéniteurs provenant du cerveau et sont acheminés via la circulation sanguine. Cette découverte étonnante ouvre la voie à tout un nouveau champ de recherche, relatif au rôle du système nerveux dans le développement des cancers et aux interactions entre les systèmes vasculaires, immunitaires et nerveux dans la tumorigenèse.
La production de nouveaux neurones est un événement plutôt rare chez l’adulte, cantonné à deux régions particulières du cerveau : le gyrus denté dans l’hippocampe et la zone sous-ventriculaire. Mais voilà que l'équipe Inserm Atip-Avenir dirigée par Claire Magnon* à l'Institut de Radiobiologie cellulaire et moléculaire, dirigé par Paul-Henri Roméo (CEA, Fontenay-aux-Roses), vient de montrer que ce phénomène se produit également en dehors du système nerveux central
système nerveux central
Composé du cerveau et de la moelle épinière.
: dans les tumeurs !
En 2013, cette chercheuse avait déjà mis en évidence, dans des tumeurs de la prostate, que l’infiltration de fibres nerveuses, issues de prolongements d'axones de neurones préexistants, était associée à la survenue et à la progression de ce cancer. Depuis, d'autres études ont permis de confirmer le rôle inattendu, mais apparemment important, des fibres nerveuses dans le microenvironnement tumoral de nombreux cancers solides.
Soucieuse de comprendre l’origine du réseau neuronal tumoral, Claire Magnon a une idée surprenante : et si le réseau nerveux impliqué dans le développement des tumeurs provenaient de nouveaux neurones se formant sur place ? Et dans ce cas, comment pourrait être initiée cette neurogenèse tumorale ?
Des cellules neurales souches dans les tumeurs
Pour tester cette hypothèse, Claire Magnon a étudié les tumeurs de 52 patients atteints de cancer de la prostate. Elle y a découvert des cellules exprimant une protéine, la doublecortine (DCX), connue pour être exprimée par les cellules progénitrices neuronales, lors du développement embryonnaire et chez l’adulte dans les deux zones du cerveau où les neurones se renouvellent. De plus, dans les tumeurs étudiées, la quantité de cellules DCX+ est parfaitement corrélée à la sévérité du cancer. "Cette découverte étonnante atteste de la présence de progéniteurs neuronaux DCX+ en dehors du cerveau chez l’adulte. Et nos travaux montrent qu’ils participent bien à la formation de nouveaux neurones dans les tumeurs", clarifie-t-elle.
Une migration du cerveau vers la tumeur
Pour déterminer l’origine de ces progéniteurs neuronaux, Claire Magon a utilisé des souris transgéniques, porteuses de tumeurs. Elle a quantifié les cellules DCX+ présentes dans les deux régions du cerveau où elles résident habituellement. Elle a alors constaté que, lors de l’établissement d’une tumeur, leur quantité réduit dans l’une d’elles : la zone sous-ventriculaire. "Il y avait deux explications : soit les cellules DCX+ mourraient dans cette région sans qu’on en connaisse la cause, soit elles quittaient cette zone, ce qui pouvait expliquer leur apparition au niveau de la tumeur". Différentes expériences ont montré que cette seconde hypothèse était la bonne avec la mise en évidence du passage des cellules DCX+ de la zone sous-ventriculaire du cerveau dans la circulation sanguine et de l’extrême similarité entre les cellules centrales et celles retrouvées dans la tumeur. "En pratique, nous constatons des anomalies de perméabilité de la barrière hématoencéphalique de la zone sous-ventriculaire chez les souris cancéreuses, favorisant le passage des cellules DCX+ dans le sang. Rien ne permet pour l'instant de savoir si ce problème de perméabilité précède l’apparition du cancer sous l’effet d’autres facteurs, ou si elle est provoquée par le cancer lui-même, via des signaux issus de la tumeur en formation. Quoi qu’il en soit, les cellules DCX+ migrent dans le sang jusqu’à la tumeur, y compris dans les nodules métastatiques, où elles s’intègrent au microenvironnement. Là, elles se différencient en neuroblastes puis en neurones adrénergiques producteurs d’adrénaline. Or, l’adrénaline régule le système vasculaire et c’est probablement ce mécanisme qui favorise à son tour le développement tumoral. Mais ces hypothèses restent à vérifier".
Une piste thérapeutique
En attendant, cette recherche ouvre la porte à une nouvelle piste thérapeutique : De fait, des observations cliniques montrent que les patients atteints de cancer de la prostate qui utilisent des bêtabloquants (qui bloquent les récepteurs adrénergiques) à des fins cardiovasculaires, présentent de meilleurs taux de survie. "Il serait intéressant de tester ces médicaments en tant qu’anticancéreux" estime la chercheuse. Deux essais cliniques allant dans ce sens ont récemment ouvert aux Etats-Unis**. De façon plus générale, "l’étude de ce réseau nerveux dans le microenvironnement tumoral pourrait apporter des réponses sur le pourquoi des résistances à certains traitements et favoriser le développement de nouveaux médicaments", conclut-elle.
Note :
* Laboratoire de Cancer et Microenvironnement, Equipe Atip-Avenir, UMR967 Inserm/IBFJ-iRCM-CEA/Université Paris 11/Université Paris Diderot, Fontenay-aux-Roses
** Beta Adrenergic Receptor Blockade as a Novel Therapy for Patients With Adenocarcinoma of the Prostate et Propranolol Hydrochloride in Treating Patients With Prostate Cancer Undergoing Surgery
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Mémoire musicale : certains déficits commencent dans le cortex auditif |
|
|
| |
|
| |

Mémoire musicale : certains déficits commencent dans le cortex auditif
COMMUNIQUÉ | 25 AVRIL 2013 - 9H53 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
L’amusie congénitale est un trouble caractérisé par des compétences musicales diminuées, pouvant aller jusqu’à l’incapacité à reconnaître des mélodies très familières. Les bases neuronales de ce déficit commencent enfin à être connues. En effet, selon une étude menée par les chercheurs du CNRS et de l’Inserm au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRS / Inserm / Université Claude Bernard Lyon 1), les personnes amusiques présentent un traitement altéré de l’information musicale dans deux régions cérébrales : le cortex auditif et le cortex frontal, surtout dans l’hémisphère cérébral droit. Ces altérations semblent liées à des anomalies anatomiques dans ces mêmes cortex. Ces travaux apportent des informations précieuses sur la compréhension de l’amusie et, plus généralement, sur le « cerveau musical », c’est-à-dire sur les réseaux cérébraux impliqués dans le traitement de la musique. Ils sont publiés dans l’édition papier du mois de mai 2013 de la revue Brain.
L’amusie congénitale, qui touche entre 2 et 4% de la population, peut se manifester de diverses façons : par une difficulté à entendre une « fausse note », par le fait de « chanter faux », voire parfois par une aversion à la musique. Certaines de ces personnes affirment ressentir la musique comme une langue étrangère ou comme un simple bruit. L’amusie n’est due à aucun problème auditif ou psychologique, et ne semble pas liée à d’autres troubles neurologiques. Les recherches sur les bases neuronales de ce déficit n’ont commencé qu’il y a une dizaine d’années avec les travaux de la neuropsychologue canadienne Isabelle Peretz.
Deux équipes du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRS / Inserm / Université Claude Bernard Lyon 1) se sont notamment intéressées à l’encodage de l’information musicale et à la mémorisation à court terme des notes.
Selon des travaux antérieurs, les personnes amusiques présentent une difficulté toute particulière à percevoir la hauteur des notes (le caractère grave ou aigu). De plus, bien qu’elles retiennent tout à fait normalement des suites de mots, elles peinent à mémoriser des suites de notes.
Pour tenter de déterminer les régions cérébrales concernées par ces difficultés de mémorisation, les chercheurs ont effectué, sur un groupe de personnes amusiques en train de réaliser une tâche musicale, un enregistrement de Magnéto-encéphalographie (technique qui permet de mesurer, à la surface de la tête, de très faibles champs magnétiques résultant du fonctionnement des neurones). La tâche consistait à écouter deux mélodies espacées par un silence de deux secondes. Les volontaires devaient déterminer si les mélodies étaient identiques ou différentes entre elles.
Les scientifiques ont observé que, lors de la perception et la mémorisation des notes, les personnes amusiques présentaient un traitement altéré du son dans deux régions cérébrales : le cortex auditif et le cortex frontal, essentiellement dans l’hémisphère droit. Par rapport aux personnes non-amusiques, leur activité cérébrale est retardée et diminuée dans ces aires spécifiques au moment de l’encodage des notes musicales. Ces anomalies surviennent dès 100 millisecondes après le début d’une note.
Ces résultats rejoignent une observation anatomique que les chercheurs ont confirmée grâce à des images IRM :
chez les personnes amusiques, au niveau du cortex frontal inférieur, on trouve un excès de matière grise accompagnée d’un déficit en matière blanche dont l’un des constituants essentiels est la myéline
. Celle-ci entoure et protège les axones des neurones, permettant au signal nerveux de se propager rapidement. Les chercheurs ont aussi observé des anomalies anatomiques dans le cortex auditif. Ces données renforcent l’hypothèse selon laquelle l’amusie serait due à un dysfonctionnement de la communication entre le cortex auditif et le cortex frontal.
L’amusie est ainsi liée à un traitement neuronal déficitaire dès les toutes premières étapes du traitement d’un son dans le système nerveux auditif. Ces travaux permettent ainsi d’envisager un programme de réhabilitation de ces difficultés musicales, en ciblant les étapes précoces du traitement des sons par le cerveau et de leur mémorisation.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
