|
|
|
|
 |
|
EMPIRE BYSANTIN ( 2 ) |
|
|
| |
|
| |
4. APOGÉE MACÉDONIEN ET DÉCADENCE (867-1081)
4.1. L’APOGÉE MACÉDONIEN (867-1025)
LES EMPEREURS
Avec les empereurs dits « macédoniens » (en fait d'origine arménienne), l'Empire byzantin atteint son apogée : ses adversaires sont partout refoulés et ses frontières rétablies de l'Adriatique au Caucase.
Le fondateur de la dynastie est Basile Ier (867-886), qui usurpe le pouvoir après avoir tué de ses propres mains son bienfaiteur Michel III l’Ivrogne. Il lègue le trône à ses fils Léon VI le Sage et Alexandre, mais seul le premier gouverne réellement (886-912), Alexandre ne régnant seul que quelques mois (912-913). Le fils de Léon VI, Constantin VII Porphyrogénète, règne de 913 à 959, même si de 913 à 919 le pouvoir est exercé par sa mère Zoé Carbonopsina, puis de 919 à 944 par l'amiral Romain Ier Lécapène, associé à l'Empire dès 920.
Le trône est ensuite occupé par Romain II (959-963) et les usurpateurs Nicéphore II Phokas (963-969) et Jean Ier Tzimiskès (969-976). Le pouvoir revient ensuite à l'héritier légitime, Basile II (976-1025), fils de Romain II, officiellement empereur depuis 963, le représentant le plus illustre de la lignée des Macédoniens.
L'ŒUVRE LÉGISLATIVE
Basile Ier, le premier des empereurs macédoniens, entreprend de rajeunir l'œuvre législative de son lointain et illustre prédécesseur Justinien, mais ne peut publier que deux ouvrages préparatoires, le Prokheiron, un manuel pratique de droit ne contenant que les prescriptions essentielles, et l'Epanagôgê, une introduction au vaste recueil de lois projeté.
Celui-ci sera le grand œuvre de Léon VI le Sage : les Basiliques, un recueil monumental des lois impériales groupées en 60 livres, eux-mêmes distribués en 6 tomes. Le tout est complété par 113 édits du même empereur. Sous son règne sont également rédigés le Livre du Préfet, où sont énumérés les corporations des négociants et des artisans de la capitale ainsi que les règlements auxquels elles sont soumises, et le Klétorologion de Philothée, qui nous fournit la liste hiérarchique des fonctionnaires vers 900.
LE DANGER ARABE
En 863, la grande victoire du général Pétronas contre l'émir de Mélitène, Umar, à Poson inaugure l'ère de l'offensive byzantine en Asie Mineure. En 872, le général Christophore détruit Tephrikè (aujourd'hui Divriği), la citadelle des hérétiques pauliciens (manichéens), et, l'année suivante, l'empereur pénètre dans la région de l'Euphrate, en haute Mésopotamie.
Mais ces succès n'éclipsent pas de graves revers en Occident : Malte est enlevée par les Arabes en 870 ; puis, avec les prises de Syracuse (878) et de Taormina (902), la Sicile devient une province arabe. En juillet 904, Thessalonique est pillée durant dix jours par les pirates arabes de Léon de Tripoli. L’Empire byzantin renforce sa flotte et tente de reprendre le contrôle de la mer Égée, mais l'expédition organisée en 912 contre la Crète échoue.
La mort du tsar bulgare Siméon en 927 permet à Constantinople de passer à l'offensive en Orient : les exploits de Courcouas (prise de Mélitène en 934 et d'Édesse en 944) ouvrent la voie à l'offensive décisive de Nicéphore II Phokas et de Jean Ier Tzimiskès : le premier reprend la Crète (961) et Chypre (969) ; le second franchit l'Euphrate et conquiert une partie de la Palestine (975). Basile II annexe à l'Empire une partie de l'Arménie et de la Géorgie, et, en 1045, Ani est livrée aux Byzantins.
LES DANGERS RUSSE ET BULGARE
De l’offensive au baptême des Russes
En 860, les Russes font une première apparition devant Constantinople ; leur violente attaque est repoussée. Ils reviennent en 907 et dictent leurs volontés au gouvernement byzantin, mais leur assaut de 941 se solde par un désastre. Le prince Igor campe sur les rives du Danube en 944 ; l’Empire s'en débarrasse par des présents. Le prince de Kiev, Vladimir Ier, épouse une princesse byzantine et fait baptiser son peuple en 988-989.
Le baptême de la Bulgarie
En 864-865, le souverain bulgare Boris se fait baptiser par un évêque byzantin et prend le nom de Michel. Après avoir hésité quelques années entre Rome et Constantinople, il confie finalement au clergé grec (de rite byzantin) le soin d'organiser l'Église bulgare et d'évangéliser son peuple.
L’empire de Siméon
Il n’en demeure pas moins que son fils Siméon Ier (893-927) devient bientôt l'adversaire acharné de l’Empire byzantin. Il envahit le territoire impérial en 894 et vainc les armées byzantines en 896. Constantinople doit conclure la paix et s'engager à lui payer le tribut. La guerre reprend en 913 : en août, Siméon paraît sous les murs de la capitale, réclamant la couronne des basileis. Le gouvernement capitule, mais se rétracte sitôt le tsar parti. Durant dix ans, Siméon parcourt la péninsule des Balkans, bousculant toutes les armées qu'on lui oppose. En 924, il assiège de nouveau la capitale, mais toujours sans succès. Sa mort en 927 met fin au conflit ; son fils Pierre Ier (927-969) fait aussitôt la paix.
L’empire de Samuel
La Bulgarie, tombée en 968 au pouvoir du prince russe Sviatoslav, est attaquée par Jean Ier Tzimiskès : les Russes en sont chassés en 971 et la région est incorporée à l'Empire. Mais, quinze ans plus tard, toute la péninsule balkanique se soulève contre l'autorité byzantine : le tsar Samuel y fonde un puissant empire, que Basile II mettra quelque trente ans à réduire. L'empereur mène la lutte avec une énergie farouche qui lui vaut le surnom de « Bulgaroctone », ou Tueur de Bulgares.
4.2. LA DÉCADENCE (1025-1081)
Dès la mort de Basile II en 1025 percent les signes de la désagrégation de l’Empire : l'autorité impériale s'affaiblit, le parti des grands propriétaires fonciers gagne en puissance et la conquête du pouvoir revêt l'aspect d'une lutte serrée entre la noblesse civile de la capitale et la noblesse militaire des provinces.
LES DERNIERS MACÉDONIENS (1025-1056)
Constantin VIII (1025-1028), qui était officiellement associé à son frère Basile II depuis 963, se désintéresse des affaires de l'État. Sa fille Zoé Porphyrogénète (1028-1050), déjà quinquagénaire, honore du diadème impérial ses trois époux successifs : Romain III Argyre (1028-1034), dont la politique agraire favorise les latifundistes au détriment des petits paysans ; Michel IV le Paphlagonien (1034-1041), souverain capable et brave soldat, mais dont les impairs de son ministre et frère Jean l'Orphanotrophe provoquent un vif mécontentement populaire et le soulèvement des Bulgares ; enfin, après le bref règne du neveu de Michel IV, Michel V le Calfat (1041-1042), qui tente d’évincer sa mère adoptive Zoé, Constantin IX Monomaque (1042-1055), empereur insignifiant dont le règne est marqué par le relâchement de l'administration provinciale, la consolidation des puissances féodales, l'affaiblissement de l'armée, où le mercenariat tend à supplanter le recrutement indigène, les insurrections de Georges Maniakês (1043) et de Léon Tornikios (1047), l'apparition d'ennemis nouveaux (Turcs seldjoukides en Orient, Normands, Petchenègues, Oghouz et Coumans en Occident) et enfin le schisme de 1054 avec Rome, sans effet sur le moment, mais qui servira a posteriori à justifier la rupture de 1204. Avec Théodora (1055-1056), associée au pouvoir depuis 1042, la dernière fille de Constantin VIII, s'éteint la glorieuse lignée des Macédoniens.
LA LUTTE POUR LE POUVOIR (1056-1081)
Le successeur de Théodora, son fils adoptif Michel VI Stratiotikos (1056-1057), champion du parti civil, se heurte au parti des militaires. Il est détrôné par le général Isaac Ier Comnène (1057-1059), qui tente d'établir un régime militaire solide et de remédier aux abus des gouvernements précédents. Il échoue, et le parti civil le remplace par Constantin X Doukas (1059-1067) : l'armée est négligée, les fonctionnaires sont comblés de faveurs, le territoire impérial est envahi par les Oghouz à l'ouest (1064) et les Seldjoukides à l'est.
L'empereur Romain IV Diogène (1068-1071) essaie d'enrayer le déferlement turc en Asie Mineure, mais son armée est écrasée à Mantzikert en août 1071 et lui-même est fait prisonnier. Sous Michel VII Doukas (1071-1078), fils de Constantin X, les Turcs seldjoukides envahissent l'Asie Mineure, et les Normands l'Italie byzantine.
La confusion s'étend dans les Balkans, et la crise économique ébranle l'État. Ces maux conjugués excitent les ambitions des militaires. Dans la course au pouvoir, Nicéphore III Botanéiatès (1078-1081) devance ses compétiteurs. Après avoir éliminé pour le compte de l'empereur deux prétendants au trône (Nicéphore Bryenne et Basilakès), le jeune général Alexis Comnène, neveu de l'ancien basileus Isaac Ier, usurpe le pouvoir le 1er avril 1081. La dynastie des Comnènes régnera un siècle sur l’Empire byzantin (1081-1185).
5. LE SIÈCLE DES COMNÈNES (1081-1185)
5.1. ALEXIS Ier COMNÈNE (1081-1118)
Le premier soin du nouveau souverain est de sauver l'Empire, assailli sur tous ses flancs. Palliant par une astucieuse diplomatie l'insuffisance de ses moyens militaires, il réussit non seulement à tirer Constantinople de cette situation alarmante, mais aussi à lui rendre son rang de grande puissance.
LES MENACES EXTÉRIEURES
Les Turcs seldjoukides submergent en une décennie (1071-1081) toute l'Asie Mineure et s'installent même à Nicée. Incapable de les repousser par les armes, Alexis Ier Comnène (1081-1118) signe un traité de paix avec le sultan Sulayman ibn Kutulmich en 1081, avec d'autant plus de hâte qu'il lui faut parer à l'ouest à un danger plus pressant.
Les Normands de Robert Guiscard débarquent à Durazzo la même année et occupent rapidement l'Épire, la Macédoine et la Thessalie. Manquant de troupes, le basileus enrôle des mercenaires turcs et occidentaux, confisque des trésors d'églises et sollicite l'appui de la flotte vénitienne (1082). Une lutte incessante de quatre ans lui permet, au prix fort, de bouter l'envahisseur hors du territoire impérial (1085).
Cette guerre à peine finie, les Petchenègues franchissent le Danube et ravagent durant cinq ans la partie orientale de la péninsule balkanique. En février-mars 1091, ils assiègent la capitale, mais l'armée impériale, aidée des Coumans, les écrase en avril. L’Empire byzantin en est débarrassé pour trente ans. Le répit des années suivantes est mis à profit pour abattre le turbulent émir de Smyrne, Tzakhas, réduire l'agitation des Slaves occidentaux et stopper une incursion des Coumans en 1095.
L'EMPIRE FACE À LA PREMIÈRE CROISADE
L'Empire byzantin encore convalescent voit surgir en 1096 les bandes des premiers croisés, d'abord les troupes faméliques de Pierre l'Ermite et de Gautier Sans Avoir, bientôt exterminées par les Turcs près de Nicée, puis les armées organisées des barons francs. Répudiant leur engagement de céder aux Byzantins les villes qu'ils prendraient en Asie, les chefs croisés y fondent pour leur compte de petites principautés féodales : Édesse, Antioche, Jérusalem, Tripoli. L'avantage immédiat qu'en retire Constantinople est de voir affaiblie pour un temps la pression des Turcs.
Devenu prince d’Antioche, Bohémond Ier, qui a hérité de son père Robert Guiscard l'ambition de ceindre la couronne des basileis, entreprend une croisade personnelle contre la schismatique Constantinople. Il débarque en Épire à la fin de 1107, mais Alexis ne lui laisse pas la liberté de développer son offensive et le contraint à traiter.
LA POLITIQUE INTÉRIEURE
Le sauvetage de l'Empire byzantin s'accompagne d'une rénovation de l'État. La hiérarchie nobiliaire est profondément modifiée, et l'administration, tant centrale que provinciale, réorganisée. La grave crise financière que lui ont léguée ses prédécesseurs oblige Alexis Ier Comnène à une forte dévaluation monétaire, dont le fisc saura tirer le meilleur parti. Le poids de la fiscalité, conséquence de guerres incessantes, d'une diplomatie onéreuse et du mercenariat, augmente encore avec la généralisation de la ferme de l'impôt, que des percepteurs sans vergogne utilisent pour se bâtir leur fortune. La grande propriété laïque et ecclésiastique ne cesse de croître en étendue et en puissance. Les postes les plus en vue sont en général réservés à des membres de la famille impériale. Le commerce byzantin est fortement concurrencé par les Vénitiens, qui, depuis 1082, jouissent dans l'Empire de privilèges commerciaux exorbitants : c'est à ce prix qu'ils ont fait payer leur appui maritime cette année-là et la base du puissant empire économique qu'ils commencent d'édifier en Orient.
5.2. JEAN II COMNÈNE (1118-1143)
À la mort de son père, l'héritier légitime s'empare prestement du trône, que convoitait sa sœur aînée, Anne. Jean II Comnène passe la plus grande partie de son règne dans les camps. Sa politique est rigoureusement calquée sur celle de son père : assurer la tranquillité dans les Balkans, chasser les Turcs de l'Anatolie et imposer la souveraineté byzantine aux barons de Cilicie et de Syrie.
POLITIQUE OCCIDENTALE
Il inaugure son règne en mettant fin à la prépondérance commerciale de Venise, mais il doit vite en rabattre et renouveler sous la contrainte, en 1126, le traité de 1082. La sécurité des provinces européennes, de nouveau troublée, est rétablie avec promptitude et énergie : les Petchenègues sont définitivement battus en 1122, les Serbes amenés à résipiscence et les Hongrois vaincus en 1128-1129.
POLITIQUE ORIENTALE
Libre à l'ouest, Jean II Comnène entreprend en Anatolie une série de campagnes contre les émirats d'Iconium et de Mélitène. En 1137, il prend la tête d'une puissante expédition et se dirige vers la Syrie franque. La Cilicie-Petite Arménie est matée au passage et incorporée à l'Empire, et le siège d'Antioche commence au mois d'août : la ville se reconnaît vassale de Constantinople. L'année suivante, les barons francs l'accompagnent dans une campagne contre les musulmans de la Syrie méridionale, et l'empereur fait une entrée solennelle à Antioche (1138). Mais les relations entre Grecs et Latins se détériorent très vite et, en 1142, Jean Comnène met sur pied une nouvelle expédition dont le but ultime semble avoir été la conquête de la Palestine. Mais il meurt près de Mopsueste en avril 1143, blessé au cours d'une partie de chasse par une flèche empoisonnée.
5.3. MANUEL Ier COMNÈNE (1143-1180)
Le pouvoir échoit au fils benjamin du défunt, Manuel. Contrairement à son père, souverain austère, celui-ci ne dédaigne pas les joies de l'existence ; il introduit à sa cour les mœurs occidentales, s'entoure de conseillers latins et épouse successivement deux princesses franques : Berthe de Sulzbach (belle-sœur de l'empereur germanique) en 1146, puis Marie d'Antioche en 1161.
L’EMPIRE ET LA DEUXIÈME CROISADE
Dès qu'il s'est assuré du pouvoir, Manuel Ier Comnène reprend le projet avorté de son père : réprimer les incursions du sultan d'Iconium et rétablir la souveraineté byzantine sur la principauté franque d'Antioche. Il en est momentanément détourné par la deuxième croisade (1147-1149). À l'appel enflammé de Bernard de Clairvaux, le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III se croisent et leurs armées traversent le territoire impérial en 1147. Tous deux échouent dans leur objectif : les troupes germaniques sont décimées par les Turcs en Asie Mineure, et le roi de France doit abandonner les siennes à Satalia (Antalya).
SUCCÈS ET REVERS FACE AUX NORMANDS
Le seul résultat de la croisade est de laisser aux Normands de Sicile leur liberté d'action. Le roi Roger II lance une attaque en profondeur contre l'Empire byzantin : il enlève Corfou et fait un raid audacieux jusqu'à Corinthe et Thèbes ; il ramène à Palerme les ouvriers de la soie qu'il y a fait prisonniers (1147). Pour se prémunir contre la coalition mise sur pied par Manuel Ier Comnène (dans laquelle figurent Venise et le Saint Empire romain germanique), Roger II entretient l'agitation des Serbes et des Hongrois contre l'Empire byzantin, et s'allie à la France et à la papauté. Manuel perd un appui précieux : le successeur de Conrad III, Frédéric Barberousse, s'oppose aux prétentions de Constantinople sur l'Italie, qu'il convoite pour son propre compte.
Profitant de la mort de Roger II (1154), Manuel entreprend alors la conquête de l'Italie méridionale. Les débuts sont prometteurs : en 1155, toute la région, d'Ancône à Tarente, est occupée par ses généraux. Mais la résistance s'organise ; Constantinople, abandonnée par Venise et le Saint Empire, est bientôt acculée à la défensive. Le nouveau roi de Sicile, Guillaume Ier, inflige une série de défaites aux armées byzantines et contraint Manuel à signer un traité de paix en 1158.
SUCCÈS ET REVERS EN ORIENT
Ces revers en Occident sont compensés par des succès en Asie Mineure. La Cilicie-Petite Arménie est réincorporée à l'Empire en 1158. À Mopsueste, Renaud de Châtillon, prince d'Antioche (1153-1160), vient s'humilier au pied du basileus et s'engage à honorer les dures conditions que lui dicte son suzerain. En 1159, Manuel fait son entrée solennelle à Antioche : l'objectif poursuivi sans interruption durant un demi-siècle est enfin réalisé.
Les campagnes des années suivantes sont dirigées contre le sultan d'Iconium ; ce dernier consent à traiter en 1161 et fait un séjour de trois mois à Constantinople. La paix recouvrée en Asie Mineure autorise Manuel à intervenir militairement en Hongrie et en Serbie. Cependant, le sultan rompt bientôt ses engagements. En 1176, Manuel met sur pied une puissante expédition contre Iconium, mais son armée est anéantie dans les défilés de Myrioképhalon, en Phrygie, le 17 septembre, et peu s'en faut que l'empereur lui-même ne soit fait prisonnier.
L'échec cuisant de Myrioképhalon marque un tournant de l’histoire byzantine et met un terme à une politique dont les visées ambitieuses dépassaient de loin les moyens militaires et financiers de l'Empire byzantin.
5.4. L'EFFONDREMENT DES COMNÈNES (1180-1185)
ALEXIS II COMNÈNE (1180-1183)
La glorieuse dynastie des Comnènes finit dans l'anarchie. Le jeune Alexis II Comnène n'ayant que douze ans, sa mère Marie d'Antioche assume la régence (1180-1182) ; son gouvernement maladroit mécontente toutes les couches de la société. En 1182, la haine des Byzantins contre les Occidentaux se soulage dans un grand massacre de marchands latins de la capitale. La population remet le pouvoir à Andronic Comnène, qui est associé à l’Empire.
ANDRONIC Ier COMNÈNE (1183-1185)
Cet aventurier ambitieux, qui ne manque d'ailleurs pas de qualités d'homme d'État, se débarrasse promptement de ses rivaux : l'impératrice Marie est étranglée dans son cachot et le jeune basileus dans son lit en 1183 ; le souverain sexagénaire épouse la veuve de sa victime, Agnès de France, âgée de douze ans. La politique intérieure d’Andronic Comnène marque une réaction violente contre tous les abus dont souffrait l'État. Les membres de l'aristocratie sont impitoyablement exécutés, incarcérés ou bannis ; la vénalité des charges est abolie ; les extorsions des fonctionnaires du fisc et de la justice sont sévèrement réprimées. Mais le régime qu'Andronic fait peser sur l'Empire suscite l'hostilité, et la foule qui l'avait acclamé comme le sauveur de l'Empire en 1182 le dépèce littéralement le 12 septembre 1185.
6. LES ANGES (1185-1204)
6.1. ISAAC II ANGE (1185-1195)
On donne pour successeur à Andronic Comnène un membre de la noblesse, son cousin Isaac Ange, arrière-petit-fils d’Alexis Ier Comnène, devenu brusquement célèbre pour avoir sabré le ministre de la police du tyran. Sous son règne, tous les vices qui gangrenaient l'État reprennent de plus belle, et l'affaiblissement de l'autorité centrale s'accentue. Les Normands, qui ont occupé Thessalonique et les provinces occidentales en 1185, sont refoulés. En revanche, après cent soixante-dix ans de domination byzantine, les Bulgares se révoltent et créent en 1186 un nouveau royaume indépendant, dont Constantinople est obligée de s'accommoder. En 1189-1190, les croisés germaniques de Frédéric Barberousse traversent le territoire impérial, qu'ils traitent en pays conquis. Durant les dernières années de son règne, Isaac II Ange tente vainement d'imposer son autorité aux Serbes et aux Bulgares.
6.2. ALEXIS III ANGE (1195-1203)
Isaac II Ange est détrôné par son frère aîné Alexis III Ange, dont l'impuissance précipite la décadence de l'État. Constantinople, que l'empereur germanique Henri VI avait envisagé de subjuguer, est la victime de la quatrième croisade (1202-1204), mise en branle par le pape Innocent III. Le vieux doge Enrico Dandolo met la grande entreprise au service des intérêts mercantiles de la république de Venise, désireuse de se faire payer son armement de la flotte croisée.
Le plan du Vénitien reçoit le concours inespéré du fils d'Isaac II détrôné (le futur Alexis IV Ange) : le jeune prince propose aux croisés de l'aider à renverser son oncle usurpateur et les allèche par de belles promesses. Et c'est ainsi que la flotte des croisés, initialement destinée à gagner Le Caire, s'en vient défiler sous les murailles maritimes de Constantinople le 24 juin 1203. La ville, restée inexpugnable depuis sa fondation en 330, tombe entre leurs mains le 17 juillet, Alexis III prend la fuite, tandis qu’Isaac II et son fils Alexis IV Ange (1203-1204) recouvrent le trône.
6.3. LE SAC DE CONSTANTINOPLE PAR LES CROISÉS (1204)
Ne pouvant honorer les promesses faites aux croisés, les nouveaux basileis sont renversés dès janvier 1204 et remplacés par l’éphémère Nicolas Kanabos, puis par le gendre d’Alexis III, Alexis V Murzuphle. L'avènement de ce nouvel usurpateur, qui refuse d’acquitter aux Francs les tributs promis par ses prédécesseurs, précipite la chute de Constantinople. Les croisés, las d'être lanternés, se partagent l'Empire byzantin en mars 1204 et, le 12 avril suivant, escaladent les murailles. Réfugié chez son beau-père, Alexis V est bientôt livré aux Francs, qui le mettent à mort. Ils fondent l’Empire latin de Constantinople, lequel, après quelques années de prospérité, va végéter un demi-siècle (1204-1261).
Pour en savoir plus, voir l'article les croisades.
7. DE L'EMPIRE DE NICÉE À LA FIN DE L'EMPIRE BYZANTIN (1204-1453)
7.1. L’EMPIRE DE NICÉE (1204-1261)
Au moment où les barons francs et les Vénitiens procèdent au partage du butin, des princes byzantins en fuite créent des principautés : Théodore Lascaris à Nicée (→ empire de Nicée), Michel Ange en Épire, Alexis et David Comnène à Trébizonde (→ empire de Trébizonde). C’est la première de ces principautés qui restaurera l'Empire byzantin.
THÉODORE Ier LASCARIS (1204-1222)
Théodore s'emploie d'abord à assurer la survie de son petit État nicéen, dont la création gêne autant les seigneurs byzantins du voisinage que les Latins, qui entendent entrer en possession de leurs fiefs d'Asie Mineure. Cependant, du fait des interventions répétées du tsar bulgare Jean II Kalojan dans les Balkans, Théodore Lascaris parvient à asseoir progressivement son autorité et organise sa principauté sur le modèle de l'ancienne Constantinople, dont il se prétend l'unique empereur légitime (1208). Sa victoire inattendue sur le sultan d'Iconium en 1211 avive ses ambitions. En 1214, il annexe une large bande de territoire le long de la mer Noire au détriment des Comnènes de Trébizonde. La même année, les Latins reconnaissent tacitement l'existence de son royaume, et, en 1219, il signe un accord commercial avec Venise.
JEAN III DOUKAS VATATZÈS (1222-1254)
Gendre de Théodore Ier Lascaris, le deuxième empereur de Nicée, Jean III Doukas Vatatzès, consolide la position de la principauté et prend pied en Thrace, où il occupe Andrinople. Il en est refoulé par son rival Théodore Ange et le tsar bulgare, qui, chacun pour son compte, poursuivent le même objectif : supplanter les Latins à Constantinople. Mais les événements favorisent l'empereur de Nicée : l'armée de Théodore Ange est écrasée à Klokotnica en Thrace, en 1230, par les Bulgares de Jean III Asen II ; ce dernier meurt en 1241, et son royaume est peu après contrôlé par les Mongols de la Horde d'Or. Jean III Doukas Vatatzès n'a désormais plus de compétiteur à sa mesure : il étend son autorité de la Thrace à la Macédoine. En 1242, Thessalonique reconnaît sa souveraineté, et il occupe la ville en 1246. À sa mort, l'empire de Nicée a plus que doublé, et toutes les conditions sont réunies pour le rétablissement de l'Empire byzantin.
DES LASCARIS AUX PALÉOLOGUES (1254-1261)
Son fils Théodore II Doukas Lascaris (1254-1258), souverain très cultivé et homme d'action, conserve dans son intégrité l'héritage paternel et pratique à l'intérieur une politique anti-aristocratique. À sa mort, la noblesse relève la tête : un de ses représentants les plus en vue, Michel Paléologue, est nommé régent, et ses pairs en font un associé du jeune Jean IV Doukas Lascaris (1258-1261), fils de Théodore II. L'Empire, menacé par une coalition de la Sicile, de l'Épire et de l'Achaïe, est sauvé à la bataille de Pelagonia (1259). Contre Venise, il signe un accord avec Gênes (mars 1261), qui promet son appui militaire en échange de privilèges commerciaux. Constantinople, vide de défenseurs, est enlevée pratiquement sans coup férir par le général Alexis Strategopoulos (25 juillet 1261).
Empereur associé au trône, Michel VIII Paléologue (1261-1282) fait son entrée solennelle dans la capitale restaurée, Constantinople, le 15 août 1261. Il reçoit la couronne impériale en la basilique Sainte-Sophie. Quelques mois plus tard, il fait aveugler l'héritier légitime, Jean IV Lascaris. La nouvelle dynastie des Paléologues va diriger l'Empire jusqu'à sa chute.
Pour en savoir plus, voir l'article empire de Nicée.
7.2. L'EMPIRE DES PALÉOLOGUES (1261-1453)
MICHEL VIII PALÉOLOGUE (1261-1282)
Une situation alarmante
L'Empire restauré n'est de fait qu'un pâle reflet de l'Empire d'antan : les villes maritimes italiennes contrôlent les eaux byzantines ; les Serbes et les Bulgares ont grignoté la péninsule des Balkans ; des princes grecs et latins se sont partagé la Grèce. En Occident, les puissances qui ont soutenu l'Empire latin n'aspirent plus qu'à la destruction du nouvel Empire grec. Le danger le plus menaçant vient du roi de Sicile, Charles Ier d'Anjou (frère du roi de France Louis IX), qui a pris la tête d'une vaste coalition regroupant l'Achaïe, l'Épire, la Thessalie, la Serbie et la Bulgarie.
L’échec de l’union des Églises
Pour prendre à revers les puissances balkaniques, Michel VIII Paléologue noue des alliances matrimoniales avec la Hongrie et les Tatars de la Horde d'Or. Contre Charles d'Anjou, il se tourne vers Rome et propose à la papauté d'entamer de nouvelles négociations sur l'union des Églises latine et grecque – afin de s’assurer du soutien des papes contre toute attaque occidentale de l'Empire byzantin. Sommé par le pape Grégoire X de passer aux actes, Michel VIII Paléologue se résout à signer l'union au concile de Lyon (juillet 1274).
Fort de ce soutien, l'Empire byzantin lance aussitôt une grande offensive contre les principautés grecques et franques de Grèce, et reprend l'avantage dans la mer Égée. Mais le peuple et le clergé byzantins ne souscrivent pas à la politique unioniste du souverain à laquelle ils opposent une résistance acharnée : l'empereur, qui voit dans l'union des Églises une nécessité politique vitale pour l'Empire, écarte sans pitié tous les récalcitrants.
La fin de la menace occidentale
La paix avec les puissances occidentales est remise en question avec l'avènement du pape Martin IV (en 1281), qui appuie ouvertement les plans de conquête du roi de Sicile. La menaçante coalition occidentale est réactivée. Cependant, Michel VIII Paléologue exploite le mécontentement de la population sicilienne et s'abouche avec le roi Pierre III d'Aragon, qui convoite la Sicile : la révolte à Palerme, le 30 mars 1282, et la domination angevine en Sicile sont étouffées dans le sang des Vêpres siciliennes. Quand Michel VIII Paléologue meurt, en décembre de la même année, la menace occidentale a disparu.
LES SUCCESSEURS DE MICHEL PALÉOLOGUE
D’Andronic II à Andronic III (1282-1341)
Andronic II Paléologue (1282-1328), souverain cultivé et capable, qui s’associe son fils Michel IX (1295-1320), militaire sans talent, est dépassé par les événements : le trône lui est enlevé par son petit-fils Andronic III, qui s'empare de la capitale en 1328 et règne jusqu'en 1341. Lui succède son fils, Jean V Paléologue, un enfant de neuf ans, dont le règne sera le plus long (1341-1391), mais aussi le plus tragique de toute l'histoire byzantine.
Le règne désastreux de Jean V Paléologue (1341-1391)
Au terme d'une longue guerre civile (1341-1347), le général Jean Cantacuzène, qui s’est proclamé empereur sous le nom de Jean VI en 1341, évince l'impératrice régente Anne de Savoie et règne à Constantinople de 1347 à 1354, d’abord associé à Jean V jusqu’en 1351, puis, après la reprise de la guerre civile par ce dernier, à son propre fils Matthieu (1354). Celui-ci continue jusqu’en 1357 la lutte contre Jean V Paléologue après l’abdication de son père Jean VI Cantacuzène (1355).
Contre les Turcs, Jean V Paléologue sollicite le secours de la papauté et des royaumes d'Occident : il fait le voyage de Hongrie en 1366 et de Rome en 1369, où il en vient à adopter le catholicisme ; à Venise, il est même retenu comme débiteur insolvable (1370-1371). Encore évincé à deux reprises, par son fils aîné Andronic IV (1376-1379), puis par son petit-fils Jean VII (1390-1391), il termine sa vie jalonnée d'épreuves en 1391.
De Manuel II à Constantin XI (1391-1453)
Son second fils, Manuel II Paléologue, lui succède (1391-1425). Constantinople est assiégée par le sultan ottoman Bayezid Ier de 1394 à 1402. Après avoir délégué le pouvoir à son neveu Jean VII, l'empereur se rend à Venise, Paris et Londres (1399-1402) pour quérir du secours, mais n'obtient que de vagues promesses. Son fils Jean VIII Paléologue (1425-1448), pressé par les Turcs ottomans, entreprend de nouvelles négociations en vue de l'union des Églises, condition préalable d'un secours occidental. Scellée au concile de Florence en 1439, celle-ci elle est rejetée par le peuple byzantin. Constantin XI Paléologue succède à son frère Jean VIII comme empereur en 1449 : il succombe les armes à la main au moment de la prise de Constantinople par les Ottomans de Mehmed II, en 1453.
7.3. LES CAUSES DE LA DÉCADENCE
LES PROBLÈMES MINEURS
L'affaiblissement spectaculaire de l'Empire byzantin aux xive et xve siècles ne s'explique pas uniquement par les conflits armés à l'intérieur et à l'extérieur ; des vices graves minent également le corps de l'État. La grande propriété civile et ecclésiastique ne cesse de croître et se soustrait de plus en plus à l'autorité centrale. Le fossé entre nantis et petit peuple, source d'importants déséquilibres sociaux, n'en finit pas de se creuser. L'armée est composée presque exclusivement de mercenaires étrangers et les effectifs sont extrêmement réduits. Constantinople renonce à l'entretien (trop onéreux) d'une puissante flotte de guerre et se repose sur la puissance maritime de ses alliés génois. La monnaie byzantine subit plusieurs dévaluations qui entraînent des hausses de prix et la chute de son crédit international traditionnel. Le budget de l'État a fondu et une partie des finances publiques sert à acheter des concours ou une paix qu'on ne peut assurer par les armes.
LES GUERRES CIVILES
Au lieu de faire front face à leurs adversaires communs, les Paléologues sont minés par les conflits familiaux qui dégénèrent en guerres civiles.
Andronic II contre Andronic III (1319-1328)
En 1319 éclate un conflit entre l’empereur Andronic II et son petit-fils (futur Andronic III) : des sbires à la solde du jeune prince tuent par méprise son frère Manuel, et ce meurtre provoque la mort de chagrin de leur père l’empereur associé Michel IX (1320) et la colère du vieil empereur Andronic II, qui prive son petit-fils de ses droits au trône. En 1321, ce dernier rejoint ses nombreux partisans, à la tête desquels se trouve Jean Cantacuzène, rassemblés à Andrinople, et marche sur la capitale. L'empereur capitule et se résigne à un partage du territoire impérial. Une guerre ouverte éclate, et chacun des partis fait appel aux étrangers, Serbes et Bulgares. Andronic III enlève Constantinople et détrône son grand-père en 1328.
Jean V contre Jean VI (1341-1354)
La mort d'Andronic III en 1341 déclenche une seconde guerre civile, plus désastreuse que la précédente. L'épouse de l'empereur, Anne de Savoie, doit exercer la régence au nom de Jean V Paléologue, un enfant de neuf ans, mais Jean Cantacuzène, l'ami intime du défunt, agit d'autorité en tuteur du jeune basileus. Deux partis se créent et se livrent une lutte féroce durant six ans, dont profitent surtout Serbes, Bulgares et Turcs. Jean Cantacuzène se fait proclamer empereur en Thrace en 1341. Une grave crise sociale (massacre des aristocrates en Thrace et à Thessalonique) et une querelle religieuse passionnée (l'hésychasme, tendance mystique très présente au mont Athos fondée sur la contemplation et l’invocation répétée du nom de Jésus) approfondissent davantage le fossé entre les clans ennemis.
Contre le pouvoir central, Jean Cantacuzène sollicite le concours du prince serbe Étienne IX Uroš IV Dušan, mais leur alliance est éphémère ; l'usurpateur fait alors appel à l'émir Umur Bey, puis au chef turc ottoman Orhan Gazi, auquel il accorde la main de sa fille Théodora (1345). Appuyé par des contingents turcs, il prend rapidement l'avantage et s'empare de Constantinople en 1347. La guerre civile se rallume dès 1351 entre les deux empereurs Jean V Paléologue et Jean VI Cantacuzène, le premier aidé par les Serbes, le second par les Turcs. En 1354, Jean V entre à Constantinople et Jean Cantacuzène est contraint d'abdiquer en faveur de son fils Mathieu, qui résiste jusqu’en 1357.
Jean V contre Andronic IV et Jean VII (1373-1391)
Retenu à Venise en 1370-1371, Jean V Paléologue n'est pas soutenu par son fils (futur Andronic IV), qui exerce la régence à Constantinople ; ce dernier se rebelle contre son père en 1373, et le détrône à l'instigation des Génois en 1376. Jean V Paléologue récupère le pouvoir en 1379 avec l'agrément du Turc ottoman Orhan Gazi. Andronic IV se révolte encore en 1385 ; il est imité par son fils Jean VII, qui s'empare du trône impérial en 1390, poussé par l’Ottoman Bayezid Ier (dont l’État est devenu un sultanat). Il en est dépouillé par son oncle Manuel II Paléologue, dont le règne (1391-1425) clôt l'ère des guerres civiles.
7.4. LE PÉRIL SERBE
Dans le même temps, les États grecs séparatistes d'Épire et de Thessalie s'épuisant dans des luttes continuelles, la seule rivale sérieuse de Constantinople dans les Balkans est la Serbie. Le kral (prince) Étienne VI Uroš II Milutin s'empare en 1282 de Skopje et lance des attaques répétées en direction de la Macédoine ; marié en 1299 à une petite-fille d'Andronic II, il reçoit en dot toute la région située au nord d'Ohrid. En 1330, les Serbes écrasent les Bulgares alliés de Constantinople à Kjustendil.
Le kral (roi) Étienne IX Uroš IV Dušan (1331-1355) profite de la décomposition de l'État byzantin pour arrondir ses domaines ; il enlève les principales places fortes de la Macédoine et s'avance jusqu'à Thessalonique (1334). La guerre civile (1341-1347) qui désole l'Empire byzantin favorise ses desseins expansionnistes. Les provinces d'Épire et de Thessalie récupérées par Jean Cantacuzène tombent en son pouvoir, et le royaume d’Étienne IX finit par s'étendre du Danube au golfe de Corinthe et de la mer Adriatique à la Struma et à la mer Égée. En 1346, il se fait couronner à Skopje et prend le titre d'empereur des Serbes et des Grecs.
Mais après sa mort en 1355, son empire s'émiette en principautés indépendantes. Le prince Lazare Hrebeljanović tente encore avec le souverain de Bosnie d'enrayer la progression des Turcs ottomans, mais leurs armées sont écrasées à la bataille de Kosovo (15 juin 1389).
7.5. LE PÉRIL OTTOMAN
L'invasion mongole qui déferle sur l'Asie Mineure orientale au milieu du xiiie siècle refoule en direction de l'ouest plusieurs tribus turques. L'une d'elles s'installe dans la province de Bithynie : son chef Osman Gazi (mort avant 1324) sera le fondateur de la dynastie ottomane.
BYZANCE ENTRE OTTOMANS ET CATALANS
Pour contenir les nouveaux envahisseurs, Constantinople enrôle des contingents alains (caucasiens iranophones) et catalans. La Grande Compagnie catalane conduite par Roger de Flor fait merveille contre les Turcs ottomans (1304), mais elle ne tarde pas à se retourner contre ses employeurs. De Gallipoli où ils se sont retranchés, les Catalans ravagent la Thrace. En 1307, ils se transportent en Macédoine, puis en Grèce, semant partout la dévastation. Ils s'emparent d'Athènes et fondent en Attique un duché catalan qui durera plus d'un demi-siècle.
LES PROGRÈS DE LA PUISSANCE TURQUE JUSQU’EN 1402
Les Catalans partis, l'armée impériale est impuissante à contenir les Turcs : Brousse (Bursa)tombe en 1326 et devient la capitale des Ottomans, Nicée est perdue en 1331 et Nicomédie en 1337. L'État ottoman en pleine expansion intervient dans la guerre civile byzantine, tour à tour appelé par l'un ou l'autre parti. En 1352, les Turcs ottomans prennent pied en Europe ; ils s'emparent de Gallipoli en 1354, d'où ils s'élancent à la conquête de la Thrace. Ils enlèvent Andrinople (1361 ou 1362), qui leur sert de point d'appui pour la conquête méthodique des Balkans ; Philippopolis (→ Plovdiv) est conquise en 1363-1364. Les Serbes sont écrasés à Černomen en 1371 et la Macédoine passe sous suzeraineté du sultan ottoman. Les principales villes de la péninsule balkanique succombent : Sérres (Sérrai), Sofia, Niš, Thessalonique en 1387, Tărnovo en 1393. Les Serbes sont vaincus à Kosovo en juin 1389 (→ bataille de Kosovo). Constantinople, assiégée de 1394 à 1402 par le sultan Bayezid Ier (qui défait en 1396 à Nicopolis l’armée de secours des croisés d’Occident et du roi de Hongrie), est délivrée grâce à la campagne des Mongols de Tamerlan (→ Timur Lang) en Anatolie.
UN RÉPIT SANS LENDEMAIN (1402-1453)
Ce désastre vaut à Constantinople deux décennies de répit. Mais la capitale est de nouveau investie par le sultan Murad II en 1422 ; Thessalonique, restituée aux Byzantins en 1403 et cédée aux Vénitiens en 1423, succombe définitivement en 1430. La croisade occidentale organisée en 1444 pour secourir l’Empire byzantin subit le même sort que celle de 1396 : elle est anéantie à Varna (→ bataille de Varna).
LA CHUTE DE CONSTANTINOPLE (1453)
Le siège de Constantinople par les Turcs, 1453
L'avènement du sultan Mehmed II (en 1451) précipite la chute de l’Empire byzantin. Une puissante armée ottomane bivouaque sous les murs de Constantinople au début d'avril 1453 ; l'artillerie turque a raison de la solidité des remparts byzantins, et, le 29 mai, les janissaires escaladent les remparts. Le centre de l'État byzantin va devenir celui de l'Empire ottoman. Avec la conquête du despotat grec de Morée en 1460 et de l'empire grec de Trébizonde en 1461, il ne reste plus rien de l'Empire chrétien d’Orient.
|
| |
|
| |
|
 |
|
MARCO POLO |
|
|
| |
|
| |

Marco Polo
Cet article fait partie du dossier consacré aux grandes découvertes et du dossier consacré aux grands explorateurs.
Voyageur vénitien (Venise 1254-Venise 1324).
Accompagnant son père et son oncle, négociants à Venise, Marco Polo prit dès 1271 la route de Pékin à travers l'Asie centrale et arriva en 1275 à Shangdu, résidence de l'empereur Kubilay Khan. Celui-ci lui ayant confié diverses missions, il parcourut le pays pendant seize ans. Rentré à Venise (1295), il fit le récit de son voyage dans le Livre des merveilles du monde (dit encore Il Milione, ou le Devisement du monde), extraordinaire description de la Chine mongole.
1. L'ÉPOPÉE EN FAMILLE
D'origine dalmate, les Polo s'établissent à Venise au début du xie siècle et y deviennent de prospères négociants. Le père de Marco, Niccolo, et son oncle, Matteo, inaugurent avec éclat la vocation exploratrice de la famille, puisqu'ils transforment une tournée commerciale en un immense voyage qui les conduit à Boukhara, puis jusqu'à Khanbalik (Pékin), où le Grand Khan, curieux de voir des « Latins », les a conviés. Partis en 1255, ils ne sont de retour qu'en 1269, avec un message de Kubilay Khan, petit-fils de Gengis Khan, pour le pape : le chef des chrétiens est amicalement invité à envoyer d'autres visiteurs en Chine.
Dès 1271, les deux frères repartent avec Marco (né le 15 septembre 1254). Le récit de Marco Polo commence à Ayas (Lajazzo en italien), en Cilicie, sur la Méditerranée orientale. Par l'Arménie, les voyageurs gagnent les régions de l'actuelle Géorgie, puis le golfe Persique. Se dirigeant vers le nord, ils traversent la Perse et, reprenant le vieil itinéraire de la route de la soie, s'enfoncent dans les montagnes d'Asie centrale. La traversée du Pamir les conduit à Kachgar, puis à Yarkand et à Khotan. Après les déserts entourant le Lob Nor, ils atteignent la première cité véritablement chinoise (Ganzhou) : c'est le premier contact de Marco Polo avec la civilisation d'Extrême-Orient et avec une religion presque inconnue, le bouddhisme. Les Polo s'arrêtent une année entière à Ganzhou, où les affaires sont très profitables.
Le voyage reprend en 1275, lorsque le Grand Khan envoie une escorte pour convoyer les visiteurs jusqu'à sa résidence d'été, à Shangdu (aujourd'hui Kaiping), au nord-est de la capitale Khanbalik. Le souverain, qui apprécie l'intelligence de Marco, le prend sous sa protection. Il lui confie diverses missions – notamment en qualité d'administrateur des gabelles –, qui lui font parcourir tout le pays. Le Vénitien reste ainsi seize ans au service du Grand Khan.
Mais le désir de revenir à Venise se fait finalement sentir. Kubilay finit par accepter de se séparer des trois Latins. Il leur confie une dernière mission en 1292 : convoyer une princesse destinée à épouser un khan de Perse. Par le détroit de Malacca, les Vénitiens atteignent Ceylan, puis la côte occidentale du Deccan. Ayant accompli leur mission à Ormuz, en Perse, ils gagnent ensuite Trébizonde et la mer Noire par la terre, enfin Constantinople et Venise (1295).
2. LA RÉVÉLATION DE LA CHINE MONGOLE
En 1296, Marco Polo est fait prisonnier au cours d'une bataille navale opposant Gênes à Venise. Transporté à Gênes, il y est incarcéré. C'est là qu'en 1298 il dicte ses souvenirs à son compagnon d'infortune, le trouvère Rusticien de Pise. À sa parution, le Livre des merveilles du monde est beaucoup plus qu'un simple récit de voyage. C'est un tableau géographique, ethnique et économique de la Chine à l'apogée de la dynastie mongole, un répertoire de ses croyances, de ses rites et de ses institutions, une anthologie des fables concernant son passé légendaire, une chronique enfin de seize ans de son activité politique. Ce qui frappe le plus le Vénitien, outre les magnificences de la capitale Khanbalik, c'est à la fois l'organisation administrative de l'immense pays, l'incomparable système des postes, les réalisations de travaux publics (routes, ponts et canaux), celles de l'artisanat – en particulier le travail de la soie –, l'utilisation, enfin, du papier-monnaie.
Le Livre des merveilles du monde jouera un rôle considérable dans le développement des mythes relatifs aux richesses de la Chine et des contrées voisines. Il marquera profondément l'imaginaire européen. Toutes les grandes découvertes des Temps modernes sont en effet nées de ce livre : les expéditions de Vasco de Gama et de Christophe Colomb ne seront entreprises que pour partir à la conquête des fabuleux trésors qu'il révèle, en contournant l'obstacle musulman qui s'oppose alors à la pénétration occidentale en Chine.
Libéré en 1299, Marco Polo passe le reste de sa vie dans sa cité natale, où il reprend pleinement sa place dans le monde des marchands vénitiens. Il décède le 8 janvier 1324, à près de 70 ans.
3. UN BEST-SELLER MÉDIÉVAL
Rédigé par Rusticien de Pise dans un français mêlé de vénitien, le manuscrit original du Livre des merveilles du monde est perdu, mais le succès du récit a été tel qu'il fut aussitôt transcrit dans la plupart des langues romanes et en latin. On en connaît 143 manuscrits, les plus remarquables étant le manuscrit franco-italien de la Bibliothèque nationale de France (début du xive siècle), la version latine de Fra Pipino (Florence, 1320), le Livre des merveilles du monde du duc Jean de Berry (BNF, 1400) et la version italienne dite « de Ramusio » (Navigationi e viaggi, 1559).
La découverte à Milan d'un manuscrit de 1795 – copie d'un exemplaire latin de 1470 retrouvé ensuite à Tolède – a donné lieu à trois remarquables éditions, établies en italien par Luigi Fascolo Benedetto (Florence, 1928, et Turin, 1962), en anglais par Arthur Christopher Moule et Paul Pelliot (Londres, 1938) et en français par Louis Hambis (Paris, 1955).
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
CHINE |
|
|
| |
|
| |

Chine
en chinois Zhongguo
Nom officiel : République populaire de Chine
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Asie.
Plus grand pays d’Asie orientale, la Chine est, par ses dimensions territoriales et démographiques, un véritable État-continent. Sur plus de 22 000 kilomètres ses frontières la séparent de 14 autres États : Corée du Nord, Russie, Mongolie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Laos et Vietnam. Ses longues côtes sont riveraines de trois espaces maritimes, la mer Jaune et les mers de Chine orientale et méridionale, au delà desquelles se situent, du nord au sud, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, Brunei, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour.
Son territoire se compose de 22 provinces (23 avec Taïwan), 5 régions autonomes, 4 municipalités de rang provincial et 2 régions d'administration spéciale (Hongkong et Macao).
LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA CHINE
* Superficie : 9 600 000 km2
* Nombre d'habitants : 1 370 137 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Chinois
* Capitale : Pékin
* Langue : chinois
* Monnaie : yuan
* Chef de l'État : Xi Jinping
* Chef du gouvernement : Li Keqiang
* Nature de l'État : république, régime socialiste
* Constitution :
* Adoption : 4 décembre 1982
* Révisions : 1988,1993,1999, 2004, 2018
Pour en savoir plus : institutions de la Chine
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CHINE
La Chine regroupe plus du cinquième de la population mondiale (plus de 20 fois celle de la France). La politique antinataliste a réduit la croissance démographique (0,7 % par an).
L'Ouest, juxtaposant chaînes montagneuses et hauts plateaux (Tibet ou Mongolie) au climat rude et cuvettes arides (Xinjiang), est souvent vide, peuplé surtout par des minorités ethniques (Tibétains, Mongols, etc.) qui ne constituent toutefois guère plus de 5 % de la population totale. Celle-ci est essentiellement formée des Han, les Chinois proprement dits, concentrés dans la Chine orientale. Ici, sous un climat de plus en plus clément vers le S., dans un paysage de collines, de plaines et de vallées (dont celles du Huang He et du Yangzi Jiang), sur 15 % seulement du territoire, s'entassent 90 % de la population. Plus de 60 % des Chinois sont encore des ruraux, mais l'urbanisation a beaucoup progressé depuis 1949. Aujourd'hui, une centaine de villes dépassent le million d'habitants. Shanghai, Pékin, Hongkong, Tianjin et Wuhan comptent parmi les grandes métropoles mondiales.
L'agriculture a été développée, d'abord dans un cadre collectivisé (communes populaires), dorénavant souvent familial. L'autosuffisance alimentaire est aujourd'hui atteinte. La Chine est le premier producteur mondial de blé et surtout de riz. Elle se situe encore aux premiers rangs mondiaux pour le coton, le tabac, le maïs, les oléagineux, le thé, le sucre, l'élevage (porcins et volailles notamment) et la pêche. L'industrie a connu une progression spectaculaire pour les branches lourdes (extraction de charbon surtout et d'hydrocarbures, sidérurgie), plus récente dans des domaines plus élaborés (chimie, métallurgie de transformation, informatique, électronique, automobile, aéronautique) s'ajoutant au traditionnel textile.
La progression des échanges internationaux, l'appel aux capitaux et à la technologie de l'étranger, le desserrement de l'emprise de l'État ont été à la fois cause et effet d'une croissance exponentielle de la production, qui fait aujourd'hui du pays le premier exportateur et la deuxième puissance économique du monde, ainsi qu'un acteur financier de premier ordre. Mais cet essor a pour rançon le creusement des inégalités sociales et régionales, un risque de surchauffe, une dégradation sensible de l’environnement (ainsi que des défaillances en matière de sécurité industrielle et alimentaire) et une forte dépendance par rapport à la conjoncture économique internationale. La Chine enregistre en 2011-2012 un ralentissement de sa croissance.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LE SIECLE DES LUMIÈRES |
|
|
| |
|
| |
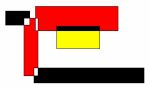
siècle des Lumières ou les Lumières
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Mouvement philosophique qui domina le monde des idées en Europe au xviiie s.
Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du xviiie siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. L'Encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, est le meilleur symbole de cette volonté de rassembler toutes les connaissances disponibles et de les répandre auprès du public – d’un public éclairé.
Ce mouvement, qui connut une intensité plus marquée en France, en Angleterre (sous le nom d'Enlightenment) et en Allemagne (Aufklärung), est né dans un contexte technique, économique et social particulier : ascension de la bourgeoisie, progrès des techniques, progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, progrès des sciences souvent appliquées au travail des hommes.
Confiants en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison, les philosophes des Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent d'un optimisme envers l'histoire, fondé sur la croyance dans le progrès de l'humanité. L'affirmation de ces valeurs les conduit à combattre l'intolérance religieuse et l’absolutisme politique.
Certains philosophes interviennent dans des affaires judiciaires (Voltaire défend entre autres Calas, un protestant injustement accusé d'avoir tué son fils) et militent pour l'abolition des peines infamantes, de la torture et de l’esclavage. Diffusées dans les salons, les cafés et les loges maçonniques, les idées des Lumières sont consacrées par les œuvres des philosophes, des écrivains et des savants. Les principaux représentants des Lumières sont, en Grande-Bretagne, J. Locke, D. Hume, I. Newton ; en Allemagne, C. Wolff, Lessing, Herder ; en France, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, tous les Encyclopédistes, Condillac et Buffon.
1. UN MOUVEMENT EUROPÉEN
On attribue généralement un rôle prééminent à la France dans l'essor de la civilisation européenne du xviiie s. Cependant l'Angleterre est la première instigatrice des grands mouvements idéologiques et des mutations économiques qui caractérisent ce siècle.
L'Angleterre offre l'image d'un pays libre : deux révolutions (1642-1649, avec Cromwell, et 1688-1689, avec la Déclaration des droits ou Bill of Rights) y ont détruit le régime de l'absolutisme et de l'intolérance. De telles idées se répandent en Europe grâce aux philosophes français, fascinés par cette application du libéralisme. Par ailleurs, les Anglais sont également à l'origine de diverses transformations technologiques et scientifiques qui débouchent sur ce que l'on appelle aussi des « révolutions » – dans l’agriculture et l’industrie – et bouleversent les données économiques.
1.1. UN CONTINENT EN MUTATION
UNE RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE
La France du xviiie s. ne peut s'enorgueillir d'avoir donné à la physique ou aux mathématiques des génies tels que Newton, Euler ou Gauss, mais l'apport français aux progrès des sciences est néanmoins indéniable. Tous les domaines sont représentés par de grands savants novateurs : en chimie, Lavoisier ; en mathématiques, Lagrange, Monge et Legendre ; ou encore en botanique, la famille Jussieu.
Dès lors, l'esprit humain se délivre des contraintes théologiques et formelles pour s'intéresser à la nature, dans une nouvelle démarche de recherche des connaissances, caractéristique de l'esprit même des Lumières.
DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Cette nouvelle conception du monde inclut une réflexion sur le gouvernement des sociétés humaines, qui sont elles-mêmes en mutation. Un essor démographique accompagne les progrès de cette époque. Une baisse générale de la mortalité, due au recul des trois principaux fléaux que sont la famine, la guerre et la peste, explique ce phénomène. La durée de vie s'allonge en moyenne de dix ans dans la seconde moitié du xviiie s. Ce type de changement structurel, associé aux mutations économiques, ébranle les équilibres sociaux.
L'ESSOR DE LA BOURGEOISIE
Vers 1740, partout en Europe, existe une société d'ordres fondée sur les privilèges. Alors qu'en Angleterre aucun obstacle juridique n'empêche la mobilité sociale, la France donne l'exemple opposé : des groupes sociaux entiers, tels que les paysans, restent ignorés de la nation. Par contre, au sein du tiers état, la bourgeoisie constitue une classe en pleine ascension dès lors qu'elle profite des développements industriels et commerciaux de cette période. L'essor urbain – généré par le surcroît de population – offre un cadre à ces nouveaux possédants qui cherchent à faire reconnaître leurs avantages en allégeant les entraves politiques et en évoluant vers une nouvelle société : on constate ainsi que beaucoup de philosophes et d'écrivains du xviiie s. (Voltaire, Beaumarchais…) sont issus de familles bourgeoises aisées.
1.2. LE FRANÇAIS, LANGUE DES LUMIÈRES
Les Lumières ne connaissent pas de frontières. Le mouvement touche toutes les élites cultivées d'Europe, et sa langue est le français, qui remplace le latin comme langue internationale de communication.
À la cour de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, les Français sont à l'honneur ; et leurs livres, à la mode. Cette prépondérance tient au poids particulier de la France en Europe depuis Louis XIV, mais aussi au modèle de modernisme qu'elle incarne, à travers ses écrivains et ses savants, aux yeux des étrangers. Et, de fait, c'est en France que le mouvement des Lumières conquiert la plus large audience intellectuelle dans l'opinion.
Dans les autres États d'Europe continentale, il n'a entraîné qu'une partie des élites. Le cas de l'Angleterre est singulier : elle a précédé et influencé les Lumières françaises naissantes, mais ses élites n'ont pas prétendu se substituer au gouvernement ou à l'Église ; sa classe dirigeante est restée imprégnée de puritanisme et s'est plus préoccupée de commerce que de philosophie : elle s'est satisfaite des acquis de sa révolution de 1689.
2. QUE SONT LES LUMIÈRES ?
La pensée du siècle des Lumières se développe autour de deux thèmes majeurs : le retour à la nature, la recherche du bonheur. Les philosophes dénoncent dans les religions et les pouvoirs tyranniques des forces obscurantistes responsables de l'apparition du mal, dans un monde où l'homme aurait dû être heureux. Ils réhabilitent donc la nature humaine, qui n'est plus entachée par un péché originel ou une tare ontologique ; ils substituent à la recherche chrétienne du salut dans l'au-delà la quête ici-bas du bonheur individuel. À la condamnation des passions succède leur apologie : l'homme doit les satisfaire, à condition qu'elles ne s'opposent pas au bonheur d'autrui.
2.1. DES PHILOSOPHES MILITANTS
Cette nouvelle vision de l'homme et du monde, les philosophes la défendent en écrivains militants. Leur combat s'incarne dans la pratique de formes brèves, faciles à lire et susceptibles d'une vaste diffusion : lettres, contes, pamphlets.
Création littéraire et réflexion philosophique se nourrissent mutuellement. À cet égard, l'année 1748 marque un tournant, avec la parution et le grand succès de l'Esprit des lois, dans lequel Montesquieu analyse tous les régimes politiques et établit les rapports nécessaires qui unissent les lois d'un pays à ses mœurs, à son climat et à son économie. Par là apparaît bien le caractère relatif du régime monarchique. L'année suivante, Diderot publie sa Lettre sur les aveugles, et Buffon le premier volume de son Histoire naturelle. En 1751 paraît le Siècle de Louis XIV de Voltaire.
DIFFUSER LA « RÉVOLUTION DANS LES ESPRITS »
Cette même année 1751, les idées des Lumières se mêlent et s'affinent dans un creuset : l'Encyclopédie de Diderot, dont paraît le premier volume. Il s'agit d'une œuvre qui met à la portée de l'homme nouveau – le bourgeois, l'intellectuel – une synthèse des connaissances conçue comme un instrument pour transformer le monde et conquérir le présent.
Entre 1750 et 1775, les idées essentielles des Lumières se cristallisent et se répandent. « Il s'est fait une révolution dans les esprits […]. La lumière s'étend certainement de tous côtés », écrit Voltaire en 1765. Si après 1775 les grands écrivains disparaissent (Voltaire et Rousseau en 1778, Diderot en 1784), c'est le moment de la diffusion maximale, tant géographique que sociale, des Lumières ; l'opinion se politise, prend au mot leurs idées : la philosophie est sur la place publique. L'œuvre de l'abbé Raynal (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, 1770), qui condamne le despotisme, le fanatisme et le système colonial, connaît un grand succès. Homme politique important autant que mathématicien, Condorcet publie des brochures contre l'esclavage et pour les droits des femmes, et prépare sa synthèse de l'histoire de l'humanité (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.
POUR UN DESPOTISME ÉCLAIRÉ…
En matière politique, les Lumières mettent en cause l'absolutisme et érigent le despotisme éclairé en modèle de gouvernement. Il s'agit de subordonner les intérêts privilégiés et les coutumes au système rationnel d'un État censé représenter le bien public, de favoriser le progrès économique et la diffusion de l'enseignement, de combattre tous les préjugés pour faire triompher la raison. Ce despotisme éclairé inspira Frédéric II en Prusse, Catherine II en Russie, Joseph II en Autriche. Mais les philosophes qui croyaient jouer un rôle positif en conseillant les princes, comme Voltaire auprès de Frédéric II et Diderot auprès de Catherine II, perdirent vite leurs illusions. Ce qu'ils avaient pris pour l'avènement de la raison et de l'État rationnel était en réalité celui de la raison d'État, cynique et autoritaire.
…OU UNE MONARCHIE MODÉRÉE ?
Montesquieu, lui, est favorable à une monarchie modérée, de type anglais, où la liberté est assurée par la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. L'Angleterre est pour lui le royaume le mieux gouverné de l'Europe, parce que le citoyen y est protégé par la loi contre tout arbitraire et parce que le roi respecte la loi qu'il n'a pas élaborée lui-même, prérogative qui appartient aux représentants élus de la nation.
Pour autant, le rôle prééminent de la noblesse dans la nation et au Parlement n'est pas remis en cause. Montesquieu propose qu'en France les « pouvoirs intermédiaires » (clergé, noblesse, parlements judiciaires) exercent une forme de contrôle, comme représentants naturels de la nation, sur la monarchie : son libéralisme politique est donc limité aux élites.
UN CREUSET D'IDÉES NOUVELLES
Les écrivains-philosophes ne marchent pas tous du même pas. Des lignes de partage se dessinent entre un courant déiste (Voltaire) et un matérialisme convaincu (Diderot, d'Holbach), entre une revendication générale de liberté (Voltaire encore) et un souci d'égalité et de justice sociale (Rousseau). À la fin du siècle, une nouvelle génération – celle des Idéologues – tentera d'articuler théorie et pratique et de définir une science de l'homme qui, par la mise en œuvre de réformes politiques et culturelles, assure le progrès de l'esprit humain.
Mais, en réaction à l'affirmation de cette raison collective, le moi sensible revendique ses droits : Rousseau, qui a posé dans le Contrat social les conditions de légitimité de toute autorité politique, donne avec ses Confessions le modèle de l'expression authentique d'un être unique et fait de la remontée aux sources de l'enfance et du passé l'origine de toute création littéraire.
2.2. IDÉES ET IDÉAUX DES LUMIÈRES
Le fonds commun des Lumières réside dans un rejet de la métaphysique, selon laquelle la transcendance (Dieu) précède la réalité (le monde). Les termes en sont inversés : la transcendance est ce qui reste, ce qui résiste à toute analyse rationnelle, scientifique, historique. Par-delà leur diversité, les hommes des Lumières ont en commun cette attitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique, de l'expérimentalisme de Newton et de Locke : chercher dans l'investigation empirique des choses les rapports, les corrélations, les lois qui les régissent, et qui ont été jusqu'à présent masqués par lespréjugés.
REJETER LES DOGMES
Du coup, la vérité est recherchée du côté du monde physique, de l'univers pratique. Avec les Lumières, le regard intellectuel curieux se détourne du ciel au profit du monde concret des hommes et des choses. Les dogmes et les vérités révélées sont rejetés. Les Lumières refusent la prétention de la religion à tout expliquer, à fournir les raisons ultimes ; elles veulent distinguer entre les différentes sphères de la réalité : le naturel, le politique, le domestique, le religieux, chacun ayant son domaine de pertinence et ses lois, chacun exigeant des savoirs et des méthodes de connaissance différents.
Rejet des dogmes mais pas rejet de Dieu. La plupart des intellectuels éclairés restent néanmoins déistes : pour eux, l'Univers est une mécanique admirablement réglée, dont l'ordre implique une intelligence ordonnatrice. « Je ne puis imaginer, dit Voltaire, que cette horloge marche et n'ait pas d'horloger. »
RECOURIR À LA RAISON EXPÉRIMENTALE
L'expérience occupe une place centrale dans la théorie de la connaissance du xviiie s. Cette méthode procède par l'observation, l'analyse, la comparaison. D'où l'importance du voyage comme moyen de connaissance ; d'où aussi le souci presque obsessionnel de la classification des faits, de la construction de tableaux : connaître, c'est décrire, inventorier, ordonner. Ainsi procède Buffon dans les trente-six volumes de son Histoire naturelle.
La raison expérimentale, dès lors, ne connaît pas de frontières : les Lumières opèrent une formidable expansion de la sphère de la connaissance scientifique. La raison est universelle ; à côté des sciences naturelles et des sciences de la vie se développent les sciences humaines : ethnologie, psychologie, linguistique, démographie. Dans l'Esprit des lois, Montesquieu invente une sociologie politique, en recherchant les rapports qui unissent les mœurs de chaque peuple et la forme de son gouvernement.
MARCHER VERS LE BONHEUR
La philosophie des Lumières procède d'un humanisme laïque : elle place l'homme au centre du monde, et entend œuvrer à son bonheur. Pour Voltaire, « le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues, occupe le pauvre et l'enrichit, encourage les mariages, établit l'orphelin. Il n'attend rien des hommes, mais leur fait tout le bien dont il est capable ».
Un tel humanisme se situe à rebours de l'espérance chrétienne : « La vertu consiste à faire du bien à ses semblables et non pas dans de vaines pratiques de mortifications », écrit encore Voltaire. Foin des prières et des cierges dans les églises, il faut des actes. Tout l'effort de connaissance est orienté vers l'utilité commune. Cette conception utilitariste fait du bonheur le bien suprême. Elle tourne le dos à l'idée chrétienne de purification par l'épreuve et la souffrance, ainsi qu'aux notions nobiliaires et militaires d'héroïsme et de gloire.
Il y a là un optimisme fondamental, aux effets mobilisateurs : les hommes des Lumières croient au progrès possible des connaissances, à la capacité de la raison de saper les conventions, les usages et les institutions qui contredisent la nature et la justice. Pour eux, l'avancée de la science garantit la marche vers le bonheur. Cette foi dans le progrès indéfini de l'humanité se trouve d'ailleurs confortée par les découvertes scientifiques et la croissance économique du siècle.
3. LA DIFFUSION DES LUMIÈRES
Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l'ont précédé par son destinataire : l'opinion publique. Voltaire, Diderot et leurs amis sont des agitateurs d'idées ; ils veulent discuter, convaincre. Les progrès de l'alphabétisation et de la lecture dans l'Europe du xviiie s. permettent le développement de ce qu'on a appelé un « espace public » : les débats intellectuels et politiques dépassent le cercle restreint de l'administration et des élites, impliquant progressivement des secteurs plus larges de la société. La philosophie est à double titre « l'usage public de la raison », comme le dit Kant : à la fois le débat public, ouvert, contradictoire, qui s'enrichit de la libre discussion, et l'agitation, la propagande pour convaincre et répandre les idées nouvelles.
3.1. LES CAFÉS ET LES SALONS LITTÉRAIRES
Le siècle des Lumières invente, ou renouvelle profondément, des lieux propices au travail de l'opinion publique. Ce sont d'abord les cafés, où on lit et on débat, comme le Procope, à Paris, où se réunissent Fontenelle, Voltaire, Diderot, Marmontel, et qui sont le rendez-vous nocturne des jeunes poètes ou des critiques qui discutent passionnément des derniers succès de théâtre ou de librairie.
Ce sont surtout les salons mondains, ouverts par tous ceux qui ont quelque ambition, ne serait-ce que celle de paraître – et souvent, des femmes jouent un rôle essentiel dans ce commerce des intelligences, dépassant le simple badinage et la préciosité. Mais il faut y être introduit. Les grandes dames reçoivent artistes, savants et philosophes. Chaque hôtesse a son jour, sa spécialité et ses invités de marque. Le modèle est l'hôtel de la marquise de Lambert, au début du siècle. Plus tard, Mme de Tencin, rue Saint-Honoré, accueille Marivaux et de nombreux autres écrivains. Mme Geoffrin, Mme du Deffand, Julie de Lespinasse, puis Mme Necker reçoivent les encyclopédistes. Les gens de talent s'y retrouvent régulièrement pour confronter leurs idées ou tester sur un public privilégié leurs derniers vers. Mondaines et cultivées, les créatrices de ces salons animent les soirées, encouragent les timides et coupent court aux disputes. Ce sont de fortes personnalités, très libres par rapport à leurs consœurs, et souvent elles-mêmes écrivains et épistolières.
3.2. LES ACADÉMIES ET LES LOGES
Les académies sont des sociétés savantes qui se réunissent pour s'occuper de belles-lettres et de sciences, pour contribuer à la diffusion du savoir. En France, après les fondations monarchiques du xviie s. (Académie française, 1634 ; Académie des inscriptions et belles-lettres, 1663 ; Académie royale des sciences, 1666 ; Académie royale d'architecture, 1671), naissent encore à Paris l'Académie royale de chirurgie (1731) et la Société royale de médecine (1776). Le clergé et, dans une moindre mesure, la noblesse y prédominent. En province, il y a neuf académies en 1710, 35 en 1789.
Ces sociétés provinciales regroupent les représentants de l'élite intellectuelle des villes françaises. Leur composition sociale révèle que les privilégiés y occupent une place moindre qu'à Paris : 37 % de nobles, 20 % de gens d'Église. Les roturiers constituent 43 % des effectifs : c'est l'élite des possédants tranquilles qui siège là. Marchands et manufacturiers sont peu présents (4 %).
Toutes ces sociétés de pensée fonctionnent comme des salons ouverts et forment entre elles des réseaux provinciaux, nationaux, européens, échangeant livres et correspondance, accueillant les étrangers éclairés, lançant des programmes de réflexion, des concours de recherche. On y parle physique, chimie, minéralogie, agronomie, démographie.
Parmi les réseaux éclairés, le plus développé est celui de la franc-maçonnerie, quoique réservé aux couches supérieures et aux hommes. Née en Angleterre et en Écosse, la franc-maçonnerie, groupement à vocation philanthropique et initiatique, concentre tous les caractères des Lumières : elle est théiste, tolérante, libérale, humaniste, sentimentale. Elle connaît un succès foudroyant dans toute l'Europe, où l'on compte des milliers de loges en 1789. Les milieux civils, militaires et même religieux, liés aux appareils d'État, y sont tout particulièrement gagnés. Ni anticléricales (elles le seront au xixe s.) ni révolutionnaires, les loges ont contribué à répandre les idées philosophiques et l'esprit de réforme dans les lieux politiquement stratégiques. La discussion intellectuelle l'emporte sur le caractère ésotérique ou sectaire. Surtout, les élites y font, plus encore que dans les académies, l'apprentissage de l'égalité des talents, de l'élévation par le mérite et non par le privilège de la naissance.
3.3. LES BIBLIOTHÈQUES, LES LIVRES, LA PRESSE
Voisines des académies, souvent peuplées des mêmes hommes avides de savoir, les bibliothèques publiques et chambres de lecture se sont multipliées, fondées par de riches particuliers ou à partir de souscriptions publiques. Elles collectionnent les travaux scientifiques, les gros dictionnaires, offrent une salle de lecture et, à côté, une salle de conversation.
La presse enfin contribue à la constitution d'un espace public savant, malgré la censure, toujours active. Le Journal des savants, le Mercure de France, les périodiques économiques sont en fait plutôt ce que nous appellerions des revues. Par les recensions d'ouvrages et par les abonnements collectifs des sociétés de pensée, un public éloigné des centres de création peut prendre connaissance des idées et des débats, des découvertes du mois, sinon du jour.
4. L'ENCYCLOPÉDIE
Un ouvrage – ou plutôt un ensemble de 35 volumes auquel ont collaboré 150 savants, philosophes et spécialistes divers – incarne à lui seul la vaste entreprise humaniste et savante des Lumières : c'est l'Encyclopédie. Travail collectif mené sur près de vingt ans, le projet repose sur un animateur essentiel, Diderot, qui en définit ainsi l’objet : « Le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux... ». Mais cette somme est aussi un combat : sa rédaction et sa publication voient se heurter raison et religion, liberté et autorité.
4.1. UNE FORMIDABLE AVENTURE ÉDITORIALE
L’histoire de l’édition de L’Encyclopédie (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) est à la fois longue et complexe, jalonnée de succès et de revers pour les auteurs. Les hautes protections dont ceux-ci bénéficient ne sont d’ailleurs pas étrangères à la violence de la bataille : dans l’entourage même de Louis XV, Mme de Pompadour ou Guillaume de Malesherbes, directeur de la Librairie et responsable de la censure royale, soutiennent l’entreprise, tandis que la reine et les jésuites cherchent à la ruiner.
Les atteintes à la religion et les professions de foi matérialistes, nombreuses dans l’ouvrage, suscitent procès, demandes d’interdiction, pamphlets, arrêt du Conseil d’Etat. La parution des volumes est plusieurs fois interrompue et menacée. En cours de publication, l’imprimeur craint d’être enfermé à la Bastille, et supprime de sa propre initiative les passages qu’il juge les plus dangereux, ce qui complique un peu plus les choses.
4.2. UN MAÎTRE D’ŒUVRE : DIDEROT
Le succès final tient à la ténacité de Diderot, assisté les premières années de d’Alembert. Si l’ouvrage a pour point de départ la traduction et l’adaptation en français de la Cyclopaedia (1728) de l’Anglais Ephraim Chambers, le chantier, que leur a confié le libraire et éditeur Le Breton, va bien au-delà. L’idée de traduire Chambers est abandonnée : une œuvre originale s’annonce.
Diderot a le culte des idées, de la raison humaine et du progrès, ce qui fait de lui le représentant par excellence des Lumières. Il vise en fait à livrer un panorama complet des connaissances scientifiques et du débat philosophique au milieu du xviiie siècle. L’équipe des rédacteurs est nombreuse, car le principe retenu a été de s’adresser aux spécialistes des questions traitées, de façon à atteindre une exactitude technique irréprochable.
Mais derrière les noms plus ou moins illustres des contributeurs, Jean-Jacques Rousseau, ou Voltaire, l’architecte Blondel, l’astronome Le Roy, le juriste Toussaint, etc., c’est Diderot qui demeure maître d’œuvre et relit, corrige, et coordonne plus de 71 000 articles.
4.3. UNE PLACE DE CHOIX POUR L’ILLUSTRATION
La place qu’elle réserve aux illustrations est une caractéristique de l’Encyclopédie, et un fardeau supplémentaire dans une aventure éditoriale compliquée.
Certes les gravures sont moins sujettes à polémiques que les articles de fond sur des notions abstraites ou complexes telle que « Raison », « Homme », ou « Christianisme ». Mais l’abondance et la qualité d’exécution de ces gravures suscitent des frais importants, envisagés dès le départ dans un pari de rentabilité : en 1750, lors de la première offre aux souscripteurs de l’ouvrage, il est prévu 2 volumes de planches pour 8 volumes de textes.
L’Encyclopédie se compose finalement de 17 volumes de textes et de 11 volumes de planches (plus 2 volumes d’index et 5 de suppléments). Ainsi le principe de l’image est-il renforcé en cours de route, et l’illustration joue-t-elle sa part, considérable, dans la visée encyclopédique. Les machines qui sont démontées et détaillées, les outils qui sont présentés et expliqués contribuent à un éloge du génie humain à travers son expression la plus positive.
4.4. UN BEST-SELLER AU XVIIIe SIÈCLE
La masse des souscripteurs de l’Encyclopédie varie au cours des vingt et une années qui s’écoulent entre la sortie du premier volume et du dernier, de 1751 à 1772. Au moment où le livre va commencer à paraître, ils sont 1000 qui s’engagent à l’acheter et acceptent d’avancer 20 % du montant du prix total. Par la suite, ce nombre double, triple et même quadruple pour enfin se stabiliser autour de 2 500.
L’ouvrage ayant été imprimé à plus de 4 000 exemplaires – ce qui est considérable pour l’époque –, la vente ferme d’un peu plus de la moitié du tirage est faite avant l’arrivée du livre en librairie. Outre les esprits cultivés étrangers lisant le français, les imitations et traductions assureront la diffusion de l’œuvre dans toute l’Europe, y répandant l’esprit des Lumières.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
