|
|
|
|
 |
|
Une avancée majeure sur la génétique et les facteurs de risque d’une forme d’infarctus qui touche majoritairement les femmes |
|
|
| |
|
| |

Une avancée majeure sur la génétique et les facteurs de risque d’une forme d’infarctus qui touche majoritairement les femmes
31 Mai 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition | Santé publique
La dissection spontanée de l’artère coronaire, plus connue sous l’acronyme SCAD, est une cause d’infarctus dont 9 victimes sur 10 sont des femmes dans la quarantaine, en apparente bonne santé. Encore mal comprise, elle est souvent sous-diagnostiquée, ce qui complique la prise en charge alors qu’elle pourrait représenter jusqu’à un tiers des cas d’infarctus chez les femmes de moins de 60 ans. Afin de comprendre les causes génétiques et les mécanismes biologiques à son origine, une nouvelle étude internationale dirigée par Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm au Paris Centre de recherche cardiovasculaire – PARCC (Inserm/Université Paris Cité) a été mise en place. Les résultats obtenus montrent que les causes génétiques qui définissent le risque de la SCAD sont très nombreuses et réparties sur l’ensemble du génome des patients. L’étude identifie 16 régions génomiques associées à un risque plus élevé de SCAD, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents à cette maladie. L’étude est parue le 29 mai 2023 dans Nature Genetics.
Contrairement à la majorité des maladies cardiovasculaires comme l’infarctus de myocarde, qui affectent principalement les hommes âgés et/ou en surpoids, la dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD) est une forme d’infarctus qui touche les femmes dans 9 cas sur 10. Celles-ci sont souvent dans la quarantaine, même si la maladie peut également survenir plus tôt, dans l’année qui suit un accouchement, ou plus tard, pendant la transition vers la ménopause. De plus en plus reconnue comme une forme importante d’infarctus au sein de cette population, la SCAD demeure toutefois encore assez mal documentée du fait notamment d’un manque de données et d’une méconnaissance des facteurs de risque qui lui sont spécifiques, notamment génétiques.
Dans les 20 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour détailler les mécanismes du développement de pathologies coronaires comme l’athérosclérose et sur les formes très rares et syndromiques des maladies cardiovasculaires. De telles connaissances sont primordiales pour mieux appréhender ces pathologies et concevoir des stratégies de prévention et de traitements améliorés et personnalisés.
Néanmoins, la recherche a pris un retard important dans la compréhension des maladies comme la SCAD qui touchent des femmes à des étapes charnières de leur vie. Il est donc essentiel de s’intéresser maintenant à cette maladie cardiovasculaire si peu étudiée et au risque génétique qui lui est propre.
L’équipe de la généticienne Inserm Nabila Bouatia-Naji donc mené un travail de grande ampleur sur le sujet, en coordonnant une méta-analyse de 8 études d’association pangénomique (en anglais genome-wide association study, GWAS)[1]. En comparant les données génétiques de plus de 1900 patients et d’environ 9300 personnes non-malades, les scientifiques ont identifié 16 régions génomiques (ou loci) de prédisposition génétique à la SCAD.
Vers une meilleure compréhension des mécanismes biologiques
Ce travail a d’abord permis de montrer que les variations génétiques que l’on retrouve le plus souvent chez les patient(e)s ayant survécu à la SCAD jouent un rôle dans la composition du « ciment » qui entoure les cellules de l’artère coronaire.
Cependant, un des gènes identifiés est F3 et il code le facteur de coagulation tissulaire. En temps normal, le facteur tissulaire initie la coagulation au niveau des cellules afin de résorber d’éventuelles hématomes. Les résultats de l’étude suggèrent qu’un défaut d’expression de F3 est souvent retrouvé chez les patient(e)s ce qui constitue une cause potentielle d’une mauvaise réparation des artères, pouvant aboutir à leur déchirure. La mauvaise résorption de l’hématome serait donc une cause génétique de l’infarctus qui était inconnue jusqu’à présent.
L’un des autres objectifs de cette étude a été de positionner la SCAD par rapport à d’autres maladies cardiovasculaires afin de mieux connaître ses spécificités épidémiologiques. En utilisant les données qui déterminent les facteurs de risque cardiovasculaires génétiques et des méthodes de statistiques astucieuses, les scientifiques ont mis en évidence un lien robuste entre la pression artérielle élevée et le risque de la SCAD, tout en confirmant que le cholestérol élevé, le surpoids et le diabète de type 2 n’avaient aucun impact sur ce risque.
« Ce résultat pourrait donc s’avérer intéressant sur le plan clinique à plus long terme, pour encourager les médecins à surveiller de près l’évolution de la pression artérielle chez les patients et patientes qui présentent un risque génétique accru de SCAD », explique Nabila Bouatia-Naji, directrice de recherche à l’Inserm et dernière auteure de l’étude.
Finalement, ce travail met en évidence un lien génétique entre l’infarctus dû à la SCAD et l’infarctus dû à l’athérosclérose (aussi appelé infarctus athéromateux). En effet, les chercheurs ont montré qu’un grand nombre de régions génomique de prédisposition à la SCAD sont partagées avec celles de l’infarctus athéromateux.
Cependant, même s’il s’agissait des mêmes variantes génétiques, les allèles[2] qui sont plus fréquents chez les patients atteints de SCAD sont systématiquement décrites comme moins fréquents chez les sujets atteints de l’infarctus athéromateux.
« Ce résultat est très surprenant, car ils montrent que selon si l’on est face à une jeune femme sans facteurs de risques, ou un homme plus âgé et présentant des facteurs de risque, les causes génétiques et les mécanismes biologiques associés à leur infarctus peuvent être opposés. Nos résultats alertent sur le besoin de mieux comprendre les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes jeunes afin d’améliorer leur suivi qui est actuellement identique à celui de l’infarctus athéromateux », conclut Nabila Bouatia-Naji.
Forte de ces résultats, l’équipe travaille désormais au développement de nouveaux modèles cellulaires et animaux qui rendent mieux compte des facteurs génétiques impliqués dans la maladie, afin notamment de mieux étudier leur impact sur l’état des artères. Avec toujours un objectif en tête à plus long terme : celui de faire sortir de l’ombre une maladie cardiovasculaire essentiellement féminine et trop souvent négligée, et d’améliorer la manière dont elle est comprise et prise en charge.
[1] Étude d’association génétique à grande échelle (Genome-Wide Association Studies), largement pratiquées depuis plusieurs années, qui consiste à analyser le génome entier de milliers de personnes saines et malades, afin d’identifier les régions génomiques dans lesquelles doivent se trouver des gènes influençant la vulnérabilité des personnes à l’affection en cause
[2] Un allèle est une version d’une variante génétique résultant d’un changement dans la séquence de l’ADN. Toute séquence d’ADN peut avoir plusieurs allèles, qui déterminent souvent l’apparition de caractères héréditaires différents.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Mieux comprendre le développement de la tête humaine grâce à sa toute première cartographie 3D chez l’embryon |
|
|
| |
|
| |

Mieux comprendre le développement de la tête humaine grâce à sa toute première cartographie 3D chez l’embryon
08 Déc 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie

Image 3D obtenue en microscope à feuillet de lumière d’une glande lacrymale d’embryon humain de 12 semaines transparisé. Les différents éléments de la glande ont été colorisés à l’aide d’un logiciel de réalité virtuelle. © Raphael Blain/Alain Chédotal, Institut de la Vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université)
Améliorer nos connaissances du développement des structures complexes qui composent la tête humaine et ainsi mieux comprendre les anomalies congénitales causant des malformations : c’est le défi auquel une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université à l’Institut de la vision, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et des Hospices civils de Lyon est en passe de répondre. Grâce à une technique innovante permettant de rendre les structures crâniennes transparentes puis de prendre des photos 3D des cellules qui les composent, cette équipe de recherche a pu établir la toute première carte tridimensionnelle de la tête humaine embryonnaire. Ces résultats, à paraître dans Cell, ont déjà permis de mieux comprendre comment se forment certaines structures complexes de la tête, comme les glandes lacrymales et salivaires ou les artères de la tête et du cou. Ils ouvrent la voie à de nouveaux outils d’étude du développement embryonnaire.
La tête est la structure la plus complexe du corps humain. Outre les muscles et la peau qui la protègent, et le cerveau qu’elle abrite dans le crâne, elle contient notamment des vaisseaux, des nerfs ainsi que des glandes endocrines (qui sécrètent des hormones directement dans la circulation sanguine), comme l’hypophyse, et exocrines (qui sécrètent des substances vers le milieu extérieur), comme les glandes salivaires, qui produisent la salive, ou les glandes lacrymales, qui sécrètent les larmes.
Les connaissances actuelles sur le développement de la tête humaine et des structures complexes qui la composent sont rudimentaires et proviennent d’études réalisées pour la plupart dans la première moitié du xxe siècle, à l’aide de simples coupes histologiques. Ainsi, bien que des malformations de la tête existent chez environ un tiers des bébés présentant des anomalies congénitales, les mécanismes qui contrôlent le développement de la tête humaine sont encore mal compris.
Une équipe de recherche dirigée par Alain Chédotal, directeur de recherche Inserm à l’Institut de la vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université) et professeur au laboratoire MéLiS des Mécanismes en sciences intégratives du vivant (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Hospices civils de Lyon), et par Yorick Gitton, chargé de recherche CNRS également à l’Institut de la vision, a utilisé une méthode de microscopie innovante pour apporter un nouvel éclairage sur le développement de la tête humaine.
La technologie mise en œuvre avait précédemment été utilisée chez l’embryon par l’équipe pour étudier le développement d’autres organes humains[1]. Elle est appelée transparisation car elle permet de rendre les organes transparents à la lumière. L’échantillon transparisé est ensuite imagé en 3D à l’aide d’un microscope spécial qui scanne avec une fine feuille de lumière laser. Ceci permet de localiser in situ les cellules qui constituent les tissus embryonnaires.
Les chercheuses et chercheurs sont parvenus à appliquer cette technique à des embryons à différents stades de développement, issus de la biobanque de tissus humains constituée dans le cadre du programme HuDeCA (Human Developmental Cell Atlas) coordonné par l’Inserm[2]. Grâce aux clichés obtenus, ils sont ainsi parvenus à dresser la première carte tridimensionnelle de la tête humaine embryonnaire[3].
Dans un second temps, l’équipe de recherche a utilisé la réalité virtuelle pour analyser les images 3D et « naviguer » ainsi virtuellement dans les embryons.
« Cela nous a permis de découvrir des caractéristiques jusqu’alors inconnues du développement des muscles, des nerfs et des vaisseaux sanguins crâniens, du crâne et des glandes exocrines crâniennes, indique Alain Chédotal. Par exemple, les tout premiers stades de développement des glandes salivaires et lacrymales n’avaient jamais pu être étudiés chez l’être humain. Nos travaux nous ont permis de commencer à visualiser et à mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la mise en place de ces structures extrêmement complexes anatomiquement », ajoute-t-il.

Image 3D obtenue en microscope à feuillet de lumière d’un œil d’embryon humain transparisé de 12 semaines. Les 6 muscles oculomoteurs responsables des mouvements des yeux et les 3 nerfs moteurs (en blanc, vert et rouge), ont été colorisés à l’aide d’un logiciel de réalité virtuelle. ©Raphael Blain/Alain Chédotal, Institut de la Vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université)
Les scientifiques ont également mis en place une interface web (Hudeca.com) permettant non seulement d’accéder aux images obtenues dans ces travaux, mais également à des modèles pour l’impression 3D et à des reconstructions 3D interactives d’embryons humains. Cette plateforme fournit ainsi de précieuses ressources qui pourront également contribuer à la formation des étudiants en médecine.
Dans de prochains travaux, l’équipe de recherche va tenter de cartographier toutes les cellules de certains organes, comme la rétine.
« À ce stade, c’est un peu comme si nous avions cartographié les continents et les pays mais qu’il nous restait à positionner les villes et les habitants », explique Alain Chédotal, dont l’équipe va aussi collaborer avec des médecins pour appliquer la technologie à des prélèvements pathologiques.
« Les nouvelles connaissances sur l’embryologie humaine apportées par ces travaux, ainsi que les nouveaux outils qui y sont développés, ont des implications importantes pour la compréhension des malformations cranio-faciales et des troubles neurologiques, ainsi que pour l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques », conclut le chercheur.
[1] Voir à ce sujet notre communiqué de presse du 23 mars 2017 : https://presse.inserm.fr/lembryon-humain-comme-vous-ne-lavez-jamais-vu/27807/
[2] Lancé en 2019, le programme transversal HuDeCa porté par l’Inserm a pour objectif de construire le premier atlas des cellules de l’embryon et du fœtus humain. Il ambitionne également la structuration de la recherche en embryologie humaine au niveau français et le développement des bases de données. À plus long terme, ce programme devrait servir de fondement à la compréhension de l’origine des maladies chroniques ou des malformations congénitales.
[3] À l’exception spécifique du cerveau, qui n’est pas une structure étudiée dans ces travaux.
DOCUMENT inra LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des réseaux cérébraux associés aux ruminations mentales et leur évolution chez le jeune adulte |
|
|
| |
|
| |
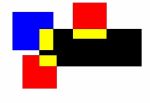
Des réseaux cérébraux associés aux ruminations mentales et leur évolution chez le jeune adulte
09 Oct 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Une étude décrit pour la première fois les réseaux cérébraux associés aux ruminations mentales ces pensées répétitives, et leur évolution entre les âges de 18 et 22 ans. Ce travail mené par l’équipe Inserm « Trajectoires développementales en psychiatrie » (Inserm/ENS Paris-Saclay) au sein du Centre de mathématiques appliquées Borelli[1] montre également une association entre les réseaux cérébraux des ruminations et certains symptômes psychiatriques. Les chercheurs se sont appuyés sur la cohorte IMAGEN destinée à explorer la santé mentale de jeunes européens à partir de 14 ans. Ce travail, publié dans la revue Molecular Psychiatry, fournit des pistes pour la prévention en santé mentale.
Les ruminations sont des pensées répétitives, avec le sentiment de tourner en boucle. Elles se manifestent fréquemment au cours de la transition de l’adolescence vers le stade de jeune adulte, et sont liées notamment aux difficultés de l’entrée dans la vie adulte.
La littérature décrit trois types de ruminations. Les ruminations « réflexives » ne sont pas négatives ; elles visent à chercher une solution à un problème et peuvent faire partie d’un processus de réflexion (trouver un logement, un emploi, etc.). Les ruminations « soucieuses » sont liées à des situations complexes ou conflictuelles, avec des difficultés à prendre du recul (soucis professionnels, difficultés financières, etc.). Enfin, le troisième type de ruminations est de nature « dépressive » avec des pensées noires répétitives sur sa situation ou son avenir.
Fréquentes chez les adolescents, ces dernières peuvent s’associer à des états d’anxiété, d’agressivité, de dépression, ou encore des addictions. Considérées comme un facteur de risque de maladie psychiatrique, elles précèdent le plus souvent l’apparition de troubles à l’âge adulte. C’est pourquoi il est important de mieux comprendre les mécanismes cérébraux qui leur sont associés.
C’est dans cet objectif qu’une équipe menée par les chercheurs Inserm Jean-Luc Martinot et Eric Artiges au sein du laboratoire « Trajectoires développementales en psychiatrie » s’est intéressée pour la première fois aux réseaux cérébraux associés aux différents types de ruminations au cours de la transition du stade adolescent à jeune adulte.
À cette fin, l’équipe a étudié 595 jeunes inclus dans la cohorte européenne IMAGEN[2] et suivis entre les âges de 18 à 22 ans.
Des réseaux spécifiques associés aux ruminations
Les jeunes ont passé des IRM fonctionnelles au repos. Cette technique de neuroimagerie permet de suivre l’activité cérébrale spontanée dans toutes les régions du cerveau.
« Lors de cet examen, les sujets n’avaient aucune consigne et étaient laissés libres de leurs pensées. De sorte que les profils « ruminateurs » se sont laissés aller à leurs ruminations », précise Jean-Luc Martinot.
Ces jeunes ont aussi répondu à des questionnaires pour mesurer la fréquence et le type de leurs ruminations, et évaluer la présence éventuelle de symptômes psychiatriques.
En premier lieu, les chercheurs ont recoupé l’imagerie et les réponses aux questionnaires à 18 ans, en utilisant un modèle mathématique innovant. Cela leur a permis d’associer chaque type de rumination à l’activité simultanée de deux à trois réseaux cérébraux spécifiques.
Ils ont par exemple montré qu’à 18 ans les ruminations « soucieuses » s’appuyaient sur des réseaux cérébraux engageant l’hippocampe et le lobe frontal. Les ruminations « dépressives » apparaissaient, elles, associées à d’autres réseaux engageant le noyau thalamique et une partie du lobe frontal.
Des changements à 22 ans
Ce travail a ensuite été renouvelé chez ces mêmes participants à l’âge de 22 ans, afin d’évaluer comment les ruminations et les processus cérébraux associés évoluaient au cours du temps.
« A cet âge de leur vie, les jeunes adultes montraient une diminution des ruminations « soucieuses » en faveur de ruminations « réflexives », explique Jean-Luc Martinot, ceci suggère qu’entre 18 et 22 ans, période de transition vers l’adulte, ils et elles ont acquis une meilleure capacité d’adaptation aux émotions négatives et une meilleure aptitude à la prise de décision ».
Cela se traduit concrètement au niveau cérébral : en passant d’un type de rumination à un autre, les chercheurs ont constaté que les réseaux cérébraux activés chez les participants étaient également refaçonnés.
Dans la suite de l’étude, l’équipe a enfin montré que les réseaux cérébraux associés aux différents types de rumination étaient par ailleurs associés à certains symptômes psychiatriques. Plus précisément, l’activité d’un réseau associé aux ruminations soucieuses était aussi associée à des symptômes « internalisés » (anxiété, nervosité, retrait, etc.). L’activité d‘un réseau associé aux ruminations « dépressives » était aussi associée à des symptômes « extériorisés » (agitation, irritabilité, recours aux passages à l’acte, à des substances, etc.).
« Ce travail révèle des liens entre l’évolution des ruminations mentales et l’évolution de symptômes psychiatriques, par l’intermédiaire de changements fonctionnels du cerveau à la fin de l’adolescence. Deux types de ruminations peuvent précéder des symptômes psychiatriques. Ces données pourraient contribuer au développement des approches préventives chez les jeunes adultes », conclut Jean-Luc Martinot.
[1] Le Centre Borelli est sous tutelle CNRS/ ENS Paris-Saclay/ Université Paris-Saclay/ Université Paris-Cité/ Inserm/ Service de santé des armées
[2] Co-fondée par Jean -Luc Martinot, la cohorte IMAGEN est destinée à suivre la santé mentale d’adolescents à partir de 14 ans à l’aide de données psychologiques, cliniques, environnementales, et d’imagerie du cerveau.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Privilégier la lumière naturelle pour éviter les troubles du sommeil liés à l’âge |
|
|
| |
|
| |

Privilégier la lumière naturelle pour éviter les troubles du sommeil liés à l’âge
30 Jan 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie | Non classifié(e) | Technologie pour la sante
Un adulte français sur trois serait concerné par un trouble du sommeil. La prévalence de ces troubles augmente avec le vieillissement mais les mécanismes biologiques à l’œuvre sont assez méconnus, laissant planer le doute sur leur origine. Dans une nouvelle étude, Claude Gronfier, chercheur Inserm, et son équipe au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (Inserm/CNRS/Université Claude-Bernard Lyon 1) ont émis l’hypothèse que leur apparition lors du vieillissement était liée à une désynchronisation de l’horloge biologique due à une baisse de perception de la lumière. Durant leurs travaux, ils ont identifié un nouveau mécanisme adaptatif de la rétine au cours du vieillissement qui permet aux individus plus âgés[1] de rester sensibles à la lumière. Ces résultats présentent par ailleurs un intérêt clinique en incitant les personnes plus âgées à s’exposer davantage à la lumière du jour, plutôt qu’à la lumière artificielle, afin d’éviter de développer des troubles du sommeil. Ils sont publiés dans la revue Journal of Pineal Research.
Presque toutes les fonctions biologiques sont soumises au rythme circadien, un cycle d’une durée de 24 heures. La sécrétion de la mélatonine, l’hormone de la nuit, est typiquement circadienne. Sa production augmente en fin de journée peu avant le coucher, contribuant à l’endormissement, et chute avant l’éveil.
De précédentes études ont montré que la sécrétion de cette hormone par le cerveau est bloquée par la lumière, à laquelle elle est très sensible. Cette sensibilité à la lumière peut se traduire par une désynchronisation de l’horloge circadienne, pouvant entraîner l’apparition de troubles du sommeil. D’autres études ont par ailleurs dévoilé le rôle important, dans le contrôle de la production de mélatonine, de la mélanopsine, un photorécepteur présent dans certaines cellules de la rétine qui, très sensible à la lumière (essentiellement à la lumière bleue), permet de réguler le réflexe pupillaire et le rythme circadien. Ainsi, lors d’une exposition à la lumière, la mélanopsine devient moteur de la suppression de mélatonine et de la synchronisation de l’horloge biologique.
Si les troubles du sommeil chez l’adulte sont fréquents, ils augmentent avec l’âge : près d’un tiers des personnes de plus de 65 ans consomme des somnifères de manière chronique[2]. Pourtant, aucune étude ne s’était intéressée spécifiquement au mécanisme biologique à l’œuvre dans les troubles du sommeil liés à l’âge. S’agit-il d’une conséquence d’un problème de perception de la lumière ? Si oui, à quel niveau ? Et quel est le rôle de la mélanopsine dans ce cas précis ?
Une équipe au Centre de recherche en neurosciences de Lyon a tenté d’élucider ce mystère. Les scientifiques ont observé chez un groupe d’adultes les effets de la lumière sur la sécrétion de mélatonine. Tous les participants ont été exposés à 9 lumières de différentes couleurs (correspondant à 9 longueurs d’ondes très précises) pour permettre aux scientifiques d’identifier les mécanismes en cause par le biais des photorécepteurs concernés.
Les participants de l’étude ont été divisés en deux groupes distincts : un groupe à la moyenne d’âge de 25 ans, un autre à la moyenne d’âge de 59 ans. Cette expérience a été réalisée au milieu de la nuit, au moment où l’organisme libère normalement le plus de mélatonine.
Les résultats indiquent que, parmi les lumières testées, la lumière bleue (longueur d’onde aux environs de 480 nm) est très efficace pour supprimer la production de la mélatonine chez les personnes les plus jeunes. Plus spécifiquement, les scientifiques ont observé que chez les jeunes sujets exposés à la lumière bleue, la mélanopsine était le seul photorécepteur moteur de la suppression de la mélatonine. À l’inverse, chez les participants plus âgés, d’autres photorécepteurs que la mélanopsine semblent être impliqués, comme les cônes S et M, des photorécepteurs qui permettent la perception du monde en couleur, et qui sont situés dans la rétine externe.
Ces données suggèrent que le vieillissement s’accompagne d’une diminution de l’implication de la mélanopsine dans la perception visuelle, mais que la rétine parvient à compenser cette perte par une augmentation de la sensibilité d’autres photorécepteurs qui n’étaient jusqu’alors pas connus pour être impliqués dans la suppression de la mélatonine.
Ces observations permettent aux scientifiques de conclure que la perception de la lumière – et les besoins en lumière des individus – évoluent avec l’âge.
En effet, tandis que les personnes les plus jeunes, dont seul le récepteur mélanopsine est impliqué, peuvent se contenter d’une exposition à la lumière bleue[3] pour synchroniser leur horloge circadienne sur une journée de 24 heures, les personnes plus âgées ont besoin d’être exposées à une lumière plus riche en longueurs d’onde (couleurs), une lumière dont les caractéristiques sont celles de la lumière du soleil.
« Il s’agit de la découverte d’un nouveau mécanisme adaptatif de la rétine au cours du vieillissement – permettant au sujet âgé de rester sensible à la lumière malgré le brunissement du cristallin. Ces résultats présentent par ailleurs un intérêt clinique, encourageant les personnes plus âgées à s’exposer davantage à la lumière du jour, plus riche en longueurs d’ondes, plutôt qu’à la lumière artificielle, afin d’éviter de développer des troubles du sommeil et d’autres altérations telles que des troubles de l’humeur ou du métabolisme… Enfin, ils offrent de nouvelles perspectives pour personnaliser de façon optimale les photothérapies/luminothérapies destinées au soin des personnes plus âgées », explique Claude Gronfier, chercheur à l’Inserm, dernier auteur de l’étude.
En lien avec ce dernier aspect, l’équipe de recherche s’intéresse désormais à la quantité et à la qualité de lumière nécessaires à chaque individu, et au meilleur moment de s’exposer à la lumière durant la journée, pour éviter qu’il ou elle ne développe des troubles du sommeil et de la santé en général.
Les travaux de recherche sont réalisés à la fois chez le sujet sain (enfant et adulte), chez le travailleur de jour et de nuit, et chez le patient (troubles du sommeil et des rythmes biologiques, maladies génétiques, troubles de l’humeur, neurodégénérescences)[4].
[1]Dans cette étude, la moyenne d’âge des personnes composant le groupe « plus âgés » était de 59 ans.
[2] https://www.has-sante.fr/jcms/c_1299994/troubles-du-sommeil-stop-a-la-prescription-systematique-de-somniferes-chez-les-personnes-agees
[3] Les éclairages à LED utilisés sont riches en lumière bleue.
[4] https://www.crnl.fr/fr/page-base/groupe-sommeil-rythmicite-circadienne-lhumain-epidemiologie-populationnelle-recherche
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
