|
|
|
|
 |
|
Un nouveau mécanisme impliqué dans la migration des cellules cancéreuses a été mis au jour |
|
|
| |
|
| |
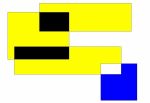
Un nouveau mécanisme impliqué dans la migration des cellules cancéreuses a été mis au jour
COMMUNIQUÉ | 21 JUIN 2017 - 14H17 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION
Une équipe de jeunes chercheurs dirigée par Guillaume Montagnac, chargé de recherche Inserm à Gustave Roussy, en collaboration avec l’Institut Curie et l’Institut de Myologie, a découvert un nouveau mécanisme qui aide les cellules à migrer. La cellule forme à la surface de sa membrane de multiples petites pinces qui l’aident à s’accrocher pour mieux progresser le long des fibres présentes à l’extérieur de la cellule. Ce mécanisme permet de mieux comprendre comment une cellule s’échappe de la masse tumorale et se déplace dans le corps pour aller former un nouveau foyer. Ces travaux sont publiés dans la revue américaine Science du 16 juin.
La migration cellulaire est un processus physiologique indispensable à la vie. En cancérologie il intervient dans la formation de nouvelles métastases.
« Jusqu’à présent, nous savions que la cellule s’appuyait principalement sur certaines structures lui permettant de s’ancrer à son environnement. Aujourd’hui nous identifions de nouvelles structures cellulaires appelées “puits recouverts de clathrine”, déjà connues pour assurer d’autres fonctions dans la cellule. La cellule cancéreuse les utilise comme des pinces pour s’agripper à son environnement pour mieux se déplacer. Ces nouvelles structures sont à l’origine d’environ 50 % de l’adhérence des cellules à leur milieu extérieur » précise Guillaume Montagnac, Chef de l’équipe ATIP-Avenir, rattachée à l’unité Inserm 1170 « Hématopoïèse normale et pathologique » à Gustave Roussy.
Identifiés depuis 1964, ces puits de clathrine sont de petites invaginations de la membrane cellulaire qui permettent de la renouveler ou de faire pénétrer des molécules à l’intérieur des cellules. La cellule les utilise notamment pour s’approvisionner en nutriments (fer, cholestérol…).
Grâce à des techniques de fluorescence, les chercheurs ont réussi à démontrer sur une lignée de cellules du cancer du sein humain agressif, connues pour leur haut pouvoir métastatique, que les puits de clathrine se collent aux fibres de collagène et les entourent. Le puits pince la fibre et renforce ainsi son ancrage permettant de faciliter son déplacement.
« Notre équipe à Gustave Roussy est l’une des rares à s’intéresser à la dynamique de la membrane cellulaire lorsque la cellule est placée dans des conditions qui se rapprochent de la physiologie, dans des matrices 3D. C’est en étudiant ces puits de clathrine dans des conditions 3D que nous avons pu mettre en évidence ce phénomène là où on ne l’attendait pas » conclut Guillaume Montagnac.
Gustave Roussy
1,5 k abonnés
Découverte d’un nouveau mécanisme impliqué dans la migration des cellules cancéreuses
// Équipes jeunes chercheurs
Au nombre de 6 à Gustave Roussy, les équipes ATIP-Avenir sont issues d’un programme Inserm/CNRS. L’objectif est de permettre à de jeunes chercheurs à haut potentiel de mettre en place et d’animer une équipe au sein d’un laboratoire d’accueil qui met à disposition des locaux et donne l’accès à toutes les facilités du laboratoire.
Dans le cadre de son programme « jeune équipe » Gustave Roussy a complété la dotation financière ATIP-Avenir pour placer ces jeunes chercheurs dans des conditions optimales pour réaliser leurs ambitions scientifiques. Créée en 2014, l’équipe de Guillaume Montagnac compte maintenant 6 personnes. La publication des résultats de recherche dans une revue de très haut niveau international illustre le succès de cette stratégie.
Plus d’informations : https://www.eva2.inserm.fr/EVA/doc/2017AVE/AO_ATIP-Avenir_2017.pdf
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maladie d'Alzheimer : comment les agrégats amyloïdes altèrent le fonctionnement des neurones |
|
|
| |
|
| |
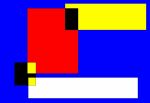
Maladie d'Alzheimer : comment les agrégats amyloïdes altèrent le fonctionnement des neurones
mardi 12 juin 2018
L'accumulation de peptides amyloïdes sous forme de plaques dans le cerveau est l'un des principaux marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Si les effets délétères des agrégats de peptide amyloïdes sont établis, leur mécanisme d'action dans les cellules cérébrales restait mal défini. Des chercheurs du CNRS et de l'université de Bordeaux viennent de mettre en évidence qu'ils altèrent le fonctionnement normal des connections entre neurones en interagissant avec une enzyme clé de la plasticité synaptique. Ces résultats seront publiés le 12 juin 2018 dans la revue Cell Reports .
Touchant près d'un million de Français, la maladie d'Alzheimer est caractérisée par une altération précoce des facultés cognitives des patients suivie d'une dégénérescence neuronale dans les stades plus tardifs. Trois types de lésions cérébrales caractérisent la maladie : la perte neuronale, la dégénérescence fibrillaire et l'accumulation de peptides amyloïdes qui forment les plaques amyloïdes. L'implication respective de ces différents éléments dans le développement des symptômes de la maladie reste à ce jour mal connu.
Les chercheurs savaient par exemple que le peptide amyloïde perturbe les synapses, les zones de contact et de communication chimique entre neurones, mais ignoraient comment, jusqu'aux travaux menés par les équipes de l'Institut interdisciplinaire de neurosciences (CNRS/université de Bordeaux). Celles-ci ont découvert le mécanisme moléculaire liant les agrégats amyloïdes aux déficits de fonctionnement des synapses observés dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer : ces dépôts de peptides interagissent avec une enzyme clé de l'équilibre synaptique, ce qui empêche sa mobilisation normale.
Cette molécule, appelée CamKII, orchestre habituellement la plasticité synaptique, un phénomène d'adaptabilité des neurones leur permettant de renforcer la réponse aux signaux qu'ils échangent. Les ensembles de neurones qui codent pour une information à mémoriser sont connectés par des synapses, qui sont elles-mêmes sous contrôle de mécanismes de plasticité synaptique. Quand la connexion entre deux neurones doit être renforcée pour mémoriser une information, par exemple lors d'une stimulation intense, CamKII s'active et entraîne une cascade de réactions renforçant les capacités de transmission des messages entre ces neurones. La plasticité synaptique est au cœur de la mémoire et de l'apprentissage. Les peptides amyloïdes empêchent CamKII de participer au processus de plasticité synaptique et ce blocage entraîne à terme la disparition de la synapse. Cette découverte pourrait trouver son application dans les phases précoces de la maladie d'Alzheimer où sont observées les premiers déficits cognitifs, qui pourraient être liés à un tel dysfonctionnement des synapses.
L'objectif maintenant pour les chercheurs est de poursuivre l'étude de l'effet des agrégats amyloïdes en essayant en particulier d'empêcher leur interaction avec CamKII et la perte des synapses observées au cours de la maladie.
© Patricio Opazo/Daniel Choquet/IINS
Mesure de l'activité de l'enzyme CaMKII déclenchée par application d'agrégats du peptide amyloïde dans des neurones d'hippocampe de rat en culture. Image de gauche : niveau de base l'activité de CaMKII. Image de droite : activation de CaMKII par le peptide amyloïde.
© Patricio Opazo/Daniel Choquet/IINS
Dendrite de neurone d'hippocampe de rat en culture primaire exprimant une protéine fluorescente soluble (gauche) et trajectoires correspondantes du mouvement de récepteurs du glutamate à sa surface mesurée par suivi de molécule individuelle (droite)
Téléchargez le communiqué de presse :

Références :
CaMKII metaplasticity drives Aβoligomers-mediated synaptotoxicity. P. Opazo, S. Viana da Silva, M. Carta, C. Breillat, S. J. Coultrap, D. Grillo-Bosch, M. Sainlos, F. Coussen, K. U. Bayer, C. Mulle, D. Choquet. Cell Reports, le 12 juin 2018.
Contacts :
Chercheur CNRS | Daniel Choquet | T +33 5 57 57 40 90 | daniel.choquet@u-bordeaux.fr
Presse CNRS | François Maginiot | T +33 1 44 96 43 09 | francois.maginiot@cnrs.fr
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MÉDICAMENTS ET CHIMIE : UN BRILLANT PASSÉ ET UN VRAI FUTUR |
|
|
| |
|
| |

MÉDICAMENTS ET CHIMIE : UN BRILLANT PASSÉ ET UN VRAI FUTUR
Très tôt l’homme a utilisé les produits de la Nature pour traiter les différentes maladies auxquelles il était confronté. Les premiers traités de chimie thérapeutique moderne, décrivant la relation entre un composé chimique et une activité thérapeutique datent maintenant de plusieurs siècles. Toutefois, c'est au tournant du 19ème et du 20ème siècle avec le développement de la chimie moléculaire et de la microbiologie que la chimie thérapeutique prend son essor. L'évolution rapide de ces deux disciplines a conduit aux premiers antibiotiques. Sait-on encore que la production à grande échelle de la pénicilline a mobilisé aux Etats-Unis entre 1943 et 1945 plusieurs centaines de scientifiques, autant que pour la mise au point des premières bombes atomiques ? Tout au long du 20ème siècle, l'application stricte des règles d'hygiène pasteuriennes et la mise au point de nombreux médicaments font régresser les maladies et la durée de vie augmente. Beaucoup reste à faire, mais la création de nouveaux médicaments élaborés par synthèse chimique semble marquer le pas à partir des années 1980 à 1990. Les apports récents de la génomique et la protéomique donnent l'espoir d'accéder à de nouvelles méthodes de découvertes de médicaments. La chimie thérapeutique est-elle condamner à un déclin irréversible ou bien va-t-elle refleurir à nouveau, en intégrant les nouveaux outils de la biologie moléculaire, et apporter de nouveaux espoirs dans le traitement de maladies émergeantes ou ré-émergeantes ? L'innovation thérapeutique demande la mise en place des synergies fortes entre chercheurs de quatre à cinq disciplines différentes ; comment favoriser ces synergies ? Les enjeux de l'innovation thérapeutique concernent non seulement le domaine de la santé, mais aussi celui de l'économie. La découverte et le développement de nouveaux médicaments mobilisent de nombreux effectifs. L'Europe continentale gardera t-elle sa place dans l'innovation thérapeutique au 21ème siècle ?
Transcription [1] de la 617e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 24 juin 2006 revue par l'auteur.
Bernard Meunier : « Médicaments et chimie : un brillant passé et un vrai futur »
Très tôt l'homme a utilisé les produits de la Nature pour traiter les différentes maladies auxquelles il était confronté. Les premiers traités de chimie thérapeutique moderne, décrivant la relation entre un composé chimique et une activité thérapeutique, datent maintenant de plusieurs siècles. Nous allons présenter l'histoire commune de la chimie et du médicament sur plusieurs millénaires avant de décrire les enjeux des thérapies du futur.
Un médicament est une substance possédant des propriétés curatives ou préventives destinées à guérir, soulager ou prévenir des maladies. Il contient à la fois la notion de guérison et de prévention. « Médicament » et son synonyme « remède » viennent du mot latin « mederi » qui signifie « soigner ».
Le mot « médicament » se traduit en anglais par « medication » et plus souvent par « drug », notamment en américain. Le terme « drug » ou « drogue » provient du latin « drogia ». Il est ambigu puisqu'il désigne aussi bien un médicament qu'une substance illicite. En français, il ne désigne plus une préparation magistrale d'un pharmacien d'officine, ou d'un droguiste traditionnel, depuis une cinquantaine d'années.
Les premières sources de médicament sont les plantes. Les chimistes vont très rapidement s'y intéresser. L'homme de Neandertal était déjà un spécialiste de l'utilisation des plantes, y compris pour un usage médicinal. Ainsi des roses trémières ont été retrouvées dans la bouche de néandertaliens qui avaient été ensevelis dans les tombes de la grotte d'Amuci (Israël) [2]. La rose trémière était un analgésique utilisé dans le traitement des infections buccales.
La médecine traditionnelle chinoise est la plus ancienne. Les premières traces écrites de la médecine traditionnelle chinoise remontent à près de 3 000 ans avant J.-C. Le légendaire empereur Shan-Nung avait un herbier de plantes médicinales (2 900 avant J.-C.) ; mais on retiendra surtout l'herbier de Li Shih-Chen de 1578 dont une version anglaise est disponible depuis 2002 sous le titre « Chinese medicinal herbs ».
Les Égyptiens utilisaient également les plantes comme médicaments. Un archéologue allemand, Georg Ebers, de l'université de Leipzig a découvert au XIXème siècle à Louxor un document extraordinaire qu'on appelle « le papyrus d'Ebers ». Ce papyrus qui fait 20 mètres de long est conservé à la bibliothèque de l'université de Leipzig. Cette sorte de codex datant du siècle d'Aménophis Ier (1525-1504 avant J.-C.) est une liste de près de 870 plantes à usage médical.
Hippocrate (né en Grèce sur l'île de Cos en 460 avant J.-C.) recense plus de 400 plantes pour traiter les maladies. Le terme grec « pharmakon » qui a donné « pharmacie » en français a un double sens. Il désigne à la fois la substance qui guérit ou remède, et le poison. En effet, les produits d'origine naturelle ne sont pas inoffensifs. Les grecs savaient parfaitement qu'en fonction de la dose un même produit pouvait avoir une activité curative qui allait soulager le malade ou bien une activité toxique et l'empoisonner. La toxicité est toujours dépendante de la dose.
Claude Galien, autre grand médecin grec (131-201 après J.-C.), est le premier à s'intéresser à la préparation même des médicaments à base de plantes. Son travail est à l'origine de la pharmacie galénique. La pharmacie galénique consiste à préparer à partir d'une substance, un médicament pour le rendre plus agréable, plus facilement assimilable. La pharmacie galénique a été considérée ces derniers temps comme un aspect traditionnel de la pharmacie mais elle retrouve actuellement une nouvelle jeunesse avec l'apport de nouveaux matériaux. Il s'agit d'améliorer l'efficacité des médicaments en améliorant leur biodisponibilité, leur distribution à travers les tissus, pour cibler les organes touchés. Galien a écrit, d'après ses contemporains, plus de cinq cents ouvrages. Malheureusement nous avons très peu de traces de ces ouvrages car leur quasi-totalité a été détruite lors d'un incendie dans le temple de la paix à Rome où il enseignait en 192 après J.-C.
Avicenne (Ibn Sina, né en Perse en 980, mort en 1037) est connu dans l'histoire du médicament comme le médecin arabe qui a permis de retrouver et transmettre les acquis de la médecine grecque et de la médecine égyptienne aux IX-Xèmes siècles. Le « Canon de la médecine » est son ouvrage le plus connu. Le volume 5 décrit 760 médicaments alors qu'Hippocrate en décrivait 400 et « le papyrus d'Ebers » 870. Traduit en latin entre 1150 et 1187 par Gérard de Crémone, cet ouvrage sera la référence médicale jusqu'au XVIIème siècle.
En Europe, après la perte des savoirs qui fait suite à l'effondrement de l'Empire romain, les connaissances sont retrouvées à travers la médecine arabe.
Les alchimistes transmettaient le savoir de ce qui était déjà les balbutiements de la chimie et de l'utilisation des plantes et des produits chimiques pour guérir. Paracelse, médecin alchimiste suisse (1493-1541) est le premier à introduire les produits chimiques de synthèse dans les traitements médicaux. Il signale les propriétés anesthésiques de « l'eau blanche » (éther éthylique ou diéthyléther) obtenue par action de l'acide sulfurique sur l'éthanol : « L'eau blanche fait tomber les poulets dans un sommeil profond dont ils se réveillent sans en subir aucun dommage. » Après l'utilisation des plantes et la reconnaissance de principes actifs dans les plantes, nous arrivons ainsi peu à peu à la création de nouvelles molécules.
L'histoire des médicaments en France du XVème au XVIIIème siècle voit la mise en place des préparations reproductibles, ce qu'on appellerait maintenant les bonnes pratiques de laboratoire. Dans l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, tout ce qui touche les médicaments est largement codifié. Les cahiers de laboratoire sont écrits selon certains critères et les archives sont conservées pour l'essentiel du travail entre 15 et 20 ans. Ces bonnes pratiques ne sont pas récentes puisqu'elles remontent à Jean Le Bon. En 1326, il édite « l'Antidotaire de Nicolas » recommandant aux apothicaires de Paris de suivre de bonnes pratiques de laboratoire.
À partir du XVème siècle, les premiers livres de pharmacopée sont publiés en Europe, notamment :
Ricettario Fiorentino (Italie, XVème siècle)
Codex Medicamentarius (fin XVIème siècle)
Pharmacopea Parsisiensis (1638)
Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697)
Éléments de Pharmacie et de Chimie d'Antoine Baumé (1762)
La rédaction du Codex Medicamentarius, ordonnée en 1568, a demandé plus de quarante années de rédaction collective et a donné lieu à des versions régionales. Il fait partie des grands ouvrages de la vie intellectuelle de cette époque. Il expliquait comment avoir une préparation de médicaments parfaitement reproductible.
Les codex régionaux étaient largement inspirés des codex parisiens, mais il y avait tout de même des divergences et au moment de la rationalisation de la Révolution Française, les pharmacopées régionales ont été abandonnées au profit d'une référence nationale. La loi du 21 germinal de l'an XI, en 1803, impose un texte unique pour les recettes de pharmacopée classique.
La « Pharmacopée universelle » de Nicolas Lémery (1645-1715) est le premier ouvrage décrivant les interactions entre la chimie raisonnée et le monde du médicament. Nicolas Lémery avait une double formation. Après avoir travaillé comme aide apothicaire, il a fait des études de médecine à l'université de Montpellier, dont on n'oublie pas qu'elle a formé Rabelais. Nicolas Lémery y a occupé la Chaire de chimie avant de revenir à Paris et de donner rue Galande des cours de chimie raisonnée en faisant des expériences publiques. Il fait ainsi sortir la chimie de l'alchimie qui était totalement embourbée dans l'obscurantisme. Suivant la pensée raisonnée de Pascal et de Descartes, la révolution vers le siècle des Lumières est en cours. Pour Nicolas Lémery, la chimie va devenir une science raisonnée comme les mathématiques ou la physique. Pour lui, l'essentiel est la reproductibilité des expériences. « Le Cours de Chymie » publié en 1675 par Nicolas Lémery alors âgé de trente ans, a été l'ouvrage de référence en chimie réédité dix-neuf fois pendant un siècle avant d'être remplacé par les premiers livres de chimie moderne.
La chimie moderne, raisonnée, s'est développée grâce aux travaux de Lavoisier, Berthollet, Fourcroy et Guyton de Morveau. Ce quatuor a véritablement révolutionné la chimie à la fin du XVIIIème siècle. Ils introduisent la nomenclature chimique, c'est-à-dire la possibilité de nommer un composé chimique de manière rationnelle de façon à ce que tout le monde puisse parler du même produit dans tous les pays en se comprenant. Les chimistes disposent alors d'un langage universel et rationnel, totalement débarrassé de la poésie et de l'obscurantisme de l'alchimie. Avant 1789, le CO2 ou dioxyde de carbone avait plus de quarante noms différents dont « l'air fixe » ! " « La Méthode de Nomenclature chimique » (1787) par Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet et Fourcroy, et « le Traité élémentaire de chimie » (1789) de Lavoisier marquent l'entrée de la chimie dans les sciences exactes. Parlons un peu de la découverte de l'eau de Javel.
À cette époque, le lin devait être blanchi avant la teinture. Cette opération était réalisée en posant les draps dans un pré. Le rayonnement solaire sur la chlorophylle dégageait de l'oxygène singulet qui provoquait le blanchiment du lin. Les lavandières et les paysans se disputaient l'usage des pâturages. Claude Berthollet en cherchant un agent de blanchiment a synthétisé en 1789 : l'hypochlorite. Cette découverte a été publiée dans les « Les Annales de chimie » créées par Fourcroy, Guyton de Morveau et Lavoisier quelques années auparavant. L'hypochlorite NaOCl est obtenu par oxydation de chlorures qui conduit à la formation de chlore, et la solution aqueuse obtenue devient stable en milieu alcalin, initialement de la cendre, source de potasse. La première usine de fabrication de l'hypochlorite se situait à Javelle, petit village de lavandières de l'Ouest parisien, d'où le nom de l'eau de Javel.
L'eau de Javel est un blanchissant mais aussi un agent de désinfection extraordinaire. Elle lutte efficacement contre les bactéries, les agents pathogènes et les virus, qui ne seront identifiés qu'au milieu du siècle suivant avec l'essor de la microbiologie. Elle a permis de nettoyer les hôpitaux, en particulier les sols des zones infectées, et de sauver des millions de vies. Le Dakin, solution d'hypochlorite coloré avec du permanganate, est toujours utilisé comme désinfectant et les dentistes nettoient les racines des dents infectées avec de l'hypochlorite, notamment pour tuer le virus du SIDA. L'agent désinfectant de l'eau de Javel c'est l'acide hypochloreux, celui là même qui est libéré par les enzymes des macrophages humains pour éliminer les pathogènes.
Le début du XIXème siècle, 1800-1850, voit la naissance de la chimie des produits naturels. Le développement de la chimie rationnelle et l'adoption de méthodes expérimentales rigoureuses permettent de caractériser les produits actifs des plantes médicinales.
La morphine est isolée par un jeune pharmacien allemand, Friederich Sertürner, en 1803.
L'acide salicylique ou salicyline est extrait en 1829 de l'écorce de saule (salix en latin) par Pierre-Joseph Leroux. L'utilisation de feuilles de saule était connue pour aider à guérir les fièvres, limiter les maux de tête. Elle était mentionnée dans le papyrus égyptien découvert par Ebers. L'identification du principe actif, sa caractérisation et sa production rationnelle permettent d'avoir une préparation efficace d'un médicament dont l'activité ne dépend pas de la personne qui récolte les feuilles ni de la saison.
En 1853, Charles Gerhardt, brillant chimiste strasbourgeois (1816-1856), réussit la synthèse de l'acide acétylsalicylique et dépose un brevet. En vingt ans, il va aussi introduire en chimie la notion de fonction chimique utilisée pour classer les produits chimiques. Son décès prématuré plonge son travail dans l'oubli pendant de nombreuses années.
En 1897, Félix Hoffmann de la société Bayer reprend les travaux de Gerhardt et réalise la synthèse industrielle. La commercialisation de l'aspirine par Bayer débute en 1899. L'exportation de l'aspirine avant la première guerre mondiale a été le début florissant de cette société allemande. À l'occasion du traité de Versailles le gouvernement français a exigé que le brevet de l'aspirine passe dans le domaine public. Elle a ainsi été fabriquée à Lyon dans les usines du Rhône qui donneront naissance avec les usines Poulenc de Vitry à Rhône-Poulenc, société qui a largement contribué au développement de l'industrie pharmaceutique française au XXème siècle.
Au début du XIXème siècle, les chimistes sont capables d'identifier et de synthétiser des produits à partir de produits naturels. Au milieu du siècle, 1850-1860, l'association de la chimie des colorants à la chimie des produits naturels va conduire à la naissance de l'industrie pharmaceutique moderne.
Les trente dernières années du XIXème siècle vont voir l'épanouissement de la microbiologie qui fera le lien entre les bactéries pathogènes et les infections. Le microscope avec l'observation directe des micro-organismes permet de battre en brèche la théorie de la génération spontanée des microbes. Le développement conjoint de la microbiologie et de la chimie va permettre la création de merveilleux médicaments. La notion d'agent pathogène existait au début du XIXème siècle puisque Larrey, célèbre chirurgien des armées napoléoniennes, évitait les infections lors des amputations sur les champs de bataille en utilisant de l'alcool, du vinaigre, et un peu le fer rouge.
Louis Pasteur (1822-1895) et Robert Koch (1843-1910) sont les deux figures marquantes de la microbiologie en France et en Allemagne. En une trentaine d'année, ils vont permettre l'identification des agents pathogènes, virus ou bactéries, responsables des maladies suivantes : rage, peste, choléra, typhoïde, méningite, diphtérie, tuberculose, syphilis, tétanos, botulisme, lèpre, ...
La connaissance de l'agent pathogène va conduire à la mise en place de règles d'hygiène rationnelles et la mise au point de vaccins, d'antibactériens et d'antiviraux. Le respect des règles d'hygiène pasteurienne dans les salles d'accouchement a permis de diviser par trois à quatre la mortalité infantile.
Les premiers médicaments obtenus par synthèse chimique apparaissent avec l'essor de la chimie industrielle à la fin du XIXème siècle. Paul Erlich comprend qu'il est possible d'associer des petites molécules chimiques pour lutter contre un certain nombre d'agents pathogènes. Il s'intéresse aux dérivés de l'arsenic. Il crée le Salvarsan, le premier médicament qui lutte contre la maladie du sommeil.
Le premier antibactérien date de 1933. Gerhardt Domagk va tester des milliers de molécules de l'IG Farben entre 1927 et 1930 sur des streptocoques. Ce travail le conduit aux sulfamides, dont le dérivé azoïque le Prontosil, et aux acridines. Le premier sulfamide de l'histoire du médicament est une étape essentielle puisqu'il marque la découverte de la notion de métabolite actif et de la mise en évidence de son mécanisme d'action. Il comprend la notion de métabolite actif, le fait, qu'entre le produit qui est absorbé et le produit qui va agir sur sa cible pharmacologique, il y a une transformation par l'organisme. En 1935-1938, les époux Tréfouël de l'Institut Pasteur montrent que l'activité antibactérienne est permise par la coupure de la molécule au niveau d'une double liaison azote-azote qui donne une amine aromatique qui est le produit actif.
Plusieurs questions restaient encore en suspens : pourquoi une molécule a-t-elle une activité pharmacologique ? Quelle est sa cible ? Comment cette molécule interagit-elle avec la cible ? En 1940, Woods de l'université d'Oxford montre que le métabolite du Prontosil est un inhibiteur de la synthèse d'une enzyme, le tétrahydrofolate, qui est impliqué dans les transferts d'enchaînement en C1 dans des étapes de biosynthèse de la bactérie. Cette inhibition chez l'homme est compensée par l'apport d'acide folique par l'alimentation.
Pour développer des médicaments, il faut absolument comprendre comment la molécule ingérée va être transformée et quel est son mécanisme d'action.
La mise sur le marché américain du Prontosil conduit à un drame. La première formulation du médicament aux Etats-Unis va se faire avec de l'éthylène glycol ou antigel comme excipient, conduisant au décès de 76 personnes. Les autorités fédérales américaines réagissent immédiatement en créant la Food and Drug Administration (FDA) qui va édicter des règles strictes sur l'évaluation pré-clinique et clinique des futurs médicaments. Après un certain empirisme des bonnes pratiques sont mises en place et les procédures de fabrication bien plus encadrées au point de vue scientifique.
En 1930, Flemming identifie à partir d'un champignon un produit capable de tuer les bactéries, c'est la pénicilline. Il faudra attendre la deuxième guerre mondiale et l'effort de guerre des américains pour avoir une production industrielle de la pénicilline. Cette production en masse en 1942-1943 a nécessité la mobilisation de plus de mille scientifiques de très haut niveau pour résoudre les problèmes posés par la fermentation, l'extraction et la purification par des méthodes chimiques industrielles à très grande échelle. L'un des précurseurs chimiques de la pénicilline, le précurseur des céphalosporines est produit actuellement à raison de 45 000 tonnes par an dans d'immenses cuves de fermentation d'une dizaine de mètres cubes.
Pendant une centaine d'années, de la fin du XIXème jusqu'aux années 1980, les seuls outils thérapeutiques ont été les vaccins et des petites molécules. Pasteur a préparé son vaccin contre la rage à partir de la moelle épinière de lapins infectés. À sa suite, de grands succès sont obtenus par les vaccins dans la lutte contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la variole, les hépatites A et B, la grippe, ... Les petites molécules utilisées dans les centaines de nouveaux médicaments développés à cette période sont alors des produits naturels, le plus souvent extraits de végétaux, ou bien des produits de synthèse chimique. Les découvertes étaient quasi-routinières au cours du XXème siècle et l'espérance de vie a augmenté.
À partir de 1970, la biologie devient véritablement moléculaire. Des outils créés par les physiciens dans les années 1930-1940, comme la diffraction des rayons X sur nano-cristaux, la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de masse, sont utilisés par les chimistes pour étudier les petites molécules. Le perfectionnement de l'instrumentation va permettre d'utiliser ces techniques sur les macromolécules. Aux cours des années 1990-95, la facilité de résolution des structures d'enzymes est alors équivalente à celle d'une petite molécule chimique en 1970. Des milliers de structures de protéines ou d'acides nucléiques sont maintenant disponibles. La compréhension du vivant et la compréhension des produits chimiques deviennent équivalentes.
Il y a quarante ans, la découverte de la structure de l'hémoglobine a valu un prix Nobel à Max Perutz, de l'université de Cambridge. La structure de la pénicilline et de la vitamine B12 vaut un autre prix Nobel à Dorothy Hodgkin à Oxford, à peu près à la même époque. Maintenant, la publication de la structure d'une protéine se fait dans des journaux classiques et elle est directement archivée sur des banques de données. Les trente dernières années du XXème siècle ont vu une accélération extraordinaire de la connaissance moléculaire du domaine du vivant.
Les années 1965-1980 ont été celles de la découverte des outils pour étudier les gènes, notamment les enzymes de restrictions qui coupent les gènes et les ligases qui recollent les morceaux. De la compréhension du fonctionnement des gènes aux manipulations génétiques, il n'y a eu qu'un pas rapidement franchi. C'est le monde de la biotechnologie moderne où les choses ne sont plus laissées au hasard et où l'expérimentateur peut intervenir. Le séquençage des génomes, de l'homme comme des agents pathogènes, se systématise. La connaissance du génome des agents pathogènes, virus et bactéries, permet l'amélioration des outils de diagnostic et l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. La compréhension des maladies d'origine génétique ouvre la voie aux corrections des erreurs génétiques par la thérapie génique.
La connaissance du génome ouvre la voie à de nouvelles techniques. La génomique est l'accessibilité de la totalité de l'information génétique d'une espèce vivante. La protéomique est la possibilité d'exprimer toute protéine à partir du génome. La pharmacogénomique est la possibilité d'adapter un traitement thérapeutique selon le profil métabolique de chaque individu. Les connaissances sur la capacité des individus à métaboliser ou à ne pas métaboliser, sur leurs réactions vis-à-vis d'un médicament, permettent d'imaginer dans le futur de pouvoir adapter les posologies en fonction du patrimoine génétique de chacun. Quant à la robotique, elle permet à des mini-robots de paillasse de réaliser des milliers de molécules et d'essais biologiques in vitro. Ils atteignent rapidement leurs limites car ils produisent toujours les mêmes produits en utilisant les mêmes réactions avec une diversité structurale par trop limitée. De plus, les tests in vitro ne prennent pas en compte les problèmes de biodisponibilité, de pénétration et de passage de membrane.
Le rôle du chimiste dans l'innovation thérapeutique en ce début de XXIème siècle va être essentiel car il est formé et entraîné pour comprendre les choses au niveau moléculaire. Il pourra travailler avec des biochimistes, avec des spécialistes de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, de toxicologie, de pharmacologie, de médecine clinique. Les raisonnements en termes moléculaires font tomber les barrières de spécialités ( au singulier dans le sens de barrières liées à la spécialité / au pluriel mais alors écrire barrière des spécialités) mais le champ des connaissances nécessaires pour aller d'un domaine à l'autre dépasse souvent les capacités individuelles. Le chimiste moderne doit maîtriser la chimie de base et plusieurs domaines de la biologie. La biochimie est devenue une partie intégrante de la chimie, de même que l'enzymologie moléculaire. Les biologistes et les médecins doivent également avoir des bases élémentaires solides en chimie thérapeutique et en pharmacologie. Il faut des médecins qui restent au pied du malade en ayant cette capacité à discuter avec d'autres médecins qui sont impliqués dans la recherche clinique, à la recherche de médicaments. Les numerus clausus doivent être révisés régulièrement de manière intelligente pour éviter de créer des pénuries de médecins praticiens, s'il s'agit des cliniciens sinon chercher un synonyme à pratiquant qui renvoie à religion voire le supprimer.
Les chimistes créatifs vont continuer à être des acteurs clés dans l'industrie pharmaceutique du futur. Le « rational drug design » est le développement de la création rationnelle de nouveaux pharmacophores. La compréhension au niveau moléculaire du monde du vivant conduit à la création d'objets chimiques parfaitement adaptés à une utilisation en tant qu'outils thérapeutiques.
La chimie des produits naturels va continuer à se développer car la nature est une source d'inspiration de nouvelles structures de haute diversité.
La chimie théorique, avec des ordinateurs de plus en plus puissants et mieux utilisés, va permettre de faire des prédictions de l'interaction de molécules avec des systèmes biologiques et des sites pharmacologiques.
Selon les étapes de la création et de développement d'un médicament, différents métiers interviennent successivement : les chimistes et les biologistes sont les plus impliqués dans les phases de découverte pré-clinique alors que les médecins prennent le relais en phase clinique. Dès les premiers essais cliniques, les statisticiens ont un rôle primordial de prédiction du rapport bénéfice/risque afin d'éviter, par exemple, d'attendre le traitement de dizaines de milliers de personnes pour identifier d'éventuels effets secondaires néfastes.
La diversification des outils dans l'arsenal thérapeutique du XXIème siècle est une combinaison de réalité, d'espoirs et de rêves. Les macromolécules biologiques, traitées comme des objets chimiques, font maintenant partie, et prendront une part de plus en plus importante dans l'arsenal thérapeutique du futur. L'hormone de croissance, l'érythropoïétine capable de stimuler la production de globules rouges, sont produites par génie génétique.
Les thérapies génique et cellulaire sont encore du domaine de l'espoir. La thérapie génique est l'utilisation de gènes ou de molécules capables de modifier l'expression génétique pour traiter des maladies d'origine génétique. La thérapie cellulaire est l'utilisation de cellules souches pour réparer des dégâts au sein de tissus et d'organes.
Pour favoriser l'innovation thérapeutique, il faut favoriser la créativité dans tous les domaines. Il faut, à la fois, des chercheurs de très grande qualité en recherche fondamentale et des chercheurs de très grande qualité en recherche appliquée. La recherche fondamentale est indispensable pour le développement des recherches appliquées, mais, il arrive parfois que des résultats soient appliqués avant la compréhension complète des processus scientifiques sous-jacents. Chaque génération a sa proportion de talent et je souhaite que beaucoup s'intéressent à la fois à la chimie et à la thérapie et contribuent dans le futur à la création de médicaments de plus en plus efficaces et de plus en plus sûrs.
[1] Transcription réalisée par Juliette Roussel
[2] M. Madella et al, J. Archaeolog. Sci. 29, 703-719 (2002)
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DÉPRESSION |
|
|
| |
|
| |

DÉPRESSION
PLAN
* DÉPRESSION
* PSYCHIATRIE
* 1. La fréquence des dépressions
* 2. Les causes d'une dépression
* 3. Les symptômes et les signes d'une dépression
* 4. Évolution et traitement des dépressions
* 5. La dépression de l'enfant et de l'adolescent
* 5.1. Traitement
* 6. La dépression de la personne âgée
* 6.1. Traitement
* 7. Approche psychanalytique de la dépression
dépression
(bas latin depressio, -onis, enfoncement)
Cet article fait partie du dossier consacré au système nerveux.
État pathologique caractérisé par une humeur triste et douloureuse associée à une réduction de l'activité psychomotrice et à un désintérêt intellectuel.
PSYCHIATRIE
Dans son usage familier, le terme de dépression peut recouvrir des états très divers allant du simple « passage à vide » à des troubles psychiatriques plus sévères.
1. La fréquence des dépressions
La maladie dépressive est une des pathologies psychiques les plus fréquentes dans le monde. À l'échelle d'une vie entière, de 6 à 10 % des hommes et de 12 à 20 % des femmes seront, à un moment ou à un autre, confrontés à la dépression. C'est dire l'ampleur de ce phénomène qui peut aussi bien survenir après un événement traumatisant, comme un deuil, qu'à la ménopause, ou après un accouchement, ou sans raison ou situation particulière. Parfois, la dépression constitue l'un des deux temps d'une maladie maniacodépressive, alternance de moments d'excitation pathologique et d'épisodes dépressifs graves. Parfois encore, elle est liée à un manque d'ensoleillement (luminosité) et survient entre octobre et mars : c'est la « dépression saisonnière » (→ chronobiologie). Personne ne peut donc prétendre y échapper.
Les déprimés sont plus nombreux chez les femmes jeunes, les hommes âgés, les femmes célibataires et les hommes mariés. Si la dépression peut être favorisée par des événements de vie « négatifs » tels qu'une maladie physique ou la perte d'un emploi, elle peut l'être aussi par la consommation excessive de drogue ou d'alcool (→ toxicomanie), ainsi que par celle de médicaments psychotropes ou stimulants.
2. Les causes d'une dépression
De nombreuses dépressions apparaissent à la suite d'un événement pénible (deuil, abandon conjugal, licenciement, etc.) ou d'un moment particulier de l'existence (passage de l'enfance à l'adolescence, de l'âge mûr à la sénescence, échec ou même succès). De telles dépressions sont parfois désignées comme réactionnelles. Une dépression peut aussi survenir au cours d'une maladie physique (accident vasculaire cérébral, hépatite, etc.) , être déclenchée par un bouleversement hormonal (suite d'accouchement) ou un dérèglement endocrinien (hypothyroïdie). Dans certains cas, le syndrome dépressif apparaît en liaison avec l'évolution d'un trouble névrotique ou psychotique. Enfin, certaines dépressions très graves, comme la mélancolie (psychose caractérisée par une douleur morale intense avec désir de mort), ont une cause partiellement héréditaire : on parle dans ce cas de dépression endogène (maladie maniacodepressive).
Le taux élevé d'atteinte conjointe chez les vrais jumeaux (lorsque l'un d'eux connaît un épisode dépressif, l'autre, le plus souvent, souffrira aussi de dépression) plaide en faveur d'un facteur génétique dans le déterminisme de la maladie. Le décès du père ou de la mère pendant l'enfance, les antécédents familiaux de dépression ou de psychose maniacodépressive sont également considérés comme des facteurs prédisposants. Cependant, il n'existe aucune certitude, sauf en ce qui concerne la maladie maniacodépressive.
3. Les symptômes et les signes d'une dépression
Les traits spécifiques des troubles dépressifs sont à la fois psychiques et physiques. Ils atteignent leur maximum d'intensité en fin de nuit ou en début de journée. Au plan psychique, le sujet est d'humeur triste avec perte des motivations, d’intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités, insomnie ou hypersomnie, fatigue, autodépréciation, difficulté à penser et à se concentrer, peur de l'avenir, anxiété intense. La souffrance morale peut l'amener à envisager le suicide, d'autant plus que la sensation d'écoulement du temps semble anormalement ralentie. Les dépressifs ont en commun un sentiment inconscient de « perte d'objet » qui les amène à retourner contre eux-mêmes les reproches et l'agressivité destinés normalement à l'objet perdu, ce qui leur donne un fort sentiment de culpabilité et d'impuissance. Au plan physique, le dépressif souffre de troubles de l'appétit (avec perte ou gain de poids significatif → alimentation), de désordres digestifs, de céphalées, de palpitations, de fatigabilité, d'insomnie et d'altération de la libido. On note aussi parfois l’abus d’alcool, de médicaments ou de toxiques dans le but de soulager les symptômes.
Il existe de multiples formes de dépression, allant d’un sentiment de tristesse jusqu’à la dépression majeure avec idées délirantes nommée « mélancolie ». C’est avec le médecin que le type,de dépression sera défini et que le traitement adapté pourra être proposé. La « déprime » est un sentiment de malaise qui rend compte d’une tristesse passagère et pas toujours d’un état dépressif.
Reconnaître une dépression. Il est très délicat d'en identifier les premiers signes, souvent confondus avec ceux d'un banal passage à vide, baisse de forme qui disparaît d'elle-même en quelques jours. La dépression s'annonce par une modification globale, mais le plus souvent insidieuse, du comportement. Au début, le déprimé devient anxieux, réagit de manière inhabituelle à des contrariétés banales ; il est sujet à de brefs accès de colère, de joie ou de pleurs. Il a des difficultés pour trouver le sommeil puis se réveille en pleine nuit, généralement entre minuit et 2 heures du matin ; (chez certains, le sommeil est « haché » de rêves angoissants ou de réveils multiples). Enfin, il grossit ou maigrit involontairement. Il se désintéresse de son entourage familial, amical ou professionnel. Souvent, c'est seulement après plusieurs mois d'évolution, alors que le malade est en véritable situation de détresse morale, que l'entourage prend conscience de la gravité de son état. Cette « dépression confirmée » rassemble 4 types de troubles, toujours présents mais avec une intensité variable d'un malade à l'autre.
Troubles de l'humeur et ralentissement. Le déprimé souffre d'une immense tristesse permanente ; il est pessimiste et se sent dévalorisé, incapable, inutile. L'idée du suicide le taraude, comme étant la solution qui mettrait un terme à sa souffrance et libérerait son entourage. Dans bien des cas, le déprimé tente effectivement de mettre fin à ses jours ; cette tentative impose une protection immédiate et, le plus souvent, une hospitalisation. Le ralentissement des activités intervient à tous les niveaux, qu'il s'agisse du psychisme, de la motricité, du langage ou des relations. Le malade, figé, parle lentement, de façon monotone, et semble avoir perdu toute spontanéité ; lorsqu'on l'interroge, il réfléchit longuement avant de répondre. Il s'exprime lentement, ce qui met en évidence sa difficulté à se concentrer. Incapable d'agir et de prendre une décision, le déprimé retrouve un semblant d'énergie en fin de journée, qu'il met à profit, par exemple, pour réaliser de simples actes de la vie quotidienne (comme se raser), tant cela lui est difficile le matin.
Anxiété, troubles du sommeil et de l'état physique. Le malade est perpétuellement inquiet, préoccupé par des sujets personnels ou plus généraux. Ses insomnies s'aggravent et il se réveille fréquemment pendant la deuxième partie de la nuit ou avant le lever du jour ; c'est d'ailleurs pendant cette dernière période que se concentrent les idées dépressives qui favorisent les « suicides du petit matin ». L'altération de l'état physique dépend de l'ancienneté de la dépression et de son évolution, mais aussi du sexe et de l'âge, de la négligence plus ou moins grande du régime alimentaire. Plus spécifiquement, le déprimé souffre de troubles du transit digestif, de maux de tête, d'une grande fatigue et d'un désintérêt pour l'activité sexuelle.
4. Évolution et traitement des dépressions
Le risque majeur de la dépression est le suicide, surtout à redouter dans les formes mélancoliques, les phases aiguës des troubles psychotiques et chez les personnes âgées. Il faut aussi redouter les complications évolutives d’un etat dépressif caracterisé, les symptômes residuels, voire une certaine chronicité. Outre un traitement par les antidépresseurs ou les stabilisateurs de l'humeur, qui ont considérablement réduit l'usage de l'électrochoc (sismothérapie), on préconise souvent un abord psychothérapique et parfois une approche familiale.
Vaincre une dépression en quelques mois est le plus souvent possible, et un traitement médical doit toujours être tenté. Non soigné, un épisode dépressif est beaucoup plus long à disparaître, le risque d’évolution au long cours n’étant pas négligeable, la possibilité de symptômes résiduels importante. Il expose en outre le patient à des souffrances inutiles, voire au suicide, alors que le déprimé mis sous traitement peut voir son état s'améliorer dès la 2e semaine. De plus, traiter une dépression permet souvent d'éviter les récidives, beaucoup plus difficiles à soigner. C'est ici qu'intervient le rôle primordial de l'entourage, qui doit engager le malade à se soigner, même si cela n'est pas toujours facile. Un premier entretien médical permet au praticien d'évaluer l'intensité et le type de la dépression, d'établir une relation de confiance avec le malade, de l'informer de son état et des perspectives thérapeutiques, y compris de la nécessité d'une hospitalisation.
Le traitement psychologique. Il s'agit le plus souvent d'une psychothérapie de soutien, nécessaire dans la première phase de la maladie, alors que le patient a tendance à s'isoler et à perdre confiance en lui. Ce traitement consiste en entretiens centrés sur les événements qui ont contribué à l'installation de la dépression. Les thérapies cognitivo-comportementales (T.C.C.) sont très efficaces. Le médecin doit se montrer attentif, prodiguer conseils et orientations. Une fois dépassée la phase aiguë, ces entretiens débouchent éventuellement sur la nécessité de faire un travail plus approfondi, faisant intervenir l'inconscient (psychothérapie longue, voire psychanalyse). Le choix de la psychothérapie dépend de la personnalité, du contexte, des symptômes, de la disponibilité de l’entourage et de l’avis du patient.
Les médicaments psychotropes. Dans le traitement de la dépression, l'année 1957 a marqué une étape décisive : c'est alors que l'on découvre les effets antidépresseurs de l'iproniazide – qui inhibe l'action biologique d'une enzyme, la monoamine oxydase, d'où son sigle (I.M.A.O.) – et d'un autre produit, l'imipramine ; celle-ci sera dite « tricyclique » en raison de sa structure chimique. Depuis, d'autres substances (antidépresseurs d'action sérotoninergique ou mixte : sérotoninergique et noradrénergique) sont venues compléter cette gamme. Aujourd'hui, le traitement d'un déprimé passe le plus souvent par ces médicaments, efficaces dans deux tiers des cas. Les antidépresseurs tricycliques ont une action antidépressive puissante et n'induisent aucune accoutumance mais s'accompagnent d'effets secondaires tels que sécheresse de la bouche, tremblements, vertiges, prise de poids, palpitations, constipation. Aux I.M.A.O., également très actifs mais délicats à manier – leur association avec l'alcool, en particulier, doit être rigoureusement prohibée –, on préfère actuellement des produits, appelés I.M.A.O. réversibles, au mécanisme d'action similaire mais dépourvus de tels risques. Les thymorégulateurs ou stabilisateurs de l'humeur sont parfois utilisés (lithium, carbamazépine, valproate). Quel que soit le traitement choisi, il est poursuivi pendant au moins 6 mois puis progressivement diminué sous surveillance médicale. Dans certaines formes de la maladie ou en cas d'efficacité insuffisante des antidépresseurs, on peut également être amené à préconiser des séances de privation de sommeil, qui améliorent l'humeur du malade, voire d'exposition à la lumière (dans le cas des dépressions saisonnières). Pour traiter plus spécifiquement certains symptômes de la dépression, comme l'angoisse et les troubles du sommeil, on prescrit également, dans certains cas, des tranquillisants ou des somnifères pour une courte période. Quand la dépression s'inscrit dans l'évolution d'une maladie maniacodépressive, un traitement régulateur de l'humeur est nécessaire, le plus souvent à vie.
Le mécanisme d'action des antidépresseurs. Les travaux scientifiques s'appuient sur l'hypothèse selon laquelle les neurotransmetteurs, molécules dont le rôle est de transmettre les informations entre les cellules nerveuses (neurones), jouent un rôle important dans le déclenchement des dépressions mais aussi dans leur traitement. En effet, les antidépresseurs ont en commun de maintenir un taux élevé de neurotransmetteurs dans le système nerveux en empêchant leur destruction physiologique. Les antidépresseurs tricycliques agissent globalement sur la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine ; les antidépresseurs sérotoninergiques, plus électivement sur la sérotonine ; les antidépresseurs mixtes sur la sérotonine et la noradrénaline. Les I.M.A.O. freinent l'activité de la M.A.O., enzyme de dégradation de la dopamine et de la noradrénaline. La sismothérapie modifie aussi le métabolisme des neuromédiateurs.
L'électronarcose. Lorsque la dépression est grave – on parle alors de mélancolie – et que les autres traitements se révèlent inefficaces, on recourt encore à l'électronarcose, une technique qui a remplacé l'électrochoc. L'électronarcose est réalisée sous anesthésie et sous relaxant musculaire, afin de soulager l'appréhension du malade et d'éviter les complications. Elle permet, à raison de 6 à 8 séances, de guérir certaines dépressions résistant à tout autre traitement. La sismothérapie (traitement par les électrochocs) n’entraîne pas d’effets secondaires durables.
Traitements originaux. Maintenir strictement éveillé un malade déprimé pendant toute une nuit ou pendant une partie de la nuit (en général à partir de 2 heures du matin), un jour sur deux, permet d'améliorer notablement son état dépressif. Le mécanisme d'action de cette technique reste partiellement mystérieux, et serait dû à une modification des rythmes biologiques. Autre technique, la photothérapie, qui s'adresse le plus souvent aux patients atteints de dépression saisonnière, consiste à installer le patient pendant une ou deux heures par jour devant une lampe censée reproduire le spectre de la lumière solaire. La physiothérapie (douches, massages subaquatiques, natation), réalisée avec la collaboration d'un kinésithérapeute ou d'une infirmière spécialisée, peut également être très bénéfique.
Aider un dépressif. C'est aussi à l'entourage d'engager le malade à prendre conscience de son état et à se soigner. En effet, l'une des caractéristiques de la dépression est d'être difficile à identifier, surtout quand le malade se plaint essentiellement de troubles physiques, d'où le qualificatif de dépression « masquée » : il a le plus grand mal à prendre lui-même conscience de son état, est réticent à l'idée d'aller voir un médecin ou un psychiatre et se culpabilise pour expliquer ses troubles. L'engager à rencontrer le médecin de famille est alors la meilleure solution. Le recours à une association d'usagers est souvent une aide précieuse. En revanche, demander au malade de faire preuve de bonne volonté, de se changer les idées en prenant des vacances, etc. va à contresens de la guérison.
5. La dépression de l'enfant et de l'adolescent
La dépression de l'adolescent, tout en se rapprochant de celle de l'adulte (anxiété, sentiment d'infériorité, humeur triste), en diffère par une moindre inhibition, une attitude plus distante qu'accablée, un sentiment de vide ou d'abandon plutôt que de déchéance. Par ailleurs, un état dépressif peut se cacher sous des symptômes trompeurs (dépression masquée) : troubles du comportement (fugue, colère, goût morbide pour le risque), anorexie, boulimie ; l'adolescent se plaint de douleurs (courbatures, maux de tête, d'estomac), a des problèmes scolaires. La principale complication des dépressions d'adolescent est le passage à l'acte (délinquance, toxicomanie, suicide).
5.1. Traitement
Il ne saurait se limiter à l'administration de psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques), qui risquent de provoquer une dépendance et des passages à l’acte, et dont l’utilisation doit être la moins fréquente possible, réfléchie et de courte durée. Dans la plupart des cas, la psychothérapie apportera à l'adolescent ce qu'il recherche, l'aidant efficacement à mûrir et à mieux s'accepter. L’abord familial est indispensable.
6. La dépression de la personne âgée
La dépression de la personne âgée revêt des formes très diverses. La forme la plus grave en est la mélancolie, qui se traduit par une douleur morale intense avec idées de préjudice et de persécution, une hypocondrie (peur non justifiée d'être malade), une détérioration de l'état général. D'autres formes se manifestent par de l'insomnie, des troubles du caractère, un repli sur soi, des affections psychosomatiques diverses, parfois une pseudodétérioration intellectuelle pouvant simuler une démence (dépression pseudodémentielle).
6.1. Traitement
Il faut d’abord bien comprendre de quel type de dépression il s’agit, évaluer les possibilités de réaction, repérer les possibles pathologies médicales en cours d’évolution. La prescription de psychotropes doit être régulièrement réévaluée, les effets secondaires mesurés périodiquement en fonction de la symptomatologie mais aussi en fonction de la vie quotidienne de la personne malade. Les antidépresseurs sont privilégiés, les anxiolytiques et les hypnotiques indiqués avec prudence pour une brève période. La sismotherapie est parfois utile et demeure sans danger. Enfin, l’écoute médicale est indispensable (maintien du statut social, retour de l’anticipation, stabilité de l’état physique).
7. Approche psychanalytique de la dépression
La psychanalyse aborde la dépression sous plusieurs aspects : la mélancolie (Freud et Abraham), le deuil (Freud), et la position dépressive (Melanie Klein). L'axe commun à ces trois abords de la dépression est la notion de perte : perte de l'objet dans le deuil, et la position dépressive, perte du moi dans la mélancolie.
Dans le deuil, l'objet perdu est repérable. Qu'il s'agisse d'un être cher, d'un projet ou d'un idéal, cet objet entre dans le registre du symbolique et peut être mis à distance puis remplacé en tant que pôle d'investissement. La dépression est alors transitoire et dure le temps nécessaire à ce « travail de deuil ». En revanche, la mélancolie est le deuil impossible d'un objet imaginaire. Elle renvoie à une défaillance beaucoup plus ancienne qui se situe dans une phase pré-œdipienne. À propos de la mélancolie, Freud évoque l'image d'une « hémorragie interne de la libido » qui ne cesserait de s'écouler par un trou, une sorte de béance, un évidement du moi. En 1924, il classe la mélancolie parmi les névroses narcissiques. C'est une régression qui entraîne un désinvestissement général du monde extérieur et un état de prostration. L'originalité de la conception freudienne et abrahamienne de la mélancolie est l'hypothèse d'une introjection de l'objet perdu qui se confondrait avec le moi. Les autoreproches et l'autodépréciation du mélancolique s'adresseraient en fait à l'objet perdu qui aurait pris toute la place du moi. Le suicide représenterait alors l'ultime tentative pour se débarrasser de cet objet. Tandis que le dépressif maintient avec autrui une relation affective qui s'exprime par la plainte et l'agressivité, le mélancolique est entièrement tourné vers la mort.
Si Freud et Abraham situent la dépression-mélancolie du côté des névroses narcissiques (c'est-à-dire des psychoses), Melanie Klein fait de la position dépressive une phase normale du développement psychique de l'enfant. Située après la phase schizo-paranoïde au cours de laquelle l'enfant fait l'expérience du « bon » et du « mauvais » objet sans savoir encore qu'il s'agit des deux aspects du même objet, l'angoisse dépressive surgit au moment où il fait la synthèse entre ces deux aspects, entre ses sentiments d'amour et de haine. La haine et les fantasmes destructeurs engendrent une crainte de perdre l'objet d'amour (la mère), et une culpabilité face aux pulsions destructrices dirigées contre cet objet. L'introjection de la mère comme objet total, à la fois bon et mauvais, fait donc naître la position dépressive qui remplace l'angoisse de persécution de la phase schizo-paranoïde. La culpabilité génère alors un besoin de réparation caractéristique de la position dépressive. Il s'agit d'un deuil précoce et positif qui montre que l'enfant a élaboré la mère comme objet total séparé de lui et acquis la capacité de réparation qui lui permet de reconstruire son monde intérieur. La position dépressive sera réactivée durant toute la vie chaque fois qu'un chagrin surviendra. Si l'enfant ne l'a pas bien négociée, cette défaillance constituera le point d'ancrage possible de la mélancolie ou de la psychose maniaco-dépressive.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
