|
|
|
|
 |
|
PERSPECTIVE |
|
|
| |
|
| |
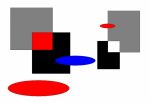
perspective
Consulter aussi dans le dictionnaire : perspective
Cet article fait partie du dossier consacré à l'art.
Art, technique de la représentation en deux dimensions, sur une surface plane, des objets en trois dimensions tels qu'ils apparaissent vus à une certaine distance et dans une position donnée.
MATHÉMATIQUES
Dans l'espace affine euclidien, on distingue deux cas.
1° Le pôle, appelé point de vue, est à l'infini. C'est le cas le plus fréquent dans les manuels pour les figures de géométrie dans l'espace, le plan qui les contient étant d'ordinaire appelé tableau.
2° Le pôle est à distance finie. Les droites parallèles convergent vers un même point du tableau (point de fuite), et les propriétés métriques et affines sont altérées.
BEAUX-ARTS, DESSIN ET PERSPECTIVE
Tout au long de l'histoire de l'art, peintres et dessinateurs ont tenté de représenter leur perception de l'espace et, donc, de donner l’illusion d’une troisième dimension sur un support à deux dimensions.
PREMIÈRES TENTATIVES
Chaque période, depuis la plus haute antiquité, possède sa propre méthode d'organisation spatiale. La peinture de l’Égypte antique propose des bandes superposées et la peinture romaine des raccourcis et des architectures illusionnistes, tandis qu’en Inde un espace éclaté et métaphysique est figuré sur les parois des grottes d'Ajanta ou qu’en Chine certaines compositions proposent des perspectives à vol d'oiseau dans lesquelles l'observateur est situé très haut par rapport au paysage représenté. Tous ces procédés montrent comme il est difficile de rendre la troisième dimension de la réalité physique.
LA PERSPECTIVE AU MOYEN ÂGE
Le monde médiéval, pour sa part, utilise fréquemment la solution orientale de la perspective dite « inversée ». Dans ce système de figuration, les lignes, en s'éloignant de l'œil, divergent au lieu de converger. Objets et figures secondaires ne rapetissent pas par rapport à l'œil du spectateur, mais en fonction du personnage central de la composition. Celui-ci est une figure religieuse vénérée et c'est sa vision, donc sa perspective qui importe et non celle de la personne qui contemple. Dans la peinture médiévale se rencontre également, hérité de l'Antiquité, le système à plusieurs points de fuite, formule qui sera encore longtemps utilisée par la suite.
LA RENAISSANCE
La Renaissance engendre un nouvel humanisme. À l'ordre divin succède un ordre terrestre où l'homme devint la mesure de toutes choses. L'apparition de la perspective géométrique linéaire, « classique » ou centrale – tentative anthropocentrique de prendre possession de l'espace – est probablement plus d'ordre spirituel que scientifique.
LA PERSPECTIVE CLASSIQUE
Cette solution rationnelle, qui s'accordera à l'esthétique classique et se révélera l'une des plus satisfaisantes pour l'esprit moderne, s'organise à partir de l'œil du spectateur. Celui-ci est placé en un point fixe, nommé point de vue, ou centre de projection. Il contemple des objets ou des figures situés sur une surface où l'illusion de la profondeur est donnée par la diminution de la taille des objets et la convergence de lignes qui vont en se rapprochant (elles sont parallèles dans la nature) pour se rejoindre en un point de fuite situé sur la ligne d'horizon. Avec cette formule, les êtres et les choses se situent dans un espace qui se veut comparable à l'espace réel tel qu'il se présente à un observateur.
VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE
Le regard du spectateur peut être figuré par une pyramide, dite pyramide visuelle. La base de cette pyramide correspond, pour le dessinateur ou le spectateur, au plan figuratif, c'est-à-dire au dessin ou au tableau ; sa hauteur, ligne virtuelle issue du sommet, c'est-à-dire du point de vue, est dite rayon visuel principal. La ligne horizontale, virtuelle également, qui est perpendiculaire au rayon visuel sur le tableau, est la ligne d'horizon. Le point de vue et le rayon visuel principal déterminent la localisation sur la ligne d'horizon du point de fuite principal et des points de distance. Le bord inférieur du tableau est dit ligne de terre. Lorsque le point de vue est situé à une distance finie du tableau, la perspective est dite centrale. Dans le cas où il est rejeté à l'infini, on parle de perspective cavalière.
CONCRÉTISATION DANS LES ARTS
À Florence, au début du Quattrocento (1417 environ), Brunelleschi invente un appareil optique (connu par un texte de Vasari) qui ouvre la voie à une nouvelle représentation du monde codifiée par le De pictura d'Alberti (1436). C'est Masaccio qui, parmi les premiers, utilise cette nouvelle vision dans la fresque de la Trinité (vers 1427, église Sainte-Marie-Nouvelle, Florence).
DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS
La perspective classique l'emporte durant quatre siècles dans la peinture occidentale, jusqu'à ce que, ébranlée par les impressionnistes à la fin du xixe s., puis déformée par Cézanne, elle ne régisse plus que de loin la représentation figurative et débouche, dans l'art moderne, sur le problème plus général du sentiment de l'espace, nié ou recherché.
Au cours de l’histoire la question de la perspective inspire des ouvrages à de nombreuses personnalités parmi lesquelles on peut citer Piero della Francesca, Léonard de Vinci, Dürer, Serlio, Vignole ou encore Panofsky.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ALEXANDRIE |
|
|
| |
|
| |
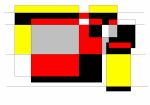
Alexandrie
en arabe al-Iskandariyya
DOCUMENT larousse.fr LIEN
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Égypte ancienne.
Principal port et deuxième ville d'Égypte. Population pour l'agglomération : 4 400 104 hab. (estimation pour 2010)
Carrefour routier et ferroviaire, centre commercial et financier, industriel (textile, mécanique, chimie) et culturel (université ; bibliothèque [Bibliotheca Alexandrina, 2002, héritière symbolique de la bibliothèque antique]).
L'HISTOIRE D'ALEXANDRIE
LA CRÉATION DE LA VILLE ANTIQUE
Plusieurs villes, fondées par Alexandre le Grand au cours de ses campagnes militaires en Asie et en Égypte, portaient le nom d'Alexandrie. Mais la plus célèbre et la plus importante est Alexandrie la Grande, ou l'Égyptienne. L'emplacement de ce petit port méditerranéen, qui était fréquenté par les Phéniciens et qui avait été un lieu de garnison à l'époque pharaonique, séduisit Alexandre, car ses deux entrées naturelles formées par la proximité de l'île de Pharos, étaient idéales pour les manœuvres des embarcations grecques. Bâtie en 332 avant J.-C. ou, d'après certaines sources, à son retour de l'oasis d'Amon en 331 avant J.-C, elle était destinée à abriter les autochtones, la garde macédonienne, quelques immigrés grecs, ainsi qu'une minorité juive.
Il n'y avait à l’origine sur le site choisi qu'une pauvre bourgade, Rhakotis. À proximité, les marais du delta étaient habités par les Boukoloï, population de bergers farouches, auxquels se mêlaient tous les brigands de l'Égypte. Sur place, un sol pierreux, salin, ingrat, dépourvu d'eaux potables. Il fallait donc compter sur des citernes (il s'en construisit beaucoup) et accessoirement sur l'eau du lac Mariout. Entre la mer et ce lac, Alexandrie pouvait être la porte et le bastion de défense de l'Égypte, mais en demeurant à l'écart de la vallée du Nil ; il était entendu qu'elle se juxtaposait à l'Égypte, sans s'y intégrer : Alexandrea ad Ægyptum, Alexandrie près de l'Égypte. Favorisée par sa situation géographique et par la construction astucieuse de son port, Alexandrie devint rapidement un centre économique et une ville maritime des plus renommées de l'Antiquité. Mais aussi éclatante fut sa grandeur, aussi perturbée et aventureuse fut sa longue existence.
ALEXANDRIE CAPITALE DE L'ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE : L’ÂGE D’OR
De 331 à 31 avant J.-C., Alexandrie fut la capitale d'un royaume gréco-égyptien. Durant son premier siècle d'existence et sous le règne des trois premiers Ptolémées, elle connut la gloire la plus resplendissante. Les maîtres de l'Égypte se plurent à orner la ville de la splendeur de l'art hellénistique, expression d'un monde en évolution. Ptolémée Ier, lieutenant d'Alexandre le Grand, dont il suivit fidèlement les principes de tolérance, sut se concilier la sympathie de ses sujets. Respectueux des institutions civiles et politiques, et des croyances et religions locales, il administra l'Égypte dans un climat de paix interne. Grâce à lui Alexandrie devint une capitale exemplaire; il fit construire des temples, des palais majestueux et le fameux phare d'Alexandrie, (Pharos) connu comme l'une des Sept Merveilles du monde et dont des vestiges significatifs ont été mis au jour lors de fouilles sous-marines en 1995. La ville devint également un centre culturel important où se rencontraient de nombreux savants et artistes, protégés et subventionnés par le souverain. La bibliothèque d'Alexandrie, qui réunissait plus de 700 000 manuscrits, fut célèbre de tous temps. Elle fut incendiée lors de la révolte de la ville contre César (guerre d'Alexandrie, 48-47 avant J.-C.). À la mort de Ptolémée Ier, surnommé le Sauveur, son fils lui succéda. Se gardant d'entraîner l'Égypte dans les conflits qui mettaient alors à feu et à sang les royaumes voisins, il se contenta de suivre avec ardeur la politique entreprise par son père. Ami des arts et des sciences, il s'entoura de nombreux poètes et savants, parmi lesquels s'illustrèrent Théocrite et Callimaque. Avec la mort de Ptolémée III Évergète, fidèle à la politique de ses prédécesseurs, prend fin l'âge d'or d'Alexandrie.
ALEXANDRIE SOUS LES ROIS LAGIDES
Alexandrie était le lieu de résidence du roi lagide, dont le palais se trouvait à proximité du Grand Port. La Cour gravitait autour du souverain. L'administration propre de la ville pouvait être définie comme un ensemble de corporations (politeumata) correspondant aux différentes nationalités d'origine, celle des Grecs, appelés aussi citoyens ou tout simplement Alexandrins, étant de beaucoup la plus forte. Au sommet, des représentants du roi : gouverneur, préfet de police, exégète et ethnarque, veillaient à la police, à l'approvisionnement et à l'administration en général.
Cette coexistence des puissants et de la population explique la plupart des troubles qui perturbèrent la vie urbaine. Ces troubles étaient dus d'abord aux autochtones égyptiens, difficiles à gouverner, ensuite aux mercenaires, nombreux et indisciplinés (Alexandrie était la principale ville de garnison), enfin aux Alexandrins eux-mêmes. Il n'y eut pas de révolutions organisées, mais des soulèvements de caractère spontané, provoqués par la politique royale ou les problèmes dynastiques (en 203, 170, 165, 136-135, 80 avant J.-C.). De leur côté, les maîtres ne s'étaient pas privés de provoquer le peuple, surtout Ptolémée VII, qui connaissait l'hostilité de beaucoup d'Alexandrins à son égard.
LES JUIFS D’ALEXANDRIE
Flavius Josèphe estimait le nombre des Juifs d'Alexandrie à 100 000. Ils habitaient surtout le quartier dit du « Delta », à l'est des ports et du palais, mais ne s'y confinaient pas. Ils étaient établis de longue date en Égypte, où ils étaient venus en qualité de mercenaires ou de rescapés de l'exil de Babylone. Alexandre leur aurait donné toute licence de profiter de sa fondation nouvelle. Ptolémée Ier avait ramené beaucoup de prisonniers juifs, qui vécurent là comme soldats ou comme esclaves. Ces derniers s'affranchirent vite et tous prospérèrent dans le cadre de leur communauté, dirigée par un ethnarque assisté d'un conseil.
À la jalousie des Grecs s'ajoutèrent les effets d'une tradition d'antisémitisme déjà ancienne dans les milieux égyptiens cultivés. Enfin, ce qui ne détendit pas l'atmosphère, les Juifs furent mêlés aux affaires dynastiques, quand, mal vu des Alexandrins, Ptolémée VI fit appel à un contingent juif pour lutter contre Ptolémée VII, lequel se vengea par la suite.
Il existe des traces de l'activité intellectuelle des Juifs alexandrins. Un certain Aristée, repris par Flavius Josèphe, avait décrit le studieux travail des Juifs hellénisés. C'est dans leur milieu que fut rédigée la traduction grecque de l'Ancien Testament connue sous le nom de version des Septante, et qui mettait les livres sacrés des Hébreux à la portée de ceux qui ne lisaient plus que le grec. Dans les synagogues alexandrines, on priait en grec. Hellénisés à ce point, les Juifs avaient été en mesure de fournir à la monarchie de hauts fonctionnaires, issus de familles parfois très riches, comme celle du philosophe Philon.
ALEXANDRIE ROMAINE
CÉSAR ET LA GUERRE D'ALEXANDRIE
César débarqua à Alexandrie en octobre 48 avant J.-C., juste avant l'assassinat de Pompée. La foule et les soldats de Ptolémée manifestèrent vivement contre lui, et des soldats romains furent assassinés les jours suivants. César dut se retrancher dans le quartier du palais ; il réussit à brûler la flotte égyptienne et les arsenaux ; le feu se communiqua à la bibliothèque. Il vainquit la flotte des Alexandrins, mais il dut un peu plus tard s'enfuir à la nage de son vaisseau qui chavirait. Deux mois plus tard, il sortait d'Alexandrie pour rejoindre son allié Mithridate, débarqué à Péluse, et rentrait victorieusement dans la ville, en mars 47 avant J.-C. Il regagna Rome à une date controversée, mais vraisemblablement en septembre 47 avant J.-C. Cette guerre a été racontée dans un Bellum Alexandrinum, d'un auteur contemporain.
LA VILLE SOUS L’EMPIRE ROMAIN
Sous l'Empire romain, l'essentiel de la machine gouvernementale demeura dans la ville, devenue résidence du préfet d'Égypte, de l'idiologue (intendant du domaine impérial), de l'alabarque (directeur des impôts indirects) et de quelques procurateurs impériaux. On peut essayer d'estimer la population à l'époque impériale à partir de l'affirmation de Diodore de Sicile, qui donnait à Alexandrie 300 000 habitants libres. C'était la seconde ville de l'Empire. Les empereurs s'attachèrent à l'embellir et à y laisser les marques de leur gloire ou de leur vénération envers les dieux. Auguste bâtit la ville satellite de Nikopolis, ou Juliopolis, avec les bâtiments nécessaires aux jeux quinquennaux institués en souvenir de sa victoire sur Antoine. En l'honneur de l’empereur Dioclétien, un préfet d'Égypte érigea une colonne, longtemps appelée colonne de Pompée, et qui se trouvait dans l'enceinte du Serapeum. À l'époque impériale furent encore érigés quelques nouveaux sanctuaires, dont celui de Mithra, des bains publics, dont les noms ont été conservés par les textes, et des lieux consacrés aux spectacles. Les spectacles, effectivement, ne manquaient pas. Les larges boulevards se prêtaient aux parades à l'occasion de la venue de l'empereur comme aux processions religieuses. Les athlètes alexandrins étaient nombreux et réputés. Alexandrie aurait même été la première ville gréco-orientale à avoir un cirque.
UNE VASTE BOUTIQUE
« Alexandrie tout entière n'est qu'une vaste boutique », disait Grégoire de Nazianze. On imagine quelque chose d'analogue aux souks de l'époque arabe : des rues entières d'artisans boutiquiers se consacrant à diverses spécialités. Le travail du verre produisait des vases ornés, souvent dorés, qui avaient un grand succès dans le monde. La poterie de fabrication locale est plus modeste : ce sont surtout des vases à dessin sur fond clair, blanc ou crème, à usage funéraire, les hydries dites de Hadra, du nom d'une nécropole. La toreutique et la bijouterie ont également produit des œuvres remarquables. Autre spécialité alexandrine, les tissus de qualité, brochés, damassés ou brodés, y compris ceux qui étaient à décor de style barbare destinés à l'exportation lointaine. On tissait aussi un lin de très fine qualité, le byssos. Les produits de parfumerie et de pharmacie constituaient l'objet d'une industrie importante, très organisée, qui traitait les plantes du Delta aussi bien que les produits d'Arabie. La valeur des produits manipulés entraînait un exceptionnel luxe de précautions contre les vols dans les officines. Une partie était exportée, mais la pratique égyptienne de l'embaumement et les goûts des Alexandrins en absorbaient la plus grande part.
L'activité n'était pas moins grande du côté des ports. De grands chantiers navals construisaient ou réparaient les bateaux, en utilisant le bois importé de Phénicie ou d'Asie Mineure. Ptolémée IV y avait fait construire un navire royal très somptueux et un gigantesque vaisseau à quarante rangs de rames. Dans le même secteur, en bordure des ports, se trouvaient les magasins, et surtout les silos, où s'entassait le blé d'Égypte, véritable monnaie d'échange à l'époque lagide et produit essentiel d'exportation vers Rome à l'époque impériale. Les exportations comportaient en outre le papyrus et les produits du désert et de l'Orient, marbres, pierres précieuses, épices. Les importations consistaient en huile et vin, d'ailleurs lourdement taxés sous les Ptolémées.
UNE FOULE TURBULENTE
Néron
Sous la tutelle étroite de Rome, Alexandrie paraissait devoir retrouver un certain calme. Les empereurs, qui connaissaient les foules, se méfiaient : la ville fut relativement isolée, n'ayant plus de gouvernement direct sur l'Égypte et étant devenue grenier privé de l'Empire. Il y eut cependant quelques épisodes d'une rare violence.
Sous Néron, en 66, une bataille éclata à l'amphithéâtre, et, à titre répressif, les soldats firent un vrai carnage dans le quartier juif. Sous Trajan, de 115 à 117, les Juifs manifestèrent par leur révolte leur participation à l'agitation qui ébranlait leurs rangs dans tout l'Orient : ce fut l'origine d'une guerre sans merci qui nécessita l'appel à des troupes extérieures à l'Égypte, et entraîna destructions, confiscations de biens, exécutions. Les Juifs furent alors parqués dans leur ghetto du Delta.
En 215, Caracalla vint à Alexandrie, où il fut accueilli avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec des plaisanteries qu'il n'apprécia pas, et en tira une vengeance froidement calculée : il prit un prétexte pour réunir la jeunesse et la fit massacrer.
En 273, l'empereur Aurélien vint mettre fin à la révolte du Grec Firmus, qui s'était donné les droits d'un souverain. Le quartier du Brouchion, où ses fidèles s'étaient repliés, fut dévasté.
En 296, après huit mois de siège, Dioclétien entra dans Alexandrie, où un nommé Achilleus s'était proclamé empereur. La ville souffrit, tant pendant le siège que lors de la répression qui suivit. Mais une page était tournée : les chrétiens se haussaient désormais au premier plan de l'actualité.
ALEXANDRIE DANS L'EMPIRE BYZANTIN
De 326 à 641, Alexandrie passe sous le contrôle de l'Empire byzantin. L'installation d'un empire chrétien à Byzance, héritier de l'Empire romain d'Orient consacra Alexandrie comme capitale de la chrétienté, aux côtés de Constantinople et d'Antioche.
ALEXANDRIE CHRÉTIENNE
L'Église d'Alexandrie est, à n'en pas douter, des plus anciennes, bien que soit légendaire la tradition qui attribue sa fondation à l'apôtre saint Marc. Les chrétiens ne font parler d'eux qu'à dater de la persécution de Septime Sévère, en 202. La persécution de Decius fut terrible, celle de Dioclétien incita les Alexandrins à faire partir de son avènement l'ère dite des martyrs, expression qui fut utilisée aux ve et vie s. Les derniers martyrs datent du temps de Maximin Daïa. Ensuite, le nombre des chrétiens se multiplia, tandis que le paganisme conservait des défenseurs acharnés dans les milieux intellectuels et des alliés chez les Juifs. La fermeture des temples païens et la destruction du Serapeum en 391, les combats avec les Juifs et la lapidation de la philosophe Hypatie en 415 marquèrent les luttes entre païens et chrétiens.
L'Église avait depuis longtemps des structures bien établies. Un patriarcat avait été fondé. Dès 362, un concile alexandrin avait promulgué des décisions qui complétaient celles de Nicée. La cathédrale fut construite sur ce qui restait du Cesareum.
La ville avait conservé sa qualité de foyer intellectuel : jusque sous Justinien subsistèrent des écoles païennes (en particulier l'école philosophique néo-platonicienne), et l'aptitude aux discussions théologiques créait un climat favorable à la naissance des hérésies. L'hérésie d'Arius y fut brillamment et ardemment combattue par l'éminent patriarche que fut saint Athanase (328-373). Aux ve et vie s., le monophysisme, qui avait la faveur des coptes, fut à l'origine de désordres sérieux. Lieu d'élection de cette hérésie, Alexandrie fut privée de son patriarche Théodose, exilé et remplacé par Paul, moine orthodoxe et autoritaire (538). Ce qui n'empêcha pas les monophysites de revenir en force. En 633, l'empereur Héraclius avait cru rétablir la paix religieuse : en réalité, les monophysites, persécutés, croyaient voir l'Antéchrist en la personne du patriarche Cyrus.
Pour en savoir plus, voir l'article Empire byzantin : histoire.
ALEXANDRIE, VILLE ARABE, VÉNITIENNE, PUIS OTTOMANE
Occupée par les Perses (616), elle fut ensuite conquise par les Arabes (641-642), installés à Péluse dès 639, ils entrèrent dans Alexandrie en 642.
La réduction radicale de l'activité commerciale suivit celle de la population. Vers 875, Ahmad Ibn Tulun faisait abattre les trop vastes remparts antiques pour édifier une enceinte plus restreinte.
En 1202, les Vénitiens prirent momentanément Alexandrie. Comme les Génois et les Pisans, et même plus qu'eux, ils obtinrent des privilèges commerciaux et firent du port un centre de commerce des épices de l'Orient, aux xive et xve s. Ils y importaient en contrepartie des armes et des esclaves originaires des Balkans. Le Sultan percevait des droits de port élevés.
La découverte de l'itinéraire du cap de Bonne-Espérance réduisit l'activité transitaire avec l'Orient. La venue des Turcs Ottomans, en 1517, porta le coup de grâce à Alexandrie, qui fut saccagée.
L'ÉPOQUE MODERNE
Quand Napoléon Bonaparte débarqua à Alexandrie en 1798, il n'y avait plus que 7 000 habitants. Méhémet-Ali redonna quelque rôle à la ville, dont la population remonta : 25 000 habitants en 1825, 100 000 en 1850. De son temps datent diverses constructions : un nouveau phare, à l'ouest de la presqu'île, l'arsenal du port de l'ouest, le palais de Ras al-Tin, enfin le canal Mahmudiyya, qui contourne l'agglomération par le sud, remplace l'ancien canal canopique et relie Alexandrie au Nil.
Ce fut le signal de la renaissance de la ville, qui, point de départ de la route terrestre des Indes, s'européanisa progressivement et attira non seulement des Français et des Anglais, mais aussi des Grecs, des Juifs et des Syriens. Elle fut la capitale de fait de l'Égypte, depuis Méhémet-Ali jusqu'à l'avènement d'Ismaïl, qui favorisa Le Caire.
LA GÉOGRAPHIE DE LA VILLE ANTIQUE
La ville s'étendait le long de la mer et s'accrochait à quelques collines. À l'ouest le vieux quartier indigène de Rhakotis, à l'est le quartier royal (Brouchion), puis le quartier juif et les faubourgs. En face, l'îlot rocheux de Pharos, qui fut bientôt relié au continent par un pont, l'Heptastadion. Ce pont, qui séparait les deux ports, le Grand Port à l'est et l'Eunostos à l'ouest, est remplacé aujourd'hui par un large tombolo.
Alexandre le Grand avait confié à l'architecte Dinocratès, de Rhodes, le soin de tracer le plan de la ville : ce fut un damier de larges avenues selon la manière des urbanistes de ce temps.
L'ensemble était ceinturé de remparts, qui jouèrent efficacement leur rôle jusqu'à leur démolition, au ixe s. Selon l’historien Tacite, ils avaient été l'œuvre de Ptolémée Ier, mais les fouilles n'ont pas confirmé cette ancienneté de façon absolue et n'ont reconstitué qu’approximativement leur tracé.
CULTURE ET PATRIMOINE D’ALEXANDRIE
LE PATRIMOINE DE LA VILLE ANTIQUE
Les recherches ultérieures, menées par les conservateurs successifs du Musée gréco-romain, ont permis de découvrir des vestiges du Serapeum [expliquer], mais elles ont surtout porté sur les nécropoles, nombreuses dans les alentours : la plus spectaculaire est, au sud, celle de Kum al-Chaqafa, la « colline des tessons ».
Si l'on veut se faire une idée des principaux monuments d'Alexandrie, il faut se tourner vers les auteurs anciens. Le géographe Strabon énumère une partie des édifices : le fameux phare qui tient son nom de l'île de Pharos, les palais royaux, de l'autre côté du port, sur le cap Lochias, et, au-delà de ceux-ci, le théâtre, le Timonium bâti par Antoine, le Cesareum construit par Cléopâtre en mémoire de César ; beaucoup plus à l'intérieur, le Serapeum, qui semble dominer la ville, l'amphithéâtre et le stade du quartier de Nikopolis, le gymnase, le Paneum, colline artificielle dans laquelle on monte par un escalier intérieur. Deux édifices ont bénéficié d'un prestige tout particulier et ont marqué la vie alexandrine : le Serapeum et le Musée.
LE CULTE DE SÉRAPIS
L'origine du culte, typiquement alexandrin, de Sérapis, est obscurcie par la légende. Son temple, le Serapeum, était de beaucoup le plus grand d'Alexandrie. Il était situé sur une colline, aux abords de Rhakotis, là où l'on voit la colonne de Dioclétien [empereur]. C'était une enceinte carrée, close de murs, et dans laquelle se trouvaient divers sanctuaires de Sérapis et des divinités qui lui étaient associés, Isis et Harpocrate. Les fouilles ont permis de découvrir des plaques de fondation, en une collection de matériaux différents, allant de l'or à la faïence et attestant les constructions successives. Outre les sanctuaires, l'enceinte contenait des habitations de prêtres, des portiques, une bibliothèque.
Alexandrie renfermait au minimum deux ou trois autres temples de Sérapis. L'île de Pharos possédait un temple d'Isis Pharia, et il y avait des lieux de culte consacrés aux souverains : culte d'Alexandre au Sêma (son tombeau), culte d'Arsinoé II à l'Arsinoeion, temple de Ptolémée Ier et de ses successeurs, qui s'identifiaient volontiers à des divinités classiques. Le temple que Cléopâtre avait érigé en l'honneur de César (le Cesareum) fut consacré par Auguste au culte impérial (le Sebasteion).
LE MUSÉE, LA BIBLIOTHÈQUE
Le célèbre Musée d'Alexandrie, placé sous l'invocation des Muses, donnait asile aux intellectuels les plus éminents de l'époque, venus de tout le monde grec. Installé en plein centre de la ville, il comportait des promenades, des portiques, des salles de conférences, une salle à manger, un parc zoologique, des installations spécialisées telles que celles qu'utilisaient les astronomes, et enfin la bibliothèque. La vie intellectuelle bénéficiait ainsi d'un climat favorable et de la protection royale. Certains pensionnaires (le poète Callimaque, le critique Zénodote, le poète Apollonios de Rhodes) détinrent les fonctions de bibliothécaire. La bibliothèque fournissait des instruments de travail abondants. La production du papyrus favorisa le développement de la paperasserie égyptienne, mais aussi la multiplication des écrits. Alexandrie était donc l'endroit d'élection pour la plus grande bibliothèque du monde antique. Fondée sous Ptolémée Ier, elle était, à la fin de la période hellénistique, riche de 700 000 volumes ! Chiffre étonnant, auprès du petit nombre d'œuvres classiques qui ont survécu. Chiffre qu'il faut réduire pour comprendre l'importance réelle de la bibliothèque : ces volumina, rouleaux de papyrus, ne comprenaient pas le dixième du texte d'une brochure moderne, et, d'autre part, on avait catalogué généralement plusieurs exemplaires d'un même écrit. Le Serapeum contenait une autre bibliothèque, plus petite.
La grande bibliothèque avait brûlé accidentellement en 47 avant J.-C., durant la guerre d'Alexandrie : reconstituée avec des livres venus de Pergame, elle eut encore à pâtir des désordres des iiie et ive s. après J.-C.
L’UN DES PRINCIPAUX FOYERS INTELLECTUELS DE L’ANTIQUITÉ
Ces événements n'empêchèrent pas la vie intellectuelle de prospérer ; après le temps des poètes de cour (Apollonios, Aratos de Soles, Callimaque, Théocrite, Timon) et des grammairiens (Zénodote, Aristarque de Samothrace), après le temps des érudits juifs (Philon et les auteurs des Septante, de la Lettre d’Aristée) vinrent les philosophes néo-platoniciens (Ammonios et son disciple Plotin, Jamblique) et leurs rivaux chrétiens (Clément d’Alexandrie, Origène, saint Denys le Grand). Alexandrie demeura ainsi une des capitales de la discussion philosophique jusqu'à la fin de l'Antiquité.
LE PHARE D'ALEXANDRIE
INTRODUCTION
À la fin de l'année 333 avant J.-C., Alexandre, ayant réduit les ports de la côte syrienne et les estimant trop à la portée d'un retour perse, prit la décision de créer de toutes pièces une grande cité portuaire sur la côte d'Égypte. Le choix du conquérant se porta sur un site naturellement abrité, situé à l'ouest de l'embouchure du Nil, mais non pas sur le fleuve lui-même, dont les atterrissements modifient le rivage et le rendent peu propice à l'aménagement d'un port. Il confia alors à son architecte Dinocratès le soin de dessiner la nouvelle ville et d'en aménager le port. On est en droit de penser que le Phare figurait déjà dans le projet de Dinocrate, peut-être à l'instigation d'Alexandre, mais il est certain que sa construction ne fut entreprise qu'à la génération suivante. Considéré dans l'Antiquité comme la septième merveille du monde, il n'est plus connu aujourd'hui que par de rares témoignages littéraires et iconographiques. Les recherches menées sur place depuis 1994 par l'Institut français d'archéologie orientale et par le Centre d'études alexandrines, notamment les fouilles sous-marines, ont permis de dégager des vestiges immergés par 8 m de fond, sous lesquels pourraient se trouver des blocs appartenant au célèbre monument. À la faveur de ces fouilles, on a retrouvé la statue de Ptolémée XII Aulète, le père de la reine Cléopâtre VII.
UN MONUMENT ANTIQUE
C'est Ptolémée Sôtêr qui commanda l'ouvrage à l'architecte Sostratos de Cnide, lequel dut commencer les travaux aux alentours de 290 avant J.-C. Architecte et ingénieur de talent, Sostratos poursuivit ses travaux alexandrins durant le règne suivant. La construction du Phare demanda, on s'en doute, plusieurs années, et l'inauguration eut lieu sous le règne de Ptolémée Philadelphe vers 280 avant J.-C.
Par une bonne fortune, nous connaissons la dédicace du monument, rapportée par Strabon (Géographie XVII, 1,6) et mentionnée par Pline l'Ancien et Lucien. Voici le texte de Pline :« L'on vante aussi une tour, ouvrage royal, élevée dans l'île de Pharos qui commande le port d'Alexandrie. Elle coûta, dit-on, huit cents talents, et, pour ne rien passer sous silence, rappelons la magnanimité du roi Ptolémée qui permit à l'architecte Sostratos de Cnide d'y inscrire son nom sur le corps même de la construction. Son utilité est de montrer aux navires, au cours de leurs navigations nocturnes, des feux semblables à ceux qui brûlent à présent en bien des endroits, ainsi à Ostie et à Ravenne. » (Histoire naturelle, livre XXXVI, 18, traduction R. Bloch).
Il n'est pas sans intérêt de noter que l'auteur, qui écrit à l'époque de Néron, croit devoir expliquer l'utilité et le rôle du Phare, ce qui inciterait à croire que ce type d'édifice était encore une nouveauté pour les Romains. Ainsi Suétone y fait référence lorsqu'il décrit la construction du premier phare d'Ostie par l'empereur Claude, vers l'an 50 de notre ère :« Il [Claude] créa le port d'Ostie en faisant construire deux jetées en arc de cercle à droite et à gauche, et dans des eaux déjà profondes, un môle pour barrer l'entrée ; pour asseoir ce môle plus solidement, on commença par couler le navire qui avait amené d'Égypte le grand obélisque […] là-dessus, on construisit une foule de piliers supportant une tour très haute, destinée, comme celle du Pharos d'Alexandrie, à éclairer de ses feux pendant la nuit la route des navires. » (Vie des douze césars, Claude, XX, traduction H. Ailloud).
Strabon, après nous avoir décrit minutieusement le découpage de la côte et« l'île de Pharos […] simple îlot de forme oblongue et tellement rapproché du rivage qu'il forme avec lui un port à double ouverture », nous explique que la passe d'accès au port oriental, le Portus Magnus des Romains, le mieux abrité, eût été pratiquement inaccessible sans un signal pour en indiquer l'entrée. Ainsi naquit l'idée, non seulement d'un amer diurne mais, mieux encore, d'un fanal autorisant les approches nocturnes depuis une grande distance. Enfin, l'auteur de la Géographie précise que« Sostratos de Cnide l'a érigé et dédié […] ainsi que l'atteste l'inscription apposée sur le monument. ».
LES TÉMOIGNAGES LITTÉRAIRES
À l'époque pharaonique, l'île de Pharos était occupée par un village de pêcheurs, qui, à l'époque ptolémaïque fut transformé en place forte destinée à protéger l'accès maritime d'Alexandrie (Histius, De bello Alexandrino, XIV, 1 ; XVII, 19-21) ; le Phare lui-même et son enceinte propre devaient, grâce à leur situation de commandement immédiat de l'entrée du port, jouer un rôle dans ce système d'alerte et de défense.
Ce n'est donc pas sans raison si, en 1477, comme le rapportent les chroniques arabes, le sultan mamelouk Qaitbay, au cours d'une visite d'inspection à Alexandrie, donna l'ordre de construire une forteresse sur l'extrémité nord-est de l'île de Pharos, là où se trouvaient, selon toute probabilité, les restes du Phare. Le chroniqueur Ibn Iyas, à qui nous devons l'information relative à l'édification du fort, déclare en effet que celui-ci devait s'élever « sur des fondations antiques », sans préciser toutefois la nature perceptible de ces vestiges.
Deux ans après que Qaitbay eut commandé la construction de la forteresse, un voyageur allemand du nom de Tucher visite Alexandrie et décrit le nouvel ouvrage, confirmant l'initiative du sultan et la date des travaux. Son témoignage et ceux d'autres chroniqueurs ont été rassemblés en 1909 par l'archéologue allemand Hermann Thiersch dans son importante monographie : Pharos, Antike, Islam und Occident ; cet auteur, à partir de la réunion des différents récits anciens et en utilisant des représentations monétaires a proposé une restitution du Phare qui demeure aujourd'hui l'une des plus vraisemblables.
Que nous disent les textes antiques et les récits de voyageurs de l'aspect du monument tant durant sa phase de fonctionnement que durant sa lente destruction ? César, dans sa Guerre civile (De bello civil) entre deux récits de combats pour la maîtrise d'Alexandrie, prend le temps de noter :« Le Phare est une tour très élevée, d'une architecture merveilleuse, bâtie dans une île dont elle porte le nom. » C'est tout et c'est peu ; on y trouve néanmoins une évocation de dimension et un jugement qualitatif. Pline l'Ancien, cité à propos de la dédicace de Sostratos, s'il est plus disert, puisqu'il révèle même le prix de la construction, néglige malheureusement de décrire l'aspect du Phare, qui est seulement qualifié de « tour ». C'est en fait grâce à Strabon que l'on entrevoit la silhouette du monument, qui devient sous sa plume une « tour à plusieurs étages, en marbre blanc ».
Cette information, toutefois, peut sembler anodine, puisqu'une tour- construction élevée - possède généralement plusieurs étages ; il fallait donc interpréter différemment cette formule et comprendre « plusieurs étages visibles donc en retrait les uns sur les autres ». C'est alors que l'on retrouve la silhouette « en ziggourat » des phares figurant sur les mosaïques d'Ostie.
Un autre auteur antique, rapportant une chronique sans rapport direct avec Alexandrie, nous parle de la forme du Phare : il s'agit de Flavius Josèphe, lequel dans sa description du siège de Jérusalem établit un état des défenses de la ville (la Guerre des Juifs, livre V, 2). Parmi les constructions énumérées figure une tour dite « de Phazaël » dont Josèphe nous dit que « sa forme ressemblait à celle du phare d'Alexandrie où un feu toujours allumé sert de fanal aux mariniers pour les empêcher de donner à travers les rochers qui pourraient leur faire faire naufrage ; mais celle-ci était plus spacieuse que l'autre ». Ailleurs, il précise : « La clarté du feu du Phare s'étend jusqu'à trois cents stades. »
Beaucoup plus tard, à un moment où le Phare en tant que signal lumineux était abandonné à la suite de destructions, l'écrivain arabe Ali al-Masudi, nous décrit dans ses Prairies d'or le monument tel qu'on pouvait encore le voir et l'estimer :« La hauteur du Phare, actuellement, est à peu près de 230 coudées. Anciennement, elle était d'environ 400 coudées ; le temps, les tremblements de terre et les pluies l'ont détérioré ; […] sa construction a trois formes : il [le phare] est carré jusqu'à un peu moins que la moitié et un peu plus que le tiers ; là, la construction est en pierre blanche ; ce qui fait 110 coudées à peu près. Ensuite, la figure en devient octogone et il est alors construit de pierres et de plâtre dans l'étendue de soixante et quelques coudées. Un balcon l'entoure pour pouvoir se promener autour. Enfin, la partie supérieure en est ronde. ».
Un musulman de Málaga, Ibn al-Sayg, ayant séjourné à Alexandrie en 1165 et 1166, eut la curiosité de mesurer, à l'aide d'une corde, dit-il, la tour du Phare et nous livre les dimensions suivantes : pour le premier étage, carré, une hauteur que l'on peut traduire par 60 m et pour le deuxième étage, octogonal, une hauteur de 26 m ; avec le dernier niveau la hauteur totale avoisinait 105 m. Ce dernier niveau, cylindrique, Ibn al-Sayg, en fait une petite mosquée en forme de coupole. Plus tard, l'historien arabe Ahmad al-Maqrizi (1364-1442), grand compilateur de chroniques anciennes, écrit à propos de deux témoignages anciens :« Un écrivain dit l'avoir mesuré et avoir trouvé 233 coudées [pour la hauteur du Phare] ; il est de trois étages : le premier étage est un carré haut de 121,5 coudées ; le deuxième est octogone, de 81,55 [de haut] ; le troisième étage est rond, il a 31,5 coudées. ».
Ibn Djubayr note, dans son mémoire de voyage, que le Phare d'Alexandrie paraît à plus de 70 milles ; qu'il a mesuré lui-même un des quatre côtés de l'édifice, en l'année 548 de l'hégire (1183), et qu'il l'a trouvé de plus de 50 coudées, que, enfin, la hauteur dépassait 150 brasses. Reprenons ces mesures et traduisons-les : pour al-Masudi, la hauteur restante est de 102 m, elle était à l'origine de 177,40 m (« à peu près ») ; le premier étage, de plan carré, est haut de 48,78 m, le deuxième, octogonal, est haut de plus de 26,61 m, enfin la partie terminale, ronde, n'est pas évaluée. Chez l'auteur du xiie s. cité par al-Maqrizi, les dimensions se précisent et deviennent : pour la hauteur totale, de 103,33 m ; pour le premier étage, carré, de 53,88 m ; pour le deuxième étage, octogonal, de 36,14 m ; enfin, pour le troisième étage, circulaire, de 13,97 m. Enfin, le second auteur cité par al-Maqrizi ajoute une troisième série de dimensions : une hauteur de plus de 225 m ( !) et un côté à la base de 22,17 m, un véritable stylet ayant, telle une colonne, une hauteur égale à dix fois la base !
Autre chroniqueur et voyageur arabe apportant des précisions sur le Phare, Ibn Battuta, le « Voyageur », originaire de Tanger, nous a laissé une description de l'état du Phare en 1326 : à cette date, l'un des quatre côtés de l'édifice, dont la base mesurait 100 pieds, s'était effondré. Retourné sur place vingt-trois ans plus tard, l'auteur constate que la dégradation s'est accrue considérablement au point qu'il est même devenu impossible d'accéder à la porte.
De ces dimensions, parfois fort variables, nous retiendrons que le Phare avait une hauteur voisine et légèrement supérieure à une centaine de mètres et qu'il était constitué de trois étages, de hauteur et de largeur dégressives, et respectivement de plan carré, octogonal et circulaire.
ICONOGRAPHIQUES
L'iconographie du Phare est certainement celle qui est la plus abondante de celle des Sept Merveilles. La meilleure source nous est donnée par des monnaies alexandrines, frappées entre le règne de Domitien (81 à 96) et celui de Commode (180 à 192), sur lesquelles le Phare apparaît avec ses trois étages. On y distingue même, au sommet du premier étage, les silhouettes de tritons sonnant de la trompe, tandis qu'une statue, Poséidon ou Ptolémée divinisé, somme le dernier étage. Dans une telle structure, le foyer devait être abrité dans le pavillon sommital ajouré par une colonnade.
D'autres supports présentent le Phare avec une précision variable ; deux sont des mosaïques d'époques tardives, un autre, beaucoup moins conventionnel est un verre gravé, souvenir anecdotique d'un voyageur ayant séjourné à Alexandrie, retrouvé sur le site de Begram, en Afghanistan ; enfin, trois lampes de terre cuite en forme de phare sont conservées au musée d'Alexandrie.
Les deux mosaïques apparaissent comme plus explicites : la première, malheureusement mutilée, provenant de la basilique Saint-Jean de Gerasa, identifie Alexandrie par une inscription et montre le Phare, isolé de la ville. La seconde mosaïque, datée des environs de 1200, se trouve dans la basilique Saint-Marc de Venise et représente l'arrivée du saint à Alexandrie. À cette époque, le Phare avait cessé de fonctionner en tant que tel et ne servait plus que d'amer diurne, tandis que sur son sommet une petite mosquée avait été aménagée.
|
| |
|
| |
|
 |
|
MAO TSÉ - TOUNG |
|
|
| |
|
| |

Mao Zedong ou Mao Tsö-tong ou Mao Tsé-toung
Cet article fait partie du dossier consacré à la guerre froide.
Homme d'État chinois (Shaoshan, Hunan, 1893-Pékin 1976).
Mao participe à la fondation du parti communiste chinois en 1921. C’est pendant la Longue Marche conduite pour échapper au Guomindang qu’il devient chef du parti en 1935. Après avoir conduit la guerre contre le Japon, puis le Guomindang, il fonde en 1949 la République populaire de Chine qu’il dirige jusqu’à sa mort, l’emportant sur ses rivaux au prix d’initiatives aventureuses comme le Grand Bond en avant ou la Révolution culturelle. Bien qu’ayant mené son pays au bord de l’effondrement, il continue aujourd’hui à y incarner l’idéal révolutionnaire.
Mao avant la Chine populaire (1893-1949)
Fils instruit d’un paysan aisé, Mao devient, après ses études, bibliothécaire à l’université de Pékin. Il participe en 1921 à la fondation du parti communiste chinois (PCC) par Chen Duxiu et une poignée de marxistes, désireux, comme le gouvernement nationaliste du Guomindang, de libérer le pays de l’emprise des seigneurs de guerre et des impérialistes.
Après la rupture avec le Guomindang en 1927, Mao organise des bases révolutionnaires paysannes dans la province du Jiangxi, où est fondée une « République soviétique chinoise » dont il devient président en 1930. Désavoué par le parti, puis délogé par le Guomindang, il se replie vers le nord en menant la Longue Marche (1934-1935), pendant laquelle il est enfin reconnu comme chef du Parti.
De nouveau allié au Guomindang dans la lutte contre les Japonais (1937-1945), il mène ensuite contre lui la seconde guerre civile à l’issue de laquelle est proclamée, le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine.
Le dirigeant de la Chine populaire (1949-1976)
Président du parti et de la République, Mao donne le ton aux différentes phases du régime, même s’il est fréquemment contesté, ce qui le conduit, à partir de 1957, à une surenchère révolutionnaire plus tactique qu’idéologique, puisqu’elle est destinée à le faire triompher de ses rivaux.
Après la phase de Démocratie nouvelle (1949-1953) consacrée au redressement du pays, puis la période d’imitation du modèle soviétique (1953-1956), Mao, indirectement atteint par la remise en question du culte de la personnalité de Staline en URSS, reprend l’initiative en lançant en 1957 la campagne de libre expression des Cent Fleurs, puis, en 1958 le Grand Bond en avant, expérience de développement économique chaotique qui provoque la mort de 36 millions de Chinois. Désavoué par Liu Shaoqi, auquel il cède la présidence de la République en 1959, Mao prépare sa revanche.
Ce sera la Révolution culturelle, orchestrée par ses soins à partir de 1966 pour créer « l’homme nouveau » en éliminant tous ceux qui « retardent l’édification du socialisme ». De plus en plus coupé des réalités, jouant d’une faction contre l’autre, Mao réussit ainsi à conserver le pouvoir jusqu’à sa mort en 1976. Si celle-ci est suivie d’un virage vers la modernisation économique au détriment du socialisme, la Chine ne connaîtra pas de démaoïsation comparable à la déstalinisation soviétique.
1. MAO JUSQU’À LA NAISSANCE DE LA CHINE POPULAIRE (1893-1949)
1.1. MAO AVANT LE COMMUNISME (1893-1921)
LA JEUNESSE (1893-1918)
Fils d'un paysan aisé enrichi dans le commerce des grains qui aurait voulu faire de lui le gérant de la petite affaire familiale, Mao Zedong doit se rebeller contre l'autorité paternelle pour continuer ses études. Il grandit dans une Chine humiliée d'avoir dû accorder aux puissances occidentales des concessions qui jouissent d'énormes avantages, les empereurs s'avérant incapables de faire respecter l'indépendance nationale du pays ni de moderniser celui-ci.
Quand, en 1911, la révolution du Guomindang de Sun Yat-sen met fin à la monarchie et proclame la république, Mao est, comme de très nombreux jeunes gens de son âge, gagné par l'enthousiasme, et il s'engage durant six mois dans l'armée révolutionnaire. Il revient ensuite à Changsha, capitale du Hunan, poursuivre ses études primaires supérieures jusqu'en 1918. À l'école normale du Hunan (1913-1918), Mao organise aussi des cours du soir pour alphabétiser les travailleurs.
FORMATION INTELLECTUELLE ET POLITIQUE
Nourri de culture chinoise traditionnelle et de culture occidentale, Mao est un admirateur des grands empereurs chinois chefs de guerre. En 1917, dans la revue Nouvelle Jeunesse de Chen Duxiu, il publie son premier article, sur l'éducation physique nécessaire au peuple chinois pour se libérer de la tutelle impérialiste. La même année, le voici à la tête de la Société d'étude du nouveau peuple constituée dans le Hunan parmi les étudiants radicaux. À l'automne 1918, Mao devient aide-bibliothécaire à l'université de Pékin sous l'autorité du bibliothécaire en chef, Li Dazhao.
Le jeune Mao subit l'influence de Chen et de Li, qui, après avoir dirigé le mouvement du 4 mai, accueillent avec enthousiasme la révolution russe de 1917. C'est à Chen que Mao devra sa conversion au marxisme en 1920.
NAISSANCE DU COMMUNISME CHINOIS (1919-1921)
La Chine, un moment unifiée par la république présidée par Yuan Shikai (1912-1916), est entrée depuis dans une longue période de confusion politique : dans les provinces, les généraux (seigneurs de la guerre) accèdent au pouvoir tandis que Sun Yat-sen prend en 1917 à Canton la tête d'un gouvernement républicain. Cette période d'affrontements internes et de morcellement politique durera en fait jusqu'en 1949.
Mao, qui a participé au mouvement du 4 mai à Changsha où il est revenu s'établir, fonde une section des Jeunesses socialistes. Il publie son premier article marxiste en novembre 1920. Il est alors directeur d'école primaire puis gérant d'une librairie. En juillet 1921, il est un des douze délégués qui créent à Shanghai le parti communiste chinois (PCC), dont Chen devient le premier secrétaire général.
1.2. L’ASCENSION DE MAO AU SEIN DU PARTI COMMUNISTE (1921-1935)
DE L’ALLIANCE À LA RUPTURE AVEC LE GUOMINDANG (1921-1927)
Nommé responsable pour le Hunan du secrétariat au travail, Mao organise des syndicats ouvriers. Il approuve la politique d'alliance avec le Guomindang de Sun Yat-sen pratiquée par le PCC sur les conseils de l'Internationale communiste. En 1923-1924, le voici responsable de l'organisation du PCC mais aussi membre du bureau de Shanghai du Guomindang. Cette stratégie permet au PCC d'élargir son influence. Témoin des fortes réactions populaires qui se produisent dans son village natal du Hunan à la suite des incidents des 30 mai et 23 juin 1925 au cours desquels la police anglaise de Shanghai et de Canton a tiré sur la foule, Mao y prend conscience du rôle révolutionnaire de la paysannerie. Il écrira en 1927 son Rapport sur l'enquête menée dans le Hunan à propos du mouvement paysan pour affirmer le rôle de la paysannerie dans la lutte révolutionnaire.
Après la mort de Sun Yat-sen (mars 1925), l’aile droite l’emporte au sein du Guomindang, avec Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek), qui rompt brutalement avec les communistes en avril 1927 (fusillades de Shanghai). Le parti se replie alors dans les campagnes, et Mao est chargé de l'organiser sur une base militaire dans son Hunan natal.
LA GUÉRILLA AU JIANGXI (1927-1930)
En septembre 1927, Mao conduit ses troupes dans les montagnes du Hunan puis du Jiangxi. En avril 1928, son armée reçoit le renfort de celle d'un autre dirigeant du PCC, Zhu De, puis, en novembre, de l'armée de Peng Dehuai. Jusqu'en 1934, le Jiangxi est administré par les communistes : c'est la République soviétique du Jiangxi, dont Mao est le président depuis novembre 1931. L'Armée rouge, fortement politisée, est formée selon la doctrine d'une action aux tâches extramilitaires multiples : propagande, organisation des masses et même production. Mao énonce les principes de la lutte de guérilla, tactique d'« encerclement des villes par les campagnes ».
LA MISE À L’ÉCART DE MAO (1930-1934)
Grâce à l'appui que leur apportent les paysans, les communistes étendent leur influence à un point tel que, durant l'été 1930, la direction du PCC dont le nouveau secrétaire général est Li Lisan, ordonne à l'armée du Jiangxi de sortir de ses bases et de lancer une offensive contre les grandes villes tenues par le Guomindang. C'est l'échec ; Mao propose le repli sur le Jiangxi tandis que Li Lisan est écarté. Mais le PCC ne passe pas pour autant sous le contrôle de Mao mais sous celui de Wang Ming et des « vingt-huit bolcheviques » ainsi appelés par Mao parce qu'ils avaient pour la plupart étudié en URSS. Mao, critiqué pour ses conceptions militaires en faveur de la guérilla, doit s'incliner, son autorité à la tête de la République soviétique du Jiangxi devenant de plus en plus nominale. Désormais, l'armée communiste doit privilégier les batailles rangées et c'est de cette façon qu'elle repousse à quatre reprises, entre 1930 et 1934, les attaques que lance le Guomindang pour la détruire.
LA LONGUE MARCHE : MAO CHEF DU PARTI (1934-1935)
Mais cette stratégie montre ses limites en 1934 lors de la cinquième offensive, à l'issue de laquelle l'armée communiste n'évite l'encerclement total que par une percée en octobre 1934 qui lui fait abandonner le Jiangxi. Ainsi commence la Longue Marche qui conduit au bout d'un an et 12 000 kilomètres, en octobre 1935, les 30 000 survivants dans le Shanxi. Là, l'armée du Jiangxi est grossie d'autres contingents communistes. Au cours de cette retraite, bientôt transformée en épopée, Mao a pu faire adopter ses méthodes militaires et a beaucoup gagné en autorité dans le parti. En janvier 1935, à Zunyi dans le Guizhou, au cours d'une réunion des chefs politiques et militaires, il fait condamner la politique de la direction du PCC et devient le chef du parti.
1.3. DE LA LONGUE MARCHE À LA VICTOIRE COMMUNISTE (1935-1949)
VERS L’ALLIANCE TACTIQUE AVEC LE GUOMINDANG (1935-1937)
À partir d'octobre 1935, Mao installe sa capitale à Yan'an dans le Shaanxi. De là, il proclame que l'ennemi principal du PCC est l'envahisseur japonais installé en Mandchourie depuis septembre 1931 et offre son alliance au Guomindang, qui finit par accepter en septembre 1937, deux mois après le début officiel de la guerre sino-japonaise.
LA GUERRE SINO-JAPONAISE (1937-1945)
La guerre permet aux communistes d’asseoir leur position dans le Nord et le Centre et de mobiliser les populations locales contre l’envahisseur, alors que le Guomindang se discrédite par sa passivité. Elle confère surtout à Mao une stature nationale. À plus de 40 ans, Mao est maintenant un dirigeant éprouvé. C'est ce symbole vivant de la révolution, ayant perdu dans la lutte plusieurs membres de sa famille, que rencontre le journaliste américain Edgar Snow, dont les écrits vont faire connaître la révolution chinoise à l'étranger. Parallèlement, ses idées sur la « sinisation du marxisme » triomphent dans le parti (campagne de rectification de 1942). En avril-juin 1945, le VIIe congrès du PCC l'élit président du Comité central et proclame que le parti est désormais guidé par la « pensée de Mao Zedong ».
LA GUERRE CIVILE (1946-1949)
Dès la capitulation du Japon (2 septembre 1945), la reprise de la guerre civile est inéluctable. Les mêmes méthodes qui ont assuré le succès de la Longue Marche et de la lutte contre les Japonais permettent au PCC de l'emporter dans la guerre civile qui l'oppose de 1946 à 1949 au Guomindang, pourtant aidé par les Américains. Le PCC de Mao réussit à incarner aux yeux des Chinois tout à la fois l'indépendance nationale, les espoirs de révolution sociale, l'honnêteté face à la corruption des nationalistes et la paix civile par une politique de large alliance avec les adversaires de Jiang Jieshi, qui finit par se réfugier à Taiwan avec ses partisans.
2. LE DIRIGEANT DE LA CHINE POPULAIRE (1949-1976)
En septembre 1949, dans Pékin conquise, Mao réunit une Conférence politique consultative qui désigne un gouvernement de coalition sous sa présidence. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est proclamée. Les institutions en seront fixées par la Constitution du 20 décembre 1954. Mao concentre entre ses mains trois présidences essentielles : celle du parti, celle de la République et celle du conseil militaire révolutionnaire. Pourtant, même si son autorité est exceptionnelle, même si sa pensée inspire la politique du parti, les autres dirigeants ne sont pas des comparses.
L'homme qui est maintenant à la tête d'un pays de 600 millions d'habitants a conservé les goûts simples d'un paysan, s'exprimant dans le dialecte du Hunan. Il vit en reclus dans ses diverses résidences de Pékin, Beidaihe, Wuhan, Hangzhou, lit beaucoup et voyage souvent dans le pays. S'il reçoit occasionnellement les dirigeants du parti et de l'État, dont Zhou Enlai, le Premier ministre, il communique en général avec eux par notes écrites. Ce comportement en fait un personnage à part, dont le prestige est immense, mais, l'éloignant de la pratique quotidienne du pouvoir, il contribuera à l'isoler, au fil des différentes phases de l’histoire de la République populaire : Démocratie nouvelle (1949-1953), imitation du modèle soviétique (1953-1956), campagne des Cent Fleurs (1957), Grand Bond en avant (1958), Révolution culturelle (1966-1976).
2.1. LA DÉMOCRATIE NOUVELLE (1949-1953)
Dans tous les domaines, c'est lui qui donne le ton. La base théorique de la République populaire de Chine est son essai de juin 1949 (De la dictature démocratique populaire) qui intègre, aux côtés de la classe ouvrière et de la petite paysannerie, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale dans le groupe des quatre classes anti-impérialistes et antiféodales, et dénie aux autres « ennemis du peuple » tout droit de suffrage dans la « Démocratie nouvelle », slogan qui donne son nom à cette première période au cours de laquelle il s'agit, avant tout de reconstruire la Chine.
– Reconstruction politique par l'élimination, y compris physique, des contre-révolutionnaires, par la reprise en main des intellectuels et par une plus grande discipline dans le parti ;
– reconstruction économique par la réforme agraire et par le développement de la production industrielle ;
– reconstruction sociale par un grand effort fait pour l'instruction et par la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes ;
– reconstruction de la politique extérieure par le traité d'alliance et d'amitié signé avec l'URSS en février 1950 et par l'aide en armes apportée aux communistes vietnamiens et en soldats aux communistes coréens.
2.2. LA PHASE D’IMITATION DU MODÈLE SOVIÉTIQUE (1953-1956)
De 1953 à 1956, le développement économique se fait sur le modèle soviétique : adoption du premier plan quinquennal, collectivisation des terres par regroupement de plus en plus autoritaire dans des coopératives. Mao reconnaît lui-même que le parti communiste de l'Union soviétique est « le meilleur professeur » du PCC et que la nouvelle Chine appartient au « front anti-impérialiste » dirigé par l'URSS.
En quelques années, la Chine accroît sa production dans des proportions importantes, bénéficiant d'une aide soviétique multiforme et de la sécurité revenue dans le pays pour la première fois depuis des décennies. Ses réalisations sociales incontestables, l'aide apportée aux mouvements d'indépendance nationale en Asie en font un pays au prestige international retrouvé et symbolisé par sa participation à la conférence de Bandung (1955) malgré la perte de son siège à l'ONU en 1951.
2.3. LE TOURNANT DE 1956-1957
MAO REMIS EN QUESTION
L'année 1956 marque un tournant dans la vie de Mao comme dans le destin de la Chine populaire. En février, le XXe Congrès du parti communiste de l'Union soviétique condamne le culte de la personnalité de Staline. Craignant que cette attitude n'ouvre la voie à des attaques contre sa propre personne, qui est alors l'objet d'un culte du même type, Mao désapprouve le rapport de Nikita Khrouchtchev. Mais le VIIIe Congrès du PCC, en septembre 1956, confirme les pires craintes de Mao. Le numéro deux du parti, Liu Shaoqi, et celui qui devient alors secrétaire général, Deng Xiaoping, attaquent le culte de la personnalité, font l'éloge de la direction collective, critiquent la précipitation en matière politique. Plus grave, le Congrès fait disparaître des textes du parti toute référence à la pensée de Mao. Certes, ce dernier conserve toutes ses fonctions, mais il est clair que le Congrès s'est fait contre lui.
Toutes les initiatives politiques qu'il va prendre de 1957 à 1966 sont autant d'efforts pour contrecarrer la ligne établie par le VIIIe Congrès en court-circuitant au besoin les instances dirigeantes du PCC.
C'est donc à la fois en termes d'idéologie (pour ou contre le maoïsme) et de lutte pour le pouvoir qu'il convient d'analyser les soubresauts que va connaître la Chine jusqu'à la mort de Mao.
LE MAOÏSME COMME STRATÉGIE ET COMME IDÉOLOGIE
Le maoïsme lui-même, par son empirisme et son opportunisme (puisque rechercher la vérité dans les faits, comme le dit Mao dès 1941, peut conduire à la modification radicale d'une ligne, par exemple passer de la sacralisation du parti à son dénigrement pendant la Révolution culturelle) peut apparaître en partie comme une justification pseudo-théorique pour conserver ou reconquérir le pouvoir. Mao, sans hésiter à puiser dans la tradition taoïste et à citer Laozi, affirme que la Chine doit résoudre la contradiction « entre les lois objectives du développement économique de la société socialiste et la connaissance subjective » des communistes. C'est-à-dire qu'il considère comme inévitables les erreurs dans l'édification de la nouvelle société, tout en appelant à en tirer des enseignements.
Le maoïsme est également une conception particulière du marxisme où la paysannerie se voit dotée d'un potentiel révolutionnaire supérieur à celui de la classe ouvrière, où l'armée a un rôle particulier à jouer en temps de paix, où la grandeur de la Chine est un objectif essentiel, où le moralisme et le volontarisme doivent permettre l'avènement d'une société égalitaire.
LA CAMPAGNE DES CENT FLEURS
En février 1957, Mao reprend l'initiative par un discours attaquant la bureaucratie communiste et demandant aux intellectuels comme aux membres des partis alliés de critiquer le PCC (« Que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent »). Pour la première fois depuis 1949, Mao met en cause un parti dont il est le président. Après quelques hésitations, les critiques fusent de toute part contre le PCC mais aussi contre Mao lui-même. Le mouvement (sorte de révolution culturelle avortée) est allé trop loin. Mao fait alors bloc avec le parti et prend la tête d'une campagne contre les « droitistes » : près d'un demi-million de personnes se retrouvent dans des camps de rééducation.
2.4. LE GRAND BOND EN AVANT ET SES SUITES (1958-1965)
UN IMMENSE ÉLAN DE VOLONTARISME
En mai 1958, le moment est venu pour Mao de lancer le Grand Bond en avant. Il s'agit, en réalisant une mobilisation sans précédent des masses, d'accélérer la rupture avec les traditions réactionnaires de la Chine ancestrale et de rattraper économiquement la Grande-Bretagne en quinze ans. Tandis que le travail manuel est exalté, que des milliers de fonctionnaires du parti sont envoyés aux champs, de grands chantiers s'élèvent un peu partout, les hauts-fourneaux de poche se généralisent et des communes populaires sont créées. C'est dans ce contexte qu'apparaît en mai 1958 le concept de « révolution permanente » ou « révolution ininterrompue ». Même si c'est Liu Shaoqi qui a le premier utilisé l'expression, cette théorie est au cœur du maoïsme et connaîtra une grande fortune avec la Révolution culturelle.
UN BILAN DÉSASTREUX
Cependant, dès la fin de 1958, le Grand Bond en avant apparaît comme un énorme gâchis : les récoltes pourrissent dans les champs ; pour fabriquer un acier inutilisable on a fondu des outils agricoles et des ustensiles ménagers dont on manque cruellement ; la disette se répand partout. S'il est difficile d'évaluer le coût humain du Grand Bond en avant, l’historien Yang Jisheng (Stèles. La Grande Famine en Chine, 1948-1961, 2012) parle aujourd'hui de 36 millions de morts !
C'est à ce moment que Mao démissionne de la présidence de la République ; retrait volontaire ou injonction du parti ? On ne sait. Il est remplacé en avril 1959 par Liu Shaoqi, dont les vues plus modérées sont connues, mais Mao obtient en août de la même année la destitution du chef de l'armée Peng Dehuai qui, avec d'autres, a critiqué l'irréalisme du Grand Bond en avant et qui, par ailleurs, est favorable à une collaboration militaire avec l'URSS.
LA RUPTURE AVEC L’URSS (1960)
Or, c'est justement durant cette période que se distendent les liens entre la Chine et l'URSS. En juillet 1958, Mao reçoit Khrouchtchev, qui émet des réserves sur les communes populaires et prêche la modération vis-à-vis de Taïwan. Depuis des années, les Soviétiques apprécient peu que les Chinois mettent en avant l'exemplarité de leur révolution pour le tiers-monde et le caractère exceptionnel de la pensée de Mao. Un mois plus tard, affichant son indépendance, Mao entame les bombardements sur l'île taïwanaise de Quemoy. En juin 1959, l'URSS dénonce l'accord sino-soviétique d'octobre 1957 prévoyant la fourniture des secrets de l'arme atomique à la Chine. La rupture intervient en 1960. Les nombreux incidents de frontière sino-soviétiques à partir de 1961 peuvent être interprétés comme une diversion aux difficultés internes chinoises mais aussi une opposition de plus en plus radicale à l'hégémonie du PCUS sur le mouvement communiste et de l'URSS sur le camp socialiste.
LA PRÉPARATION DE LA RÉVOLUTION CULTURELLE (1962-1966)
Ce n'est qu'en janvier 1962, devant la croissance de l'opposition du parti, emmenée par Liu Shaoqi, que Mao reconnaît l'échec du Grand Bond en avant.
Mais, pour réduire ses adversaires au sein du PCC, il multiplie entre 1962 et 1966 les initiatives qui préparent au grand affrontement avec le parti que sera la Révolution culturelle : en septembre 1962, il estime que la Chine est menacée par une restauration du capitalisme et par l'opposition des intellectuels ; à partir de 1963, sa quatrième épouse, Jiang Qing, commence à jouer un rôle dans la politique culturelle du parti dans le sens de l'intransigeance idéologique ; en mai 1964 paraît la première édition des citations du président Mao (Petit Livre rouge) dont Lin Biao se sert aussitôt pour développer dans l'armée le culte de Mao ; en 1965, Mao critique Liu Shaoqi et Deng Xiaoping ; enfin, le 17 mars 1966, devant le Bureau politique, il propose de déclencher contre les intellectuels une révolution culturelle et, en avril, est constitué le petit groupe de la Révolution culturelle avec Jiang Qing, Chen Boda, Kang Sheng. Leur rôle est de traquer les éléments « bourgeois » dans le parti, l'armée, le gouvernement.
2.5. LA RÉVOLUTION CULTURELLE (1966-1976)
Entreprise utopique qui projette d'éliminer les Quatre Vieilleries (vieilles idées, culture, coutumes et habitudes) et de « créer l'homme nouveau », la Révolution culturelle se veut une nouvelle phase de la lutte des classes : il s'agit d'éliminer tous ceux qui retardent « l'édification du socialisme ». Mao estime qu'on ne peut atteindre ce résultat que par une nouvelle révolution. Lui-même se retire alors à Hangzhou tandis que la Chine commence à connaître une agitation de plus en plus vive.
UN PREMIER SOMMET (1966-1968)
Durant deux ans, les manifestations d'étudiants et de lycéens se multiplient, accompagnées de multiples violences physiques, contre les hiérarchies de l'université et du parti. Dès le 6 août 1966, des millions de gardes rouges, étudiants en majorité, défilent à Pékin devant Mao qui justifie leur rébellion. Mais les résistances de la population et du parti sont si fortes que Mao lance un appel à l'armée pour soutenir les gardes rouges. Le parti est finalement brisé, mais, le chaos continuant, Mao décide en juillet 1968 de rétablir l'ordre en s'appuyant sur l'armée et sur les ouvriers des usines : sous couvert de régénération au contact des réalités, des millions de jeunes sont envoyés dans les campagnes.
UNE FRAGILE NORMALISATION (1969-1971)
Lorsque le IXe Congrès du PCC se réunit en avril 1969, la référence à la pensée de Mao, supprimée en 1956, est rétablie. Dans le nouveau Comité central dominent deux groupes distincts se réclamant également de Mao : celui de Jiang Qing et celui de Lin Biao. Ce dernier, désigné comme le successeur de Mao, paraît d'abord l'emporter. Il développe la militarisation de la société et un culte outrancier du « Grand Timonier » Mao. Pourtant, celui-ci désapprouve ces excès. Il semble que Lin Biao, sentant venir sa disgrâce, ait préparé un complot, mais il s'enfuit et, selon la thèse officielle, trouve la mort dans un accident d'avion en septembre 1971.
UN IMPACT MONDIAL
Peu soucieux de laisser le champ libre à Jiang Qing, Mao rappelle bientôt les membres du parti écartés depuis 1966. À la faveur de la Révolution culturelle, interprétée par le régime et par ses partisans à l'étranger – malgré les nombreuses victimes qu'elle fit – comme un grand mouvement de pureté révolutionnaire opposé au dogmatisme, à la bureaucratie, à l'impérialisme américain comme à l'« hégémonisme » soviétique, le maoïsme ainsi entendu touche tous les continents, exalte la jeunesse de nombreux pays et influence le mouvement communiste mondial, suscitant ici et là des scissions au sein des PC sans pourtant supplanter globalement l'influence soviétique. Dans la pratique, cependant, Mao prend des positions surprenantes en politique étrangère : rapprochement avec les États-Unis (visite de Richard Nixon en février 1972), soutien au chah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et au général Pinochet (1975).
ULTIMES RETOURNEMENTS ET MORT DE MAO (1971-1976)
Les dernières années de Mao sont dominées par la maladie, aggravée par un genre de vie sédentaire et son refus de se faire soigner. Au Xe Congrès du PCC, en août 1973, apparaissent autour de sa personne deux groupes distincts : celui des jeunes radicaux dogmatistes avec Jiang Qing (→ Bande des Quatre) et celui des vétérans empiristes du parti avec Zhou Enlai et Deng Xiaoping, revenu au premier plan. Mao apporte d'abord son soutien au groupe de Zhou, et Deng est promu vice-président du PCC et premier des vice-Premiers ministres après Zhou.
Puis, tandis que sa santé se détériore, Mao passe en 1975 sous l'influence de son neveu Mao Yuanxin, proche de Jiang Qing. Après la mort de Zhou Enlai, le 8 janvier 1976, les attributions de Deng lui sont retirées et Mao fait de Hua Guofeng à la fois le Premier ministre et le premier vice-président du PCC. La lutte couve entre le groupe de Hua et la Bande des Quatre lorsque, le 9 septembre 1976, Mao meurt.
2.6. L’HÉRITAGE DE MAO
L'arrestation peu après de la Bande des Quatre et le retour de Deng en 1977 marquent la fin de la période inaugurée par Mao depuis 1958 et préparent l'ouverture future de la Chine à une économie de marché contrôlée.
Deng Xiaoping engage, à partir de 1978, un processus de « démaoïsation ». Dans ce contexte nouveau, le rôle de Mao fait l'objet d'une réévaluation critique (en 1979, le Grand Bond en avant est qualifié de « Grand Bond en arrière »).
EN SAVOIR PLUS
* • campagne des Cent fleurs
* • Grand Bond en avant
* • histoire de la Chine
* • Longue Marche
* • maoïsme
* • marxisme
* • parti communiste chinois (PCC)
* • Révolution culturelle
Pourtant, le nom du fondateur de la République populaire demeure toujours une référence en Chine, sans doute parce que ce révolutionnaire mythique sert de soupape dans un pays en proie à la corruption généralisée des cadres. Il reste de lui le culte des projets démesurés – le barrage des Trois-Gorges en est un exemple –, l’idée d’une justice sociale distribuée équitablement entre les régions, souvent invoquée devant l’accroissement des inégalités, et l’héritage du parti unique, mais dont ses successeurs, contrairement à lui, se sont efforcés de préserver l’unité.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÉHISTORIQUES |
|
|
| |
|
| |

DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÉHISTORIQUES
Depuis leur fondation au milieu du XIXème siècle, les sciences de la préhistoire ont situé le devenir de la famille humaine dans les 5 ou 7 millions d'années de son existence. Ils ont déployé une rigueur et une inventivité extraordinaires pour faire parler les vestiges rares, disséminés et fragmentaires dont ils disposent.
La théorie de l'évolution conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, moment ponctuel miraculeux où il serait triomphalement apparu sur la terre, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal, dans les embranchements et les buissonnements multiples de l'histoire du vivant. Anthropologues et biologistes se sont attachés à reconstituer la généalogie de l'homme, et les mécanismes mêmes de son devenir : Ardipithecus ramidus, Australopithecus, Homo habilis, erectus, neandertalensis, sapiens... - dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres.
Les préhistoriens ont tenté de reconstituer les cultures, les modes de vie et de pensées des Préhistoriques : invention, usage et évolution de l'outillage, formes de l'expression et de la communication, gestes, croyances et rituels que pouvait exprimer l'art ou les sépultures. Les formes et les structures de la vie sociale des premières sociétés humaines - sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs - ont elles aussi été interrogées ; de nouvelles approches ont permis de repenser les relations entre hommes et femmes au Paléolithique, et de réévaluer le rôle de la femme dans la préhistoire.
DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÉHISTORIQUES
Texte de la 11ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 11 janvier 2000 par Claudine Cohen
De l'homme (et de la femme) préhistorique
En 1883, l'anthropologue français Gabriel de Mortillet publie Le Préhistorique, une somme du savoir accumulé de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore : seulement deux décennies plus tôt, Boucher de Perthes avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord sceptiques, puis émerveillés, les preuves de l'ancienneté de l'Homme, et démontré que des êtres humains avaient cohabité, en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire, avec des animaux aujourd'hui éteints - le Mammouth, l'Ours des Cavernes, le Rhinocéros laineux survivant par des froids glaciaires dans la profondeur des grottes, et armé de frustes "casse-têtes" de silex taillés.
Mortillet s'était employé à donner plus de rigueur à la science commençante, et avait classé selon un ordre typologique et évolutif les cultures humaines de cet homme, que déjà on n'appelait plus "antédiluvien". En 1865 John Lubbock avait forgé les termes de "Paléolithique" pour désigner les cultures de la pierre taillée, les plus anciennes, celles des chasseurs-cueilleurs, et "Néolithique" pour nommer les plus récentes, de la pierre polie et de la terre cuite propres aux premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage.
L'étude de l'Homme préhistorique de Mortillet se nourrissait des recherches de Boucher de Perthes dans la basse vallée de la Somme, et des magnifiques découvertes de Lartet et Christy dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne. S'inspirant de l'évolutionnisme darwinien (ou de ce qu'il croyait en savoir) il avait décrit le devenir linéaire et progressif de l'Homme et de ses cultures, depuis les primitifs bifaces de l'Acheuléen et du Chelléen, jusqu'aux industries de l'Homme de Néandertal (le Moustiérien) et aux cultures solutréennes et magdaléniennes, caractéristiques d'Homo sapiens. Cette progression de la lignée humaine culminait avec l'Homme de Cro-Magnon, un Homme semblable à nous, au front haut et à la stature robuste, découvert en 1868 dans la vallée de la Vézère. Aux racines de cette brillante lignée, Mortillet avait forgé la fiction d'un ancêtre mi-singe mi-homme, l'Anthropopithèque, auquel on attribua une petite industrie de silex éclatés trouvés à Thenay, dans le Loir et Cher, qui devaient bientôt se révéler être de vulgaires cailloux aux cassures naturelles.
Aujourd'hui, en l'an 2000, l'image de l'Homme préhistorique a beaucoup changé. Les idées sur l'évolution se sont modifiées, la Nouvelle Synthèse depuis les années 1930 a récusé l'image d'une évolution comprise comme progrès linéaire, mettant l'accent sur la variation, le buissonnement des formes, et la notion d'une histoire contingente, et imprévisible. D'innombrables découvertes ont enrichi notre vision du passé préhistorique de l'Homme, et ce n'est plus seulement dans le Loir-et-Cher, la vallée de la Somme et de la Vézère, que l'on va chercher ses origines, mais au Moyen Orient et en Europe centrale, aux confins de l'Afrique, de l'Indonésie, de la Chine...
Le regard sur la préhistoire est devenu plus directement ethnologique, et la volonté de mieux connaître dans leur réalité les premières sociétés humaines s'est marquée par de nouvelles exigences de rigueur dans les recherches de laboratoire et de terrain. Celles-ci font appel à un arsenal méthodologique nouveau - fouilles très fines, décapage horizontal des sites, remontages d'outils, méthodes quantitatives pour reconstituer la vie. La préhistoire expérimentale, par la taille et l'utilisation d'outils, en reproduisant les gestes du sculpteur ou du peintre, s'emploie à retrouver les pensées et les démarches opératoires des Hommes de ce lointain passé. Cette approche expérimentale et cognitive vise à livrer une vision plus vivante, plus vraie, plus humaine du passé lointain de notre espèce. Enfin, la vision de l'Homme préhistorique s'est diversifiée, complexifiée, et laisse aujourd'hui la place à une réflexion sur le rôle, les rôles possibles de la femme dans la préhistoire.
Généalogie d'Homo sapiens
"L'Homme descend du Singe", affirmait Darwin, et déjà Lamarck avant lui. La théorie de l'évolution, née au XIXème siècle, a conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal. Dès lors, reconstituer la généalogie de l'Homme, c'est réunir et tenter de donner un sens évolutif à tous ces vestiges osseux, baptisés Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo habilis, ergaster, rudolphensis, erectus, neandertalensis, sapiens... - qui dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres ; c'est interroger la configuration des événements complexes - biologiques, culturels, environnementaux - qui ont eu lieu depuis plus de 5 millions d'années.
La multiplicité des espèces d'Hominidés fossiles connues dès les époques les plus anciennes rend désormais impossible toute conception finaliste et linéaire de ce devenir. C'est un schéma arborescent, buissonnant même, qui rend le mieux compte de la profusion des espèces d'hominidés, parfois contemporaines entre elles, qui nous ont précédés. A lidée dune progression graduelle, on a pu opposer la possibilité de processus évolutifs plus soudains et contingents : ainsi Stephen Jay Gould a pu réaffirmer, après les embryologistes du début du siècle, l'importance pour l'évolution humaine de la néoténie : celle-ci consiste dans la rétention, à lâge adulte, de caractéristiques infantiles ou même fStales, qui peut faire apparaître dans une lignée des formes peu spécialisées qui seront à lorigine de groupes nouveaux. LHomme pourrait bien être un animal néoténique, et dériver dun ancêtre du Chimpanzé qui aurait conservé à lâge adulte les traits du jeune... Un des caractères particuliers de lHomme est en effet le retard de la maturation et la rétention des caractères juvéniles : ce retard se manifeste par certains traits anatomiques : régression de la pilosité, bras courts, tête volumineuse par rapport au reste du corps, gros cerveau, front redressé, régression de la face... - , mais aussi dans sa psychologie et son comportement : longue durée de léducation, goût du jeu, plasticité du système nerveux et capacité de lapprentissage jusque tard dans la vie.... L'acquisition chez l'homme de ces traits, et leur corrélation même, pourrait être explicable par un processus simple (et accidentel) du développement.
A la quête des origines de l'Homme s'est longtemps associée celle du "berceau" de l'humanité, dont Teilhard de Chardin se plaisait à dire qu'il était "à roulettes". On l'a recherché en Asie, en Europe, mais cest l'Afrique qui aujourd'hui s'impose comme le lieu d'enracinement le plus probable de la famille des Hominidés et du genre Homo. Les découvertes des hominidés les plus primitifs connus, les Australopithèques, faites d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est conduisent à penser que le berceau de la famille des Hominidés se situe dans ces régions.
La Vallée du grand Rift africain doit elle être considérée comme le lieu d'origine le plus probable de la famille des Hominidés ? Cette thèse est débattue aujourd'hui. Il se peut en effet que les découvertes nombreuses et spectaculaires dans ces sites - ainsi, celle de "Lucy", une Australopithèque très primitive datée de 3 millions d'années, dont les restes presque complets ont été découverts dans le site de Hadar, en Éthiopie en 1974 - s'expliquent plutôt par d'extraordinaires conditions de préservation des fossiles, et des conditions géologiques particulièrement favorables à ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, le schéma de "L'East Side Story" selon lequel les premiers Hominidés seraient d'abord apparus à l'est de la Rift Valley, après le creusement de cette faille il y a 7 millions d'années, semble devoir être révisé : une mandibule d'Australopithèque découverte par le paléontologue français Michel Brunet à quelque 2500 km à l'ouest la Rift Valley, au Tchad et contemporaine de Lucy, suggère que l'histoire humaine à cette époque très reculée met en jeu des facteurs environnementaux et comportementaux plus complexes que ceux supposés jusqu'alors. Cette découverte a fait rebondir la question du berceau de l'humanité : elle oblige à penser très tôt en termes de dispersions et de migrations, et à considérer que dès ces époques lointaines du Pliocène, il y a quelque 3 millions d'années, les Hominidés étaient déjà répandus dans une grande partie du continent africain.
Selon les constructions de la biologie moléculaire, c'est entre 5 et 7 millions d'années avant le présent qu'il faut situer l'enracinement commun des Hominidés et des Grands Singes. Les restes d'Ardipithecus ramidus, découverts en Éthiopie, ont été classés en 1994 dans un genre nouveau, que son ancienneté (4,4 millions d'années) semble situer tout près de l'origine commune des grands Singes africains et des premiers Hominidés.
Le tableau de lévolution de la famille humaine inclut de nombreuses espèces d' Australopithèques, ces Hominidés dallure primitive, au front bas, à la démarche bipède, qui ont coexisté en Afrique pendant de longues périodes et dont les vestiges sont datés entre 3,5 et 1 million d'années avant le présent.
Quant aux premiers représentants du genre Homo, ils sont reconnus à des périodes fort anciennes : à Olduvai (Tanzanie) Homo habilis, à partir de - 2,5 millions d'années, a été désigné comme le plus ancien représentant du genre auquel nous appartenons, mais il coexiste peut-être en Afrique avec une deuxième espèce du genre Homo, Homo ergaster.
A partir de -1,7 millions d'années Homo erectus apparaît en Afrique, puis va se répandre dans tout l'Ancien monde : Homo erectus est un Homme de taille plus élevée, au squelette plus lourd et dont le crâne, plus volumineux et plus robuste, a une capacité d'environ 800 cm3. Il va bientôt se répandre dans les zones tempérées du globe, dans le Sud-Est asiatique, en Asie orientale, dans le continent indien et en Europe. Culturellement, il s'achemine vers des sociétés de plus en plus complexes : il développe les techniques de la chasse, domestique le feu, et autour d'1,5 millions d'années invente le biface, qui pour la première fois dans l'histoire humaine manifeste le sens de la symétrie et de l'esthétique.
Les Néandertaliens (Homo neandertalensis) semblent apparaître il y a environ 400 000 ans en Europe occidentale, mais on les trouve aussi au Proche Orient, en Israël et en Irak, entre 100 000 et 40 000 avant le présent. Ces Hominidés au front bas, à la face fuyant en museau, à la carrure massive, mais au crâne dont la capacité cérébrale est proche de la nôtre, parfois même supérieure ont prospéré en Europe de l'Ouest, au Paléolithique moyen (jusqu'il y a 35 000 ans environ), avant d'être brusquement, et de façon encore mal comprise, remplacés par des hommes de type moderne au Paléolithique supérieur. Au Proche-Orient, les choses paraissent plus complexes. Au Paléolithique moyen, les Néandertaliens semblent bien avoir été les contemporains, dans les mêmes lieux, des sapiens archaïques. Pendant plusieurs dizaines de millénaires, ils ont partagé avec eux leurs cultures. Dans ces sites du Proche-Orient, la culture "moustérienne" est associée, non pas comme en Europe aux seuls Néandertaliens, mais à tous les représentants de la famille humaine. En particulier, la pratique de la sépulture est associée non à tel type biologique d'hominidé mais à ce qu'on peut appeler la culture moustérienne, qui leur est commune.
Histoire d'amour, de guerre ou... de simple cohabitation? Sapiens et Néandertaliens ont-ils pu coexister dans les mêmes lieux, avoir, à quelques variantes près, la même culture et les mêmes rituels funéraires, sans qu'il y ait eu d'échanges sexuels entre eux ? Pour certains, il pourrait s'agir de deux races d'une même espèce, donc fécondes entre elles, et les Néandertaliens auraient pu participer au patrimoine génétique de l'homme moderne. D'autres refusent cette hypothèse, sur la foi de l'étude récente d'un fragment d'ADN de Néandertalien, qui paraît confirmer - mais de manière encore fragile - la séparation des deux espèces, et donc l'impossibilité de leur interfécondité.
Les avancées de la génétique et de la biologie moléculaire ont conduit à poser en termes nouveaux la question de l'origine d'Homo sapiens et de la diversité humaine actuelle. Au milieu du XXème siècle, Franz Weidenreich, se fondant sur l'étude des Hominidés fossiles de Chine, les "Sinanthropes", considérait qu'"il doit y avoir eu non un seul, mais plusieurs centres où l'homme s'est développé ". Selon lui, la part trop importante faite aux fossiles européens avait masqué l'existence d'importantes particularités locales chez les Hominidés du Paléolithique inférieur (par exemple entre les Sinanthropes et les Pithécanthropes de Java). Au cours de l'évolution parallèle de ces groupes isolés les uns des autres par des barrières géographiques, les différences déjà présentes à ce stade ont pu se perpétuer jusqu'aux formes actuelles. Ces idées restent aujourd'hui à la source des approches "polycentristes" qui tentent de reconstituer le réseau complexe des origines des populations humaines actuelles, héritières selon eux de formes locales d'Homo erectus, remontant à 500 000 ans, voire 1 million d'années. Cette approche, qui privilégie l'étude des fossiles asiatiques, se donne pour une critique des mythes "édéniques" en même temps que de l'eurocentrisme qui a longtemps prévalu dans l'étude de la diversité au sein de l'humanité actuelle et fossile.
Face à ces positions "polycentristes", les tenants du "monocentrisme" défendent la thèse d'un remplacement rapide des formes d'hominidés primitifs par des Homo sapiens anatomiquement modernes : ils s'efforcent, à partir de l'étude des différences morphologiques, mais aussi des données de la biologie moléculaire, de reconstituer l'origine unique de toutes les populations humaines. Ces études ont abouti à un calcul des "distances génétiques" entre les populations actuelles, et avancé l'hypothèse d'une "Ève africaine" qui serait la "mère" commune de toute l'humanité
La thèse de l'origine unique et africaine de l'espèce Homo sapiens, il y a quelque 200 000 ans, irait dans le sens d'une séparation récente des populations humaines actuelles, et d'une différence très faible entre elles. Mais elle demande à être confirmée, non seulement par de nouvelles expériences et un échantillonnage rigoureux, mais aussi par les témoignages paléontologiques, rares à cette époque dans ce domaine géographique.
La mise en place de l'arbre généalogique de la famille humaine au cours de l'histoire de la paléoanthropologie et de la préhistoire reste aujourd'hui encore l'objet de discussions, qui concernent tant les schèmes évolutifs et les processus environnementaux que les critères biologiques et culturels qui y sont à l'Suvre. Lhistoire de la famille humaine apparaît fort complexe dès ses origines : aux racines de l'arbre généalogique, entre 4 millions et 1 million d'années, les Hominidés se diversifient en au moins deux genres (Australopithecus et Homo) et un véritable buissonnement d'espèces, dont certaines ont été contemporaines, parfois dans les mêmes sites. La multiplication des découvertes, l'introduction des méthodes de classification informatisées, et les bouleversements des paradigmes de savoir, ont abouti à rendre caduque la recherche d'un unique "chaînon manquant" entre l'Homme et le singe. L'espèce Homo sapiens a été resituée dans le cadre d'une famille qui a connu une grande diversification dans tout l'Ancien Monde. Que la plupart des espèces d'Hominidés se soient éteintes est un phénomène banal dans l'histoire du vivant, et ne signifie certainement pas que la nôtre fût la seule destinée à survivre. Plusieurs dizaines de milliers d'années durant, les Néandertaliens ont prospéré et parfois même cohabité avec notre espèce - et ils se sont éteints, comme d'ailleurs la plupart des espèces vivantes, il y a seulement un peu plus de 30 000 ans, pour des raisons qui restent inconnues. Mais ils auraient pu survivre, et la vision que nous avons de nous-mêmes en eût sans doute été fortement modifiée...
Le devenir des cultures humaines
"L'évolution [humaine] a commencé par les pieds"... aimait à dire par provocation André Leroi-Gourhan, insistant sur le fait que l'acquisition la bipédie précède dans l'histoire humaine le développement du cerveau.
De fait, des découvertes récentes ont montré que la bipédie a sans doute été acquise très tôt dans l'histoire de la famille humaine, il y a 3 ou 4 millions d'années. Les études menées sur la locomotion des Australopithèques ont conclu que ceux-ci marchaient déjà sur leurs deux pieds, même s'il leur arrivait parfois de se déplacer par brachiation - en se suspendant à l'aide de leurs bras. Les traces de pas découvertes en 1977 à Laetolil (Tanzanie ) et datées de 3,6 millions d'années sont bien celles de deux individus parfaitement bipèdes, marchant côte à côte... Elles ont confirmé le fait que la station redressée et la marche bipède étaient déjà acquises par ces Hominidés primitifs, - bien avant que la taille du cerveau n'atteigne son développement actuel.
Le développement du cerveau est certainement le trait le plus remarquable de la morphologie humaine. Des moulages naturels d'endocrânes fossiles - comme celui de lenfant de Taung, découvert en 1925 - ou des moulages artificiels obtenus à partir de limpression du cerveau sur la paroi interne du crâne dautres Hominidés fossiles ont permis de suivre les étapes de cette transformation du volume cérébral, de l'irrigation et de la complexification des circonvolutions cérébrales au cours de l'évolution des Hominidés. La question reste cependant posée du "Rubicon cérébral" - elle implique qu'il existerait une capacité endocrânienne au-delà de laquelle on pourrait légitimement considérer qu'on a affaire à des représentants du genre Homo, dignes d'entrer dans la galerie de nos ancêtres... La définition, longtemps discutée, d'Homo habilis comme premier représentant du genre humain, a fait reculer cette frontière à 600 cm3... et peut-être même encore moins : il faut donc bien admettre que le développement du cerveau n'a pas été l'unique "moteur" du développement humain : il s'associe à d'autres traits anatomiques propres à l'homme, station redressée, bipédie, morphologie de la main, fabrication et utilsation d'outils, usage d'un langage articulé...
La main humaine a conservé le schéma primitif, pentadactyle, de l'extrémité antérieure des Vertébrés quadrupèdes. La caractéristique humaine résiderait dans le fait que chez l'Homme le membre antérieur est totalement libéré des nécessités de la locomotion. Mise en rapport avec le développement du cerveau, la libération de la main ouvre à l'Homme les possibilités multiples de la technicité. L'avènement d'une "conscience" proprement humaine se situerait donc du côté de ses productions techniques.
L'outil est-il autant qu'on le pensait naguère porteur de la différence irréductible de l'homme ? Éthologistes, préhistoriens et anthropologues ont cherché à comparer, sur le terrain archéologique ou expérimental les "cultures" des Primates et celles des premiers Hominidés fossiles. Ils proposent des conclusions beaucoup plus nuancées que les dichotomies abruptes de jadis. Si l'outil définit l'Homme, l'apparition de l'Homme proprement dit ne coïncide plus avec celle de l'outil. Certains grands Singes savent utiliser et même fabriquer des outil. L'étude fine de la technicité des Panidés a également conduit à en observer des formes diversifiées dans différents groupes géographiquement délimités, et certains chercheurs n'hésitent pas à parler de "comportements culturels" chez ces Singes. D'autre part, les premières industries de pierre connues sont probablement l'Suvre des Australopithèques : ces hominidés au cerveau guère plus volumineux que celui d'un gorille sont-ils les auteurs des "pebble tools" ou des industries sur éclats vieilles d'environ 2,5 millions d'années - qui ont été trouvés associées à eux dans certains sites africains ? Beaucoup l'admettent aujourd'hui ... mais d'autres restent réticents à attribuer ce trait culturel à un Hominidé qui ne se situe pas dans notre ascendance ! Il a donc fallu repenser les "seuils" qui naguère semblaient infranchissables, non seulement entre grands Singes et premiers Hominidés, mais aussi entre les différents représentants de la famille humaine.
L'Homme seul serait capable de prévision, d'intention : Il sait fabriquer un outil pour assommer un animal ou découper ses chairs -et, plus encore, un outil pour faire un outil. Instrument du travail, l'outil est lui-même le produit d'un acte créateur. Si les vestiges osseux sont rares et se fossilisent mal, d'innombrables silex taillés, des primitifs "galets aménagés" aux élégantes "feuilles de laurier" solutréennes et aux pointes de flèches magdaléniennes permettent de suivre à la trace les chemins qu'ont empruntés les Hommes, d'évaluer leurs progrès dans la conquête et la maîtrise de la nature, de percevoir la complexité croissante de leurs échanges et de leurs communications.
Les "cultures" préhistoriques ont dans le passé été caractérisées, presque exclusivement, par l'outillage lithique qui les composent. Le Moustérien, le Solutréen, le Magdalénien, ce sont d'abord des types d'outils et de techniques lithiques décrits, inventoriés, étudiés dans leur distribution statistique. Cependant les approches contemporaines tendent à élargir cette notion de "cultures" en mettant en lumière d'autres traits culturels importants, inventions techniques essentielles comme celle du feu, de l'aiguille et du poinçon, de la corde, et du tissage, structures d'habitat, organisation du groupe social, division du travail...
Aux périodes les plus récents du Paléolithique supérieur, l'art, mobilier ou rupestre, traduit le fait que l'homme a désormais accès au symbolique, à la représentation. Innombrables sont les objets en ivoire, en os ou en bois de renne, sculptés ou gravés découverts sur les sites préhistoriques, et témoignant de la fécondité artistique des chasseurs cueilleurs de la préhistoire, et de ce que ces primitifs du Paléolithique avaient un talent et une sensibilité dartistes, très proches en somme de celles de lHomme daujourdhui.
Devant ces figurations animales et humaines ou ces signes abstraits, le problème se pose de leur signification : labbé Breuil nhésitait pas à prêter un sentiment religieux à ses auteurs, et à interpréter les figures et les symboles sculptés, gravés, dessinés ou peints du Paléolithique comme la manifestation de cultes animistes et de rituels chamaniques, que l'on retrouverait chez certains peuples actuels. La thèse du chamanisme a fait l'objet d'importantes critiques, elle a pourtant été récemment reprise par le préhistorien français Jean Clottes et l'anthropologue sud-africain David Lewis-Williams, qui proposent d'interpréter les symboles de l'art paléolithique en s'inspirant de ceux du chamanisme, lisibles selon eux dans l'art rupestre des Bushmen d'Afrique australe. Cette interprétation, étayée aussi par des arguments neuro-physiologiques, ne laisse pas d'être fragile, précisément par l'universalité qu'elle suppose, excluant les lectures de cet art qui viseraient à prendre en compte son contexte particulier et son symbolisme propre
La faculté symbolique dont témoigne l'art est sans aucun doute liée aux possibilités de l'échange et de la parole. On sait que certaines régions du cerveau humain sont dévolues à la parole et le développement de ces aires cérébrales a pu être observé, dès Homo habilis, voire même peut-être chez les Australopithèques. Certaines caractéristiques des organes de la phonation (larynx, apophyses de la mandibule pour linsertion de la langue, résonateurs nasaux) sont également invoquées, mais beaucoup dincertitudes subsistent : le grognement, le cri, le chant, ont-ils été les formes primitives de l'expression humaine ? Le langage "doublement articulé" - au niveau phonétique et sémantique - existe-t-il déjà aux stades anciens du genre Homo, voire dès Australopithecus, ou apparaît-il seulement avec l'Homme moderne ? Le langage humain résulte-t-il d'un "instinct" déterminé génétiquement qui dès les origines de la famille humaine nous distingue déjà des autres primates ? ou faut-il le considérer comme un produit de la société et de la culture, contemporain de la maîtrise des symboles de l'art ?
Nouveaux regards sur la femme préhistorique
Le XIXème siècle n'avait pas donné une image très glorieuse de la femme préhistorique. Le héros de la préhistoire, de Figuier à Rosny, cest l'Homme de Cro-Magnon, armé d'un gourdin, traînant sa conquête par les cheveux pour se livrer à d'inavouables orgies dans l'obscurité de la caverne& La sauvagerie des "âges farouches" est alors prétexte à des allusions à la brutalité sexuelle, au viol. Cet intérêt pour les mSurs sexuelles des origines est sans doute l'envers de la pruderie d'une époque. Il rejoint celui que l'on commence à porter aux ténèbres de l'âme, aux pulsions primitives, inconscientes, qui s'enracinent dans les époques primitives de l'humanité.
Notre regard aujourdhui semble se transformer. Notre héros de la préhistoire, c'est une héroïne, Lucy, une Australopithèque découverte en 1974 dans le site de Hadar en Ethiopie et qui vécut il y a quelque 3 millions d'années. Innombrables sont les récits qui nous retracent les bonheurs et les aléas de son existence. Signe des temps : la femme a désormais une place dans la préhistoire.
Les anthropologues ont renouvelé l'approche de la question des relations entre les sexes aux temps préhistoriques en mettant l'accent sur l'importance, dans le processus même de l'hominisation, de la perte de l'oestrus qui distingue la sexualité humaine de celle des autres mammifères. Tandis que l'activité sexuelle chez la plupart des animaux, y compris les grands Singes, est soumise à une horloge biologique et hormonale, celle qui détermine les périodes de rut - la sexualité humaine se situe sur le fond d'une disponibilité permanente. Cette disponibilité fut sans doute la condition de l'apparition des normes et des interdits qui dans toutes les sociétés limitent les usages et les pratiques de la sexualité. Peut-être a-t-on vu alors naître des sentiments de tendresse, s'ébaucher des formes de la vie familiale, de la division du travail - et s'établir les règles morales, l'interdit de l'inceste et les structures de la parenté dont les anthropologues nous ont appris quils se situent au fondement de toute culture.
Depuis environ trois décennies, des travaux conjugués d'ethnologie et de préhistoire ont remis en cause les a priori jusque là régnants sur linanité du rôle économique et culturel des femmes dans les sociétés paléolithiques. Les recherches des ethnologues sur les Bushmen dAfrique du Sud ont ouvert de nouvelles voies pour la compréhension des modes de vie et de subsistance, des structures familiales et de la division sexuelle du travail chez les peuples de chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes nomades, les femmes, loin d'être passives, vouées à des tâches subalternes, immobilisées par la nécessité délever les enfants, et dépendantes des hommes pour l'acquisition de leur subsistance, jouent au contraire un rôle actif à la recherche de nourriture, cueillant, chassant à loccasion, utilisant des outils, portant leurs enfants avec elles jusquà lâge de quatre ans, et pratiquant certaines techniques de contrôle des naissance (tel que l'allaitement prolongé). Ces études ont conduit les préhistoriens à repenser l'existence des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, à récuser les modèles qui situaient la chasse (activité exclusivement masculine) à lorigine de formes de la vie sociale, et à élaborer des scénarios plus complexes et nuancés, mettant en scène la possibilité de collaborations variées entre hommes et femmes pour la survie du groupe.
La figure épique de Man the Hunter, le héros chasseur poursuivant indéfiniment le gros gibier a vécu. Il faut désormais lui adjoindre celle de Woman the gatherer, la femme collectrice (de plantes, de fruits, de coquillages). Larchéologue américain Lewis Binford est allé plus loin en insistant sur l'importance au Paléolithique des activités, non de chasse, mais de charognage, de dépeçage, de transport et de consommation de carcasses d'animaux morts, tués par d'autres prédateurs. Des preuves dactivités de ce type se trouveraient dans la nature et la distribution des outils de pierre sur certains sites de dépeçage, et dans la sélection des parties anatomiques des animaux consommés. Si tel est le cas, des femmes ont pu participer à ces activités, et être, tout autant que les hommes, pourvoyeuses de nourriture.
Il se peut aussi que, contrairement aux idées reçues, les femmes aient été très tôt techniciennes, fabricatrices d'outils quelles se soient livrées par exemple à la taille des fines industries sur éclats qui abondent à toutes les époques du Paléolithique -, qu'elles aient inventé il y a quelque 20 000 ans, la corde et l'art du tissage de fibres végétales, dont témoignent les parures et les vêtements qui ornent certaines statuettes paléolithiques : la résille qui coiffe la "dame à la capuche" de Brassempouy, le "pagne" de la Vénus de Lespugue, les ceintures des Vénus d'ivoire de Kostienki, en Russie&
Ces Vénus paléolithiques nous donnent-elles pour autant une image réaliste de la femme préhistorique ? Si tel était le cas, il faudrait croire, comme le disait avec humour Leroi-Gourhan, que la femme paléolithique était une nature simple, nue et les cheveux bouclés, qui vivait les mains jointes sur la poitrine, dominant sereinement de sa tête minuscule lépouvantable affaissement de sa poitrine et de ses hanches &Ces Vénus ont suscité une multitude d'interprétations - tour à tour anthropologiques, physiologiques, voire gynécologiques, religieuses, symboliques. Certains, s'appuyant sur l'abondance dans lart paléolithique des images sexuelles et des objets réalistes - vulves féminines ou phallus en érection, scènes d'accouplement, corps de femmes dont les seins, les fesses et le sexe sont extraordinairement soulignés, y ont vu l'expression sans détour de désirs et de pratiques sexuels, en somme l'équivalent paléolithique de notre pornographie&
Des études féministes ont mis en cause le fait, jusque là donné pour une évidence, qu'il puisse s'agir d'un art fait par des hommes et pour des hommes. Chez les Aborigènes australiens, l'art sacré est en certaines occasions réservé aux femmes. Si on admet que l'art paléolithique a pu avoir une fonction rituelle et religieuse, ses figurations et ses objets pourraient avoir été destinés, plutôt qu'à un usage exclusivement masculin, à l'usage des femmes ou à l'initiation sexuelle des adolescentes. L'ethnologue californienne Marija Gimbutas a reconnu dans ces Vénus paléolithiques des images de la "Grande Mère", figure cosmogonique, symbole universel de fécondité, qui se retrouve au Néolithique et jusqu'à l'Age du Bronze dans toute l'Europe : ces sociétés dont les religions auraient été fondées sur le culte de la "Grande Déesse" auraient connu, de manière continue jusqu'à une époque relativement récente, des formes de pouvoir matriarcales et des formes de transmission matrilinéaires, avant d'être remplacées par des structures sociales à dominance masculine et des religions patriarcales. Cette construction, qui reprend la thèse du matriarcat primitif à lappui de thèses féministes, reste pourtant fragile : lhistoire ultérieure ne nous montre-t-elle pas que le culte de la mère peut exister dans des religions à dominance masculine, et dans des sociétés comportant une bonne part de misogynie ?
Quoi quil en soit, limage de la femme du Paléolithique a changé. Sil reste souvent à peu près impossible de désigner précisément ce qui dans les rares vestiges de la préhistoire, ressortit à lactivité de lun ou lautre sexe, ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux savoirs, qui ne sont pas sans liens avec les transformations de nos sociétés, nous livrent une image plus vivante, plus colorée, plus ressemblante peut-être, de la femme des origines.
Conclusion
Comme tous les savoirs de l'origine, la préhistoire est un lieu inépuisable de questionnements, de rêves et de fantasmes. Elle représente un monde à la limite de la rationalité et de l'imaginaire, où peut s'exprimer le lyrisme, la fantaisie, l'humour, l'érotisme, la poésie. Mais l'imagination, en ce domaine, ne saurait être réduite à une combinatoire de thèmes fixés, archétypes ou lieux communs. Elle invente, elle crée, elle se renouvelle en fonction des découvertes et des événements, mais aussi des représentations prégnantes en un moment et dans un contexte particulier.
La préhistoire est une science interdisciplinaire, qui mobilise la géologie, la biologie, l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art& et qui s'enrichit des développement de tous ces savoirs. Mais elle est avant tout une discipline historique, dont les documents sont pourtant beaucoup plus pauvres que ceux de l'histoire : ce sont des traces, des vestiges fragmentaires et muets, auxquels il faut donner sens, et dont l'interprétation est un lieu privilégié de projection de nos propres cadres mentaux et culturels.
Cest pourquoi on peut prophétiser sans risque que l'humanité préhistorique du XXIème siècle ne ressemblera pas à celle du XIXème ou du XXème siècle. Non seulement parce que des découvertes, suscitées ou inattendues, surgiront du terrain ou du laboratoire. Mais aussi parce que nos sociétés elles-mêmes, et la conscience que nous en avons, changeront elles aussi. Car l'Homme préhistorique a une double histoire : la sienne propre, et celle de nos représentations.
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
