|
|
|
|
 |
|
La phototoxicité des éclairages domestiques sous-estimée |
|
|
| |
|
| |

La phototoxicité des éclairages domestiques sous-estimée
PUBLIÉ LE : 15/04/2024 TEMPS DE LECTURE : 4 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
« Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » L’univers baigne dans de la lumière. Sans elle, on ne peut pas voir. Mais, attention : trop de lumière peut endommager l’œil. Ce message, Alicia Torriglia, chercheuse Inserm au Centre de recherche des Cordeliers à Paris, le porte avec une nouvelle étude qui alerte sur les seuils d’exposition.
Bien que l’œil soit en grande partie protégé des effets délétères de la lumière par des systèmes antioxydants complexes et puissants, une exposition excessive peut induire des lésions tissulaires irréversibles. Par exemple, une surexposition à la lumière du soleil accélère l’apparition et la progression de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). À ce risque s’ajoutent ceux associés à l’usage des lumières artificielles, de jour comme de nuit. Il est en particulier établi que la lumière bleue, émise notamment par les LED, endommage les cellules de la rétine et entraîne des troubles du sommeil et d’autres anomalies associées à une dérégulation du rythme circadien.
Pour nous protéger de ces effets, il est recommandé de porter des lunettes de soleil et des normes restrictives s’appliquent aux sources lumineuses artificielles, comme les ampoules incandescentes ou les LED. Cependant, ces normes fixées il y a plus de 40 ans semblent trop permissives : d’après les études conduites sur des rongeurs par la chercheuse Inserm Alicia Torriglia, la dose à partir de laquelle les éclairages artificiels seraient toxiques pour les yeux est surestimée d’un facteur 50.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Cancer, le double jeu du fer |
|
|
| |
|
| |
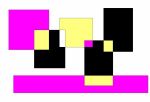
Cancer, le double jeu du fer
23.05.2025, par Mehdi Harmi
Temps de lecture : 9 minutes
Image de synthèse montrant une membrane lipidique en train de se dégrader (en bas à droite) du fait d'une forte présence de fer.
Nicolle R. Fuller / Science Photo Library
Les approches telles que la chimiothérapie ont tendance à n’être efficaces que contre les cellules cancéreuses qui prolifèrent le plus. À l’Institut Curie, Raphaël Rodriguez et son équipe ont opté pour une démarche unique. Ils ciblent les cellules à fort potentiel métastatique grâce à une molécule capable d’induire une mort cellulaire particulière, médiée par le fer : la ferroptose.
Le cancer, le mal du siècle, continue de résister à l’arsenal thérapeutique développé au fil des ans par les scientifiques du monde entier. Le fait est que le cancer est retors. Aujourd’hui, la plupart des thérapies ciblent préférentiellement les cellules cancéreuses en prolifération. Ces divisions rapides, en plus de permettre à la tumeur de croître, induisent une pression de sélection sur leur propre communauté. Ainsi, au sein de la tumeur, certaines cellules s’adaptent et arrêtent de se diviser pour entrer dans une sorte de dormance leur permettant d’échapper aux traitements.
Plus encore, cet état non prolifératif est associé dans certains cas à d’autres propriétés, à savoir la capacité à migrer, à envahir d’autres tissus – bref, à métastaser. Ces cellules métastatiques ont, de surcroît, une plus forte résistance aux chimiothérapies actuelles et un fort potentiel de colonisation. Elles sont l’objet des travaux de scientifiques du CNRS, de l’Institut Curie et de l’Inserm dirigés par le chimiste Raphaël Rodriguez1. « La thématique majeure de mon laboratoire est de comprendre qu’elle est la nature de cette adaptation et quelles en sont les bases chimiques et moléculaires sous-jacentes, précise le chercheur. Sachant que si on comprend comment ces cellules s’adaptent, on peut identifier de nouvelles cibles et, par conséquent, inventer de nouveaux médicaments qui cibleront et entraveront ces adaptations. »
Pour lire la suite , consulter le LIEN.
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le microbiote, un allié de choix pour prédire la sensibilité de chacun aux additifs alimentaires |
|
|
| |
|
| |
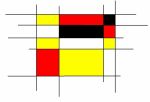
Le microbiote, un allié de choix pour prédire la sensibilité de chacun aux additifs alimentaires
27 Jan 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie
?Coupe de tissu intestinal avec un marquage des cellules immunitaires. © Héloïse Rytter
Largement utilisés par l’industrie agroalimentaire, les agents émulsifiants, un type d’additifs alimentaires, sont retrouvés dans de nombreux aliments de notre quotidien (pain de mie, glaces, crème fraîche, laits végétaux…). Les effets de leur consommation sur la santé sont devenus un véritable sujet de santé publique, tant leur présence dans l’alimentation actuelle est importante. Benoit Chassaing, directeur de recherche Inserm et responsable de l’équipe Interactions Microbiote-Hôte à l’Institut Pasteur (Inserm/Université Paris Cité/CNRS), a précédemment montré que ces additifs pourraient favoriser le développement de maladies inflammatoires chroniques et de dérégulations métaboliques en agissant directement sur notre microbiote intestinal. Dans une nouvelle étude, publiée dans le journal Gut, son équipe et lui ont développé un modèle de microbiote humain capable de prédire la sensibilité de chacun à un agent émulsifiant, et ceci grâce à un simple échantillon de selles. Cette découverte ouvre ainsi la voie à une approche de nutrition personnalisée fondée sur le microbiote intestinal afin de maintenir une bonne santé intestinale et métabolique.
L’industrie agroalimentaire a de plus en plus recours à de nombreux additifs afin d’améliorer la texture et d’allonger la durée de conservation de ses produits. Plusieurs études ont fait état de leurs effets néfastes sur la santé intestinale et métabolique, en lien avec leurs interactions avec notre microbiote. En 2015, Benoit Chassaing, directeur de recherche à l’Inserm, s’était notamment intéressé aux effets sur le microbiote et la santé intestinale de la consommation d’un émulsifiant, le carboxyméthylcellulose (CMC), communément retrouvé dans les brioches industrielles, le pain de mie ou encore les glaces[1]. Les résultats de ses recherches suggéraient alors qu’une consommation à long terme de cet additif pouvait impacter négativement le microbiote et, par conséquent, favoriser les maladies inflammatoires chroniques ainsi que des dérégulations métaboliques.
Par la suite, lors d’un essai clinique mené sur des volontaires sains, le chercheur et son équipe ont pu montrer que nous ne sommes pas tous égaux face aux agents émulsifiants : certaines personnes, dites sensibles, possèderaient un microbiote très réactif à ces composés, tandis que d’autres semblent posséder un microbiote complètement résistant aux impacts négatifs de ces additifs. Cette classe d’additifs alimentaires étant omniprésente dans notre alimentation moderne, il est alors apparu nécessaire de mieux comprendre ces variations de sensibilité entre individus, afin de promouvoir une meilleure santé intestinale et métabolique.
Dans cette optique, l’équipe dirigée par Benoit Chassaing est ainsi parvenue à prédire la sensibilité d’une personne donnée à un agent émulsifiant, via une analyse approfondie de son microbiote.
Pour cela, les chercheurs ont développé un modèle de microbiote en laboratoire capable de reproduire le microbiote humain. Ce modèle a permis aux chercheurs de tester in vitro l’effet du CMC sur différents microbiotes. Ils ont ici aussi observé qu’un microbiote donné peut être soit sensible soit résistant à cet agent émulsifiant. De plus, la sensibilité prédite d’un microbiote donné a pu être parfaitement validée grâce à des approches de transfert de microbiote dans un modèle souris, avec l’observation que seuls les microbiotes prédits sensibles aux agents émulsifiants étaient en effet capables de conduire à une colite sévère chez les animaux consommant du CMC.
INSERM-LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle |
|
|
| |
|
| |

Un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle
19 Fév 2018 | Par Inserm (Salle de presse) | Génétique, génomique et bio-informatique
Une équipe de chercheurs dirigée par Maria-Christina Zennaro, directrice de recherche Inserm au sein du Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire (Inserm/ Université Paris-Descartes), en collaboration avec des collègues allemands[1], a identifié un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle. Cette étude a été publiée dans Nature Genetics.
Ces nouveaux résultats soulignent l’importance du terrain génétique dans la survenue des maladies communes et confortent l’intérêt du déploiement du Plan France Médecine Génomique 2025. L’un de ses objectifs consiste effectivement à permettre l’accès au dépistage génétique, même pour des pathologies communes, pour proposer une médecine individualisée.
L’hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, qui touche jusqu’à 25% de la population. Dans environ 10% des cas, elle est due au dysfonctionnement de la glande surrénale qui produit en excès l’aldostérone, une hormone qui régule la pression artérielle. On parle alors d’hyperaldostéronisme primaire. Les patients touchés par cette maladie ont une hypertension souvent grave et résistante aux traitements habituels. Ces patients ont aussi plus de risques de développer des accidents cardiovasculaires, notamment des infarctus du myocarde et des AVC.
Afin de mieux comprendre les causes de cette maladie, Maria-Christina Zennaro et Fabio Fernandes-Rosa, chercheurs Inserm à Paris, ont analysé les exomes (la part du génome codant pour les protéines) de patients atteints d’hyperaldostéronisme primaire avant l’âge de 25 ans. Cette approche a permis d’identifier une mutation dans un gène jusqu’à alors inconnu, CLCN2. Ce gène code pour un canal chlorure, dont la présence et les effets dans la glande surrénale étaient alors inconnus.
Une production autonome d’aldostérone
Grâce à leur partenariat avec une équipe allemande dirigée par Thomas Jentsch à Berlin, les chercheurs ont étudié les mécanismes par lesquels cette mutation pouvait induire une production autonome d’aldostérone et déclencher une hypertension artérielle. Ils ont découvert que la mutation entrainait une ouverture permanente du canal chlorure.
Dans un modèle animal, les chercheurs ont montré que ce canal est justement exprimé dans la zone des surrénales produisant l’aldostérone. Par des expériences d’électrophysiologie et de biologie cellulaire, ils ont montré que l’influx de chlorure à travers le canal muté aboutissait à une augmentation des flux de chlorure et une dépolarisation de la membrane cellulaire. Les cellules de cortex surrénalien produisent alors plus d’aldostérone en présence du canal muté et expriment d’avantage les enzymes impliqués dans sa biosynthèse.
Cette découverte révèle un rôle jusqu’alors inconnu d’un canal chlorure dans la production d’aldostérone. Elle ouvre des perspectives tout à fait nouvelles dans la pathogenèse et la prise en charge de l’hypertension artérielle.
[1] Du Leibniz Institute for Molecular Pharmacology (FMP) et Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC) à Berlin.
DOCUMENT INSERM LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] Précédente - Suivante |
|
|
|
|
|
|
